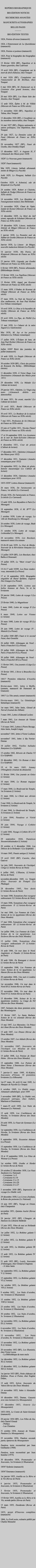février 1830 (BF) — Poésies allemandes, Schiller
<<< Poésies allemandes, Introduction
<<< Poésies allemandes, Klopstock
<<< Poésies allemandes, Goethe
******
SCHILLER.
___
LA CHANSON DE LA CLOCHE.
« Le moule d’argile s’est affermi dans la terre qui l’environne : aujourd’hui, la cloche doit naître. Compagnons, vite au travail ! Que la sueur baigne vos fronts brûlants.... L’œuvre honorera l’ouvrier, si la bénédiction d’en haut l’accompagne. »
Mêlons des discours sérieux au travail sérieux que nous entreprenons ; de sages paroles en adouciront la peine. Observons attentivement le noble résultat de nos faibles efforts : honte à l’être stupide qui ne peut pas comprendre l’ouvrage de ses mains ! C’est le raisonnement qui ennoblit l’homme, en lui dévoilant le motif et le but de ses travaux.
« Prenez du bois de sapin bien séché : la flamme en sera chassée dans les tubes avec plus de violence. Qu’un feu actif précipite l’alliage du cuivre et de l’étain, afin que le bronze fluide se répande ensuite dans le moule. »
Cette cloche, qu’à l’aide du feu nos mains auront formée dans le sein de la terre, témoignera souvent de nous dans sa haute demeure. Elle va durer bien des jours, ébranler bien des oreilles, soit qu’elle se lamente avec les affligés, soit qu’elle unisse ses accents à ceux de la prière : tout ce que l’inconstante destinée réserve aux mortels, elle le racontera de sa bouche d’airain.
« Des bulles d’air blanchissent la surface. Bien ! la masse devient mobile. Laissons-la se pénétrer du sel alcalin qui en doit faciliter la fusion : il faut que le mélange se purge de toute son écume, afin que la voix du métal retentisse pure et profonde. »
C’est la cloche qui salue de l’accent de la joie l’enfant chéri qui naît au jour encore plongé dans les bras du sommeil : noire ou blanche, sa destinée repose aussi dans l’avenir ; mais les soins de l’amour maternel veillent sur son matin doré. — Les ans fuient comme un trait. Jeune homme, il s’arrache aux jeux de ses sœurs et se précipite fièrement dans la vie.... Il court le monde avec le bâton du voyage, puis revient, étranger, au foyer paternel. C’est alors que la jeune fille, noble image des cieux, lui apparaît dans tout l’éclat de sa beauté, avec ses joues toutes roses de modestie et de pudeur. —
« Comme les tubes déjà brunissent ! Je vais plonger ce rameau dans le creuset ; s’il en sort couvert d’une couche vitrée, il sera temps de couler. Allons ! compagnons, éprouvez-moi le mélange, et voyez si l’union du métal dur au métal ductile s’est heureusement accomplie. »
Car de l’alliance de la force avec la douceur résulte une heureuse harmonie. Ceux qui s’unissant pour toujours doivent donc s’assurer que leurs cœurs se répondent. L’illusion est de peu de durée, le repentir éternel. — Avec quelle grâce la couronne virginale se joue sur le front de la jeune épouse, quand le son argentin des cloches l’appelle aux pompes de l’hymen ! Hélas ! la plus belle fête de la vie nous annonce aussi la fin de son printemps : avec la ceinture, avec le voile, combien d’illusions s’évanouissent ! — La passion fuit, que l’attachement lui succède ; la fleur se fane, que le fruit la remplace. — Il faut désormais que l’homme, dans sa lutte avec une vie hostile, emploie tour à tour l’activité, l’adresse, la force et l’audace pour atteindre le bonheur. D’abord l’abondance le comble de ses dons ; ses magasins regorgent de richesses, ses domaines s’étendent, sa maison s’agrandit. La mère de famille en gouverne sagement l’intérieur, elle instruit sa fille, tempère la fougue de son jeune fils, promène partout ses mains actives, et son esprit d’ordre ajoute aux biens déjà acquis ; elle remplit d’objets précieux ses armoires odorantes ; sans cesse le fil bourdonne autour de ses fuseaux ; la laine luisante, le lin d’un blanc de neige s’amassent dans ses coffres éblouissants de propreté, et, répandant partout l’éclat sur l’abondance, elle n’accorde rien au repos.
Le père cependant, du haut de sa maison, jette un regard satisfait sur sa fortune qui fleurit encore à l’entour ; il contemple ses arbres, ses enclos, ses greniers déjà pleins et ses champs ondoyants de moissons nouvelles, et soudain des paroles d’orgueil s’échappent de sa bouche : « Ma prospérité, solide comme les fondements de la terre brave désormais l’infortune ! » Hélas qui peut faire un pacte éternel avec le sort ?... Le malheur arrive vite.
« Bien, la fonte peut commencer : la cassure est déjà dentelée ; pourtant, avant de lui livrer passage, une prière ardente au Seigneur : — Débouchez les conduits, et que Dieu protège le moule ! Oh ! comme les vagues de feu se précipitent dans l’espace qui leur est ouvert ! »
Le feu ! c’est une puissance bienfaisante, quand l’homme le maîtrise et le surveille ; c’est un don céleste qui facilite et accomplit bien des travaux. Mais qu’il est redoutable, ce fils de la nature, quand il surmonte les obstacles qui l’enchaînaient et reprend son indépendance. Malheur ! lorsque, abandonné à lui-même, il déroule sa marche triomphante au sein d’une cité populeuse ! car tous les éléments sont ennemis des créations humaines. — Du sein des nuages tombe la pluie bienfaisante aux moissons : du sein des nuages.... la foudre ! —
Entendez-vous ce son qui gémit dans la tour ? C’est le tocsin ! Le ciel est d’un rouge de sang, et pourtant ce n’est pas l’aurore.... Quel tumulte dans les rues ! que de fumées !... Le feu tantôt s’élève au ciel en colonnes flamboyantes, tantôt se précipite dans toute la longueur des rues, comme de la gueule d’un four. L’air est embrasé.... les poutres craquent, les murs s’écroulent, les vitres pétillent, les enfants crient, les mères courent çà et là, les animaux hurlent parmi les débris.... tout se presse, périt ou s’échappe.... la nuit brille de tout l’éclat du jour. Enfin une longue chaîne s’établit autour de l’incendie, le seau vole de mains en mains, et partout l’eau des pompes s’élance en arcades.... Mais voilà que l’aquilon vient en rugissant tourbillonner dans la fournaise.... c’en est fait.... la flamme a gagné les greniers où s’entassent de riches moissons, s’attache aux bois desséchés ; puis, comme si elle voulait, dans sa fuite puissante, entraîner avec soi tout le poids de la terre, elle s’élance au ciel en forme gigantesque. — L’homme a perdu tout espoir ; il fléchit sous la main du sort, et désormais assiste à la destruction de ses œuvres, immobile et stupide.
Tout est vide et brûlé ! Maintenant, la tempête seule habitera ces ruines ceintes d’effroi, et qui ne verront plus passer que les nuages du ciel.
Un dernier regard vers le tombeau de sa fortune...... et l’homme s’éloigne : il a repris le bâton du voyage.... C’est tout ce que l’incendie lui a laissé. Mais une douce consolation l’attend au départ : il compte les têtes qui lui sont chères, et toutes ont survécu !
« La terre a reçu le métal, et le moule est heureusement rempli : mais verrons-nous enfin le succès couronner notre zèle et notre habileté ?.... Si la fonte n’avait pas réussi ! si le moule se brisait ! Ah ! pendant que nous nous livrons à la joie le mal peut-être est déjà consommé ! »
Nous confions l’œuvre de nos mains au sein ténébreux de la terre : le laboureur lui confie sa semence avec l’espoir que la bénédiction du ciel en fera jaillir des moissons. Ce que nous y déposons avec crainte est plus précieux encore ; puisse-t-il sortir aussi du tombeau pour un destin glorieux.
De son dôme élevé, la cloche retentit lourde et sombre aux pompes des funérailles ; ses accents solennels accompagnent l’homme à son dernier voyage. Ah ! c’est une fidèle épouse, c’est une tendre mère, que le princes des ombres arrache aux bras de son époux, aux enfants nombreux que, jeune encore, elle éleva sur son sein avec un amour inépuisable. Hélas ! ces liens de famille sont rompus, et pour toujours ; ses soins, sa douce autorité ne veilleront plus sur ses jeunes enfants, victimes désormais d’une marâtre insensible.
« Pendant que la cloche se refroidit, suspendons nos rudes travaux, et que chacun se divertisse comme l’oiseau sous le feuillage. Aux premières lueurs des étoiles, le serviteur, libre de tous soins, entend avec joie sonner l’heure du soir ; mais, pour le maître, il n’est point de repos. »
Le promeneur, qui s’est écarté bien loin dans les bois solitaires, précipite ses pas vers sa demeure chérie ; les brebis bêlantes, les bœufs au poil luisant, au large front, regagnent l’étable accoutumée ; le lourd chariot s’ébranle péniblement sous sa charge de moissons ; mais au-dessus des gerbes repose une couronne aux couleurs bigarrées, et la jeune troupe de moissonneurs s’envole à la danse.
Bientôt le silence se promène sur les places et le long des rues ; les habitants du même toit se réunissent autour du foyer commun, et les portes de la ville se ferment avec un long gémissement. La nuit s’épaissit encore, mais le citoyen paisible ne la redoute point ; si le méchant s’éveille avec l’ombre, l’œil de la loi est ouvert sur ses pas.
C’est l’ordre, fils bienfaisant du ciel, qui unit les hommes par des liens légers et aimables, qui affermit les fondements des villes, qui ravit à ses bois le sauvage indompté, s’assied dans les demeures des mortels, adoucit leurs mœurs et donne naissance au plus saint des amours, celui de la patrie !
Mille mains actives s’aident d’un mutuel secours, et pour le même but tous les efforts s’unissent : le maître et les compagnons travaillent également sous la protection de la sainte liberté ; chacun vit content de son sort et méprise l’oisiveté railleuse, car le travail fait la gloire du citoyen, et le bonheur sa récompense : il s’honore de ses ouvrages comme le roi de son éclat.
Aimable paix, douce union, fixez-vous à jamais dans notre ville ; qu’il ne se lève jamais pour vous, le jour où les bandes sanglantes de la guerre envahiraient cette vallée silencieuse, où le ciel, qui se teint de l’aimable rougeur du soir, ne réfléchirait plus que l’incendie épouvantable des villages et des cités !
« Maintenant, brisez-moi le moule : il a rempli sa destination ; que nos yeux et notre cœur se repaissent à la vue du doux spectacle qui va leur être offert : levez le marteau, frappez, frappez encore jusqu’à ce que l’enveloppe s’échappe en débris, si vous voulez que la cloche enfin naisse au jour. »
Le maître peut rompre le moule d’une main exercée, et dans un temps convenable ; mais malheur à lui quand la fonte ardente s’en échappe en torrents de flammes, qu’avec un bruit de tonnerre elle brise son étroite demeure et répand la ruine avec elle, pareille aux brasiers de l’enfer ! Où s’agitent des forces aveugles, nul effet bienfaisant ne peut se produire : ainsi, quand un peuple s’est affranchi de toute domination, il n’est plus pour lui de prospérité.
Oh ! malheur ! quand plane sur les villes la révolte aux ailes de feu ! quand un peuple, léger d’entraves, s’empare horriblement du soin de se défendre ; quand parmi les cordes de la cloche se suspend la Discorde aux cris de sang, et qu’elle convertit des signaux pacifiques en signaux de carnage !
Liberté ! égalité !.... Partout ces cris retentissent ! Le paisible bourgeois court aux armes ; les rues, les places s’encombrent de foule ; des bandes d’assassins les parcourent, suivies de femmes qui se font un jeu d’insulter les victimes et d’arracher le cœur à leurs ennemis mourants : plus de religion, plus de liens sociaux ; les bons cèdent la place aux méchants, et tous les crimes marchent le front levé.
Il est dangereux d’exciter le réveil du lion ; la colère du tigre est à redouter ; mais celle de l’homme est de toutes la plus horrible ! La lumière, bienfait du ciel, ne doit pas être confiée à l’aveugle, elle ne l’éclairerait point ; mais elle pourrait dans ses mains réduire en cendre les villes et les campagnes.
« Oh ! quelle joie Dieu m’a donnée ! voyez comme le cintre métallique, dégagé de toute l’argile, luit aux yeux en étoile d’or ! comme, du sommet à la bordure, les armoiries ressortent bien aux rayons du soleil, et rendent témoignage au talent de l’ouvrier ! »
Accourez, compagnons, accourez autour de la cloche et donnons-lui le baptême : il faut qu’on la nomme Concorde, qu’elle préside à la réconciliation, et qu’elle réunisse les hommes dans un accord sincère.
Et tel était le but du maître en la créant : que maintenant, bien loin des futilités de la terre, elle s’élève au sein de l’azur du ciel, voisine du tonnerre et couronnée par les étoiles ! Que sa voix se mêle au concert des astres qui célèbrent leur Créateur et règlent le cours des saisons ; que sa bouche de métal ne retentissent que de sons graves et religieux ; que, toutes les heures, le temps la frappe de son aile rapide ; qu’elle-même, inanimée, elle proclame les arrêts du destin ; que ses mouvements nous instruisent des vicissitudes humaines, et, de même que ses sons viennent mourir dans notre oreille après l’avoir frappée d’un bruit majestueux, qu’elle nous apprenne qu’ici-bas rien n’est stable, et que tout passe comme un vain son.
« Maintenant, tirez les câbles pour que la cloche sorte de la fosse, et qu’elle s’élève dans l’air, cet empire du bruit. Tirez encore : elle s’ébranle........ elle plane..... elle annonce la joie à notre ville, et ses premiers accents vont proclamer la paix. »
_____
LE PLONGEUR.
[Déjà publié en août 1829 dans La Psyché]
_____
LA PUISSANCE DU CHANT.
Un torrent s’élance à travers les fentes des rochers et vient avec le fracas du tonnerre. Des montagnes en débris suivent son cours, et la violence de ses eaux déracine des chênes : le voyageur, étonné, entend ce bruit avec un frémissement qui n’est pas sans plaisir ; il écoute les flots mugir en tombant du rocher, mais il ignore d’où ils viennent. Ainsi l’harmonie se précipite à grands flots, sans qu’on puisse reconnaître les sources d’où elle découle.
Le poète est l’allié des êtres terribles qui tiennent en main les fils de notre vie ; qui donc pourrait rompre ses nœuds magiques et résister à ses accents ? Il possède le sceptre de Mercure et s’en sert pour guider les âmes : tantôt il les conduit dans le royaume des morts, tantôt il les élève, étonnés, vers le ciel, et les suspend, entre la joie et la tristesse, sur l’échelle fragile des sensations.
Lorsqu’au milieu d’un cercle où règne la gaieté, s’avance tout à coup, et tel qu’un fantôme, l’impitoyable Destin, alors tous les grands de la terre s’inclinent devant cet inconnu qui vient d’un autre monde ; le vain tumulte de la fête s’abat, les masques tombent, et les œuvres du mensonge s’évanouissent devant le triomphe de la vérité.
De même, quand le poète prélude, chacun jette soudain le fardeau qu’il s’est imposé, l’homme s’élève au rang des esprits et se sent transporté jusqu’aux voûtes du ciel ; alors, il appartient tout à Dieu ; rien de terrestre n’ose l’approcher, et toute autre puissance est contrainte de se taire. Le malheur n’a plus d’empire sur lui ; tant que dure la magique harmonie, son front cesse de porter les rides que la douleur y a creusées.
Et, comme après de longs désirs inaccomplis, après une séparation long-temps mouillée de larmes, un fils se jette enfin dans le sein de sa mère, en le baignant des pleurs du repentir, ainsi l’harmonie ramène toujours au toit de ses premiers jours, au bonheur pur de l’innocence, le fugitif qu’avaient égaré des illusions étrangères ; elle le rend à la nature, qui lui tend les bras, pour réchauffer son génie glacé par la contrainte des règles.
_____
PÉGASE MIS AU JOUG.
Dans un marché de chevaux (à Hay-Market, je crois), certain poète affamé mit en vente Pégase, parmi beaucoup d’autres chevaux à vendre.
Le cheval ailé hennissait et se cabrait avec des mouvements majestueux. Tout le monde, l’admirant, s’écriait : « Le noble animal ! quel dommage qu’une inutile paire d’ailes dépare sa taille élancée !... Il serait l’ornement du plus bel attelage. La race en est rare, car personne n’est tenté de voyager dans les airs. » Et chacun craignait d’exposer son argent à un pareil achat ; un fermier en eut envie. « Il est vrai, dit-il, que ses ailes ne peuvent servir à rien ; mais, en les attachant ou en les coupant, ce cheval sera toujours bon pour le tirage. J’y risquerais bien vingt livres. » Le poète, ravi, lui frappe dans la main. « Un homme n’a qu’une parole ! » s’écrie-t-il, et maître Jean part gaiement avec son emplette.
Le noble cheval est attelé, mais à peine sent-il une charge inconnue, qu’il s’élance indigné, et, d’une secousse impétueuse, jette le chariot dans un fossé. « Oh ! oh ! dit maître Jean, ce cheval est trop vif pour ne mener qu’une charrette. Expérience vaut science ; demain, j’ai des voyageurs à conduire, je l’attellerai à la voiture ; il est assez fort pour me faire le service de deux autres chevaux, et sa fougue passera avec l’âge. »
D’abord tout alla bien ; le léger coursier communiquait son ardeur à l’indigne attelage dont il faisait partie, et la voiture volait comme un trait. Mais qu’en arriva-t-il ? Les yeux fixés au ciel et peu accoutumé à cheminer d’un pas égal, il abandonne bientôt la route tracée, et, n’obéissant plus qu’à sa nature, il se précipite parmi les marais, les champs et les broussailles ; la même fureur s’empare des autres chevaux ; aucun cri, aucun frein ne peut les arrêter, jusqu’à ce que la voiture, après mainte culbute, aille enfin, au grand effroi des voyageurs, s’arrêter toute brisée au sommet d’un mont escarpé.
« Je ne m’y suis pas bien pris, dit maître Jean un peu pensif, ce moyen-là ne réussira jamais ; il faut réduire cet animal furieux par la faim et par le travail. » Nouvel essai. Trois jours après déjà, le beau Pégase n’est plus qu’une ombre. « Je l’ai trouvé ! s’écrie notre homme ; allons ! qu’il tire la charrue avec le plus fort de mes bœufs. »
Aussitôt fait que dit ; la charrue offre aux yeux l’attelage risible d’un bœuf et d’un cheval ailé. Indigné, ce dernier fait d’impuissants efforts pour reprendre son vol superbe, mais en vain ; son compagnon n’en va pas plus vite, et le divin coursier est obligé de se conformer à son pas, jusqu’à ce que, épuisé par une longue résistance, la force abandonne ses membres, et que, accablé de fatigue, il tombe et roule à terre.
« Méchant animal, crie maître Jean l’accablant d’injures et de coups, tu n’es pas même bon pour labourer mon champ ! Maudit soit le fripon qui t’a vendu à moi ! » Tandis que le fouet servait de conclusion à sa harangue, un jeune homme vif et de bonne humeur vient à passer sur la route ; une lyre résonne dans ses mains, et parmi ses cheveux blonds éclate une bandelette d’or. « Que veux-tu faire, dit-il, mon ami, d’un attelage aussi singulier ? Que signifie cette union bizarre d’un bœuf et d’un oiseau ? Veux-tu me confier un instant ton cheval à l’essai, et tu verras un beau prodige. »
Le cheval est dételé, et le jeune homme saute sur sa croupe en souriant. A peine Pégase reconnaît-il la main du maître, qu’il mord fièrement son frein, prend son essor et lance des éclairs de ses yeux divins. Ce n’est plus un cheval, c’est un dieu qui s’élève au ciel avec majesté, et, déployant ses ailes, se perd bientôt parmi les espaces azurés, où les yeux des humains ne peuvent plus le suivre.
_____
A GOËTHE,
lorsqu’il traduisit pour le théâtre le Mahomet de Voltaire.
Et toi aussi, qui nous avais arrachés au joug des fausses règles pour nous ramener à la vérité et à la nature ; toi, Hercule au berceau, qui étouffas de tes mains d’enfant les serpents enlacés autour de notre génie, toi, depuis si long-temps, ministre d’un art tout divin, tu vas sacrifier sur les autels détruits d’une muse que nous n’adorons plus !
Ce théâtre n’est consacré qu’à la muse nationale, et nous n’y servirons plus des divinités étrangères ; nous pouvons maintenant montrer avec orgueil un laurier qui a fleuri de lui-même sur notre Parnasse. Le génie allemand a osé pénétrer dans le sanctuaire des arts, et, à l’exemple des Grecs et des Bretons, il a brigué des palmes incueillies.
N’essaie donc pas de nous rendre nos anciennes entraves par cette imitation d’un drame du temps passé ; ne nous rappelle pas les jours d’une minorité dégradante... Ce serait une tentative vaine et méprisable que de vouloir arrêter la roue du temps qu’entraînent les heures rapides ; le présent est à nous, le passé n’est plus.
Notre théâtre s’est élargi ; tout un monde s’agite à présent dans son enceinte ; plus de conversations pompeuses et stériles ; une fidèle image de la nature, voilà ce qui a droit d’y plaire. L’exagération des mœurs dramatiques en a été bannie, le héros pense et agit comme un homme qu’il est ; la passion élève librement la voix, et le beau ne prend sa source que dans le vrai.
Cependant, le chariot de Thespis est légèrement construit : il est comme la barque de l’Achéron qui ne pouvait porter que des ombres et de vaines images ; en vain la vie réelle se presse d’y monter, son poids ruinerait cette légère embarcation, qui n’est propre qu’à des esprits aériens ; jamais l’apparence n’atteindra entièrement la réalité ; où la nature se montre, il faut que l’art s’éloigne.
Ainsi, sur les planches de la scène, un monde idéal se déploiera toujours ; il n’y aura rien de réel que les larmes, et l’émotion n’y prendra point sa source dans l’erreur des sens. La vraie Melpomène est sincère ; elle ne nous promet rien qu’une fable, mais elle sait s’y attacher une vérité profonde ; la fausse nous promet la vérité, mais elle manque à sa parole.
L’art menaçait de disparaître du théâtre... L’imagination voulait seule établir son empire, et bouleverser la scène comme le monde ; mais le sublime et le vulgaire étaient confondus... L’art n’avait plus d’asile que chez les Français : — mais ils n’en atteindront jamais la perfection ; renfermés dans d’immuables limites, ils s’y maintiendront sans oser les franchir.
La scène est pour eux une enceinte consacrée : de ce magnifique séjour sont bannis les sons rudes et naïfs de la nature ; le langage s’y est élevé jusqu’au chant ; c’est un empire d’harmonie et de beauté ; tout s’y réunit dans une noble symétrie pour former un temple majestueux, dans lequel on ne peut se permettre de mouvements qui ne soient réglés par les lois de la danse.
Ne prenons pas les Français pour modèles : chez eux, l’art n’est point animé par la vie ; la raison, amante du vrai, rejette leurs manières pompeuses, leur dignité affectée.... Seulement, ils nous auront guidés vers le mieux ; ils seront venus, comme un esprit qu’on aurait évoqué, purifier la scène si longtemps profanée, pour en faire le digne séjour de l’antique Melpomène.
_____
LE PARTAGE DE LA TERRE.
« Prenez le monde, dit un jour Jupiter aux hommes du haut de son trône ; qu’il soit à vous éternellement comme fief ou comme héritage ; mais faites-en le partage en frères. »
A ces mots, jeunes et vieux, tout s’apprête et se met en mouvement : le laboureur s’empare des produits de la terre ; le gentilhomme, du droit de chasse dans les bois.
Le marchand prend tout ce que ses magasins peuvent contenir ; l’abbé se choisit les vins les plus exquis ; le roi barricade les ponts et les routes et dit : « Le droit de péage est à moi. »
Le partage était fait depuis long-temps quand le poète se présenta ; hélas ! il n’avait plus rien à y voir, et tout avait son maître.
« Malheur à moi ! Le plus cher de tes enfants doit-il être oublié ?.... » disait-il à Jupiter en se prosternant devant son trône.
« Si tu t’es trop long-temps arrêté au pays des chimères, répondit le dieu, qu’as-tu à me reprocher ?... Où donc étais-tu pendant le partage du monde ? — « J’étais près de toi, dit le poète.
« Mon œil contemplait ton visage, mon oreille écoutait ta céleste harmonie ; pardonne à mon esprit, qui, ébloui de ton éclat, s’est un instant détaché de la terre et m’en a fait perdre ma part. »
« Que faire ? dit le dieu. Je n’ai rien à te donner : les champs, les bois, les villes, tout cela ne m’appartient plus ; veux-tu partager le ciel avec moi ? Viens l’habiter, il te sera toujours ouvert. »
_____
LE COMTE D’HABSBOURG.
A Aix-la-Chapelle, au milieu de la salle antique du palais, le roi Rodolphe, dans tout l’éclat de sa puissance impériale, était assis au splendide banquet de son couronnement. Le comte palatin du Rhin servait les mets sur la table ; celui de Bohême versait le vin pétillant, et les sept électeurs, tels que le chœur des étoiles qui tournent autour du soleil, s’empressaient de remplir les devoirs de leur charge autour du maître de la terre.
Et la foule joyeuse du peuple encombrait les hautes galeries ; ses cris d’allégresse s’unissaient au bruit des clairons ; car l’interrègne avait été long et sanglant et un juge venait d’être rendu au monde ; le fer ne frappait plus aveuglément, et le faible, ami de la paix, n’avait plus à craindre les vexations du puissant.
L’empereur saisit la coupe d’or, et, promenant autour de lui des regards satisfaits : « La fête est brillante, le festin splendide, tout ici charme le cœur de votre souverain ; cependant, je n’aperçois point de troubadour qui vienne émouvoir mon âme par des chants harmonieux et par les sublimes leçons de la poésie. Tel a été mon plus vif plaisir de l’enfance, et l’empereur ne dédaigne point ce qui fit le bonheur du chevalier. »
Et voilà qu’un troubadour, traversant le cercle des princes, s’avance vêtu d’une robe traînante ; ses cheveux brillent, argentés par de longues années : — « Dans les cordes dorées de la lyre sommeille une douce harmonie, le troubadour célèbre les aventures des amants, il chante tout ce qu’il y a de noble et de grand sur la terre ; ce que l’âme désire, ce que rêve le cœur ; mais quels chants seraient dignes d’un tel monarque, à sa fête la plus brillante. »
« Je ne prescris rien au troubadour, répond Rodolphe en souriant ; il appartient à un plus haut seigneur, il obéit à l’inspiration : tel que le vent de la tempête dont on ignore l’origine, tel que le torrent dont la source est cachée, le chant d’un poète jaillit des profondeurs de son âme, et réveille les nobles sentiments assoupis dans le fond des cœurs. »
Et le troubadour, saisissant sa lyre, prélude par des accords puissants. « Un noble chevalier chassait dans les bois le rapide chamois ; un écuyer le suivait, portant les armes de la chasse ; et, au moment que le chevalier, monté sur son fier coursier, allait entrer dans la prairie, il entend de loin tinter une clochette.... C’était un prêtre précédé de son clerc, et portant le corps du Seigneur. »
« Et le comte mit pied à terre, se découvrit humblement la tête, et adora avec une foi pieuse le Sauveur de tous les hommes. Mais un ruisseau qui traversait la prairie, grossi par les eaux d’un torrent, arrêta les pas du prêtre, qui déposa à terre l’hostie sainte et s’empressa d’ôter sa chaussure afin de traverser le ruisseau.
« Que faites-vous ? s’écria le comte avec surprise. — Seigneur, je cours chez un homme mourant qui soupire après la céleste nourriture, et je viens de voir, à mon arrivée, la planche qui servait à passer le ruisseau céder à la violence des vagues. Mais il ne faut pas que le mourant perde l’espérance du salut, et je vais nu-pieds parcourir le courant. »
« Alors le puissant comte le fait monter sur son beau cheval, et lui présente la bride éclatante ; ainsi le prêtre pourra consoler le malade qui l’attend et ne manquera pas à son devoir sacré. Et le chevalier poursuit sa chasse monté sur le cheval de son écuyer, tandis que le ministre des autels achève son voyage : le lendemain matin, il ramène au comte son cheval, qu’il tient modestement en laisse, en lui exprimant sa reconnaissance. »
« Que Dieu me garde, s’écrie le comte avec humilité, de reprendre jamais pour le combat ou pour la chasse un cheval qui a porté mon Créateur ! Si vous ne pouvez le garder pour vous-même, qu’il soit consacré au service divin ; car je l’ai donné à celui dont je tiens l’honneur, les biens, le corps, l’âme et la vie. »
— « Hé bien ! que puisse Dieu, le protecteur de tous, qui écoute les prières du faible, vous honorer dans ce monde et dans l’autre comme aujourd’hui vous l’honorez ! Vous êtes un puissant comte, célèbre par ses exploits dans la Suisse ; six aimables filles fleurissent autour de vous : puissent-elles, ajouta-t-il avec inspiration, apporter six couronnes dans votre maison et perpétuer votre race éclatante ! »
Et l’empereur, assis, méditait dans son esprit et semblait se reporter à des temps déjà loin.... Tout à coup il fixe attentivement les traits du troubadour ; frappé du sens de ses paroles, il reconnaît en lui le prêtre, et cache avec son manteau de pourpre les larmes qui viennent baigner son visage. Tous les regards se portent alors sur le prince : ce qu’on vient d’entendre n’est plus un mystère, et chacun bénit les décrets de la Providence.
_____
LE COMMENCEMENT DU XIXe SIÈCLE.
A***
O mon noble ami ! où se réfugieront désormais la paix et la liberté ? Un siècle vient de s’éteindre au sein d’une tempête, un siècle nouveau s’annonce par la guerre.
Tous liens sont rompus entre les nations, et toutes les vieilles institutions s’écroulent..... Le vaste Océan n’arrête point les fureurs de la guerre ; le dieu du Nil et le vieux Rhin ne peuvent rien contre elles.
Deux puissantes nations combattent pour l’empire du monde ; et, pour anéantir les libertés des peuples, le trident et la foudre s’agitent dans leurs mains.
Chaque contrée leur doit de l’or : et comme Brennus, aux temps barbares, le Français jette son glaive d’airain dans la balance de la justice.
L’Anglais, tel que le polype aux cent bras, couvre la mer de ses flottes avides, et veut fermer, comme sa propre demeure, le royaume libre d’Amphitrite.
Les étoiles du sud, encore inaperçues, s’offrent à sa course infatigable ; il découvre les îles, les côtes les plus lointaines..... mais le bonheur, jamais !
Hélas ! en vain chercherais-tu sur toute la surface de la terre un pays où la liberté fleurisse éternelle, où l’espèce humaine brille encore de tout l’éclat de la jeunesse.
Un monde sans fin s’ouvre à toi ; ton vaisseau peut à peine en mesurer l’espace ; et, dans toute cette étendue, il n’y a point de place pour dix hommes heureux !
Il faut fuir le tumulte de la vie et te recueillir dans ton cœur...... La liberté n’habite plus que le pays des chimères ; le beau n’existe plus que dans la poésie.
_____
LE DRAGON DE RHODES.
Où court ce peuple ? qu’a-t-il à se précipiter en hurlant dans les rues ? Rhodes est-elle la proie des flammes ?.... La foule semble encore s’accroître, et j’aperçois au milieu d’elle un guerrier à cheval. Derrière lui.... ô surprise ! on traîne un animal dont le corps est d’un dragon, et la gueule d’un crocodile, et tous les yeux se fixent avec étonnement, tantôt sur le monstre, tantôt sur le chevalier.
Et mille voix s’écrient : « Voilà le dragon..... venez-le voir !..... qui dévorait les troupeaux et les bergers ! Voilà le héros qui en a triomphé ! Bien d’autres sont partis pour cette périlleuse entreprise, mais aucun n’en était revenu..... Honneur au vaillant chevalier ! » — Et la foule se dirige vers le couvent où les chevaliers de Saint-Jean se sont à la hâte rassemblés en conseil.
Et le jeune homme pénètre avec peine dans la salle à travers les flots du peuple qui l’obstruaient, s’avance d’un air modeste vers le grand-maître, et prend ainsi la parole : « J’ai rempli mon devoir de chevalier ; le dragon qui dévastait le pays gît abattu par ma main ; les chemins n’offrent plus de dangers aux voyageurs ; le berger peut sans crainte faire paître ses troupeaux ; le pèlerin peut aller paisiblement dans les rochers visiter la sainte chapelle. »
Le grand-maître lui lance un regard sévère : « Tu as agi comme un héros, lui dit-il ; la bravoure honore les chevaliers, et tu en as fait preuve.... Dis-moi, cependant : quel est le premier devoir de celui qui combat pour le Christ et qui se pare d’une croix ? » Tous les assistants pâlissent ; mais le jeune homme s’incline en rougissant, et répond avec une noble contenance : « L’obéissance est son premier devoir, celui qui le rend digne d’une telle distinction. » — « Et ce devoir, mon fils, répond le grand-maître, tu l’as violé, quand ta coupable audace attaqua le dragon, au mépris de mes ordres. » — « Seigneur, jugez-moi seulement d’après l’esprit de la loi, car j’ai cru l’accomplir ; je n’ai pas entrepris sans réfléchir une telle expédition, et j’ai plutôt employé la ruse que la force pour vaincre le dragon.
« Cinq chevaliers, l’honneur de notre ordre et de la religion, avaient déjà péri victimes de leur courage, lorsque vous nous défendîtes de tenter le même combat. Cependant, ce désir me rongeait le cœur et me remplissait de mélancolie. La nuit, des songes m’en retraçaient l’image, et, quand le jour venait éclairer de nouvelles dévastations, une ardeur sauvage s’emparait de moi, au point que je résolus enfin d’y hasarder ma vie.
« Et je me disais à moi-même : D’où naît la gloire, noble parure des hommes ? Qu’ont-ils fait, ces héros chantés des poètes, et que l’antiquité élevait au rang des dieux ? Ils ont purgé la terre de monstres, combattu des lions, lutté avec des minotaures, pour délivrer de faibles victimes, et jamais ils n’ont plaint leur sang.
« Les chevaliers ne peuvent-ils combattre que des Sarrasins, ou détrôner que des faux dieux ? N’ont-ils pas été envoyés à la terre comme libérateurs, pour l’affranchir de tous ses maux et de tous ses ennemis ? Cependant, la sagesse doit guider leur courage, et l’adresse suppléer à la force. » Ainsi me parlais-je souvent, et je cherchais seul à reconnaître les lieux habités par le monstre ; enfin mon esprit m’offrit un moyen de l’attaquer, et je m’écriai, plein de joie : Je l’ai trouvé !
« Et, me présentant à vous, je vous témoignai le désir de revoir ma patrie ; vous accédâtes à ma prière ; je fis une heureuse traversée, et, de retour à peine dans mon pays, je fis exécuter par un habile ouvrier l’image fidèle du dragon. C’était bien lui : son long corps pesait sur des pieds courts et difformes ; son dos se recouvrait horriblement d’une cuirasse d’écailles.
« Son col était d’une longueur effrayante et sa gueule s’ouvrait pour saisir ses victimes, hideuse comme une porte de l’enfer, armée de dents qui éclataient blanches sur le gouffre sombre de son gosier et d’une langue aiguë comme la pointe d’une épée ; ses petits yeux lançaient d’affreux éclairs, et, au bout de cette masse gigantesque, s’agitait la longue queue en forme de serpent dont il entortille les chevaux et les hommes.
« Tout cela, exécuté en petit et peint d’une couleur sombre, figurait assez bien le monstre, moitié serpent, moitié dragon, au sein de son marais empoisonné ; et, quand tout fut terminé, je choisis deux dogues vigoureux, agiles, accoutumés à chasser les bêtes sauvages ; je les lançai contre le monstre, et ma voix les excitait à le mordre avec fureur de leurs dents acérées.
« Il est un endroit où la poitrine de l’animal dégarnie d’écailles ne se recouvre que d’un poil léger, c’est là surtout que je dirige leurs morsures ; moi-même, armé d’un trait, je monte mon coursier arabe et d’une noble origine, j’excite son ardeur en le pressant de mes éperons, et je jette ma lance à cette vaine image, comme si je voulais la percer.
« Mon cheval se cabre effrayé, hennit, blanchit son mors d’écume, et mes dogues hurlent de crainte à cette vue.... Je ne prends point de repos qu’ils ne s’y soient accoutumés. Trois mois s’écoulent et, lorsque je les vois bien dressés, je m’embarque avec eux sur un vaisseau rapide. Arrivé ici depuis trois jours, j’ai pris à peine le temps nécessaire pour reposer mes membres fatigués jusqu’au moment de l’entreprise.
« Mon cœur fut vivement touché des nouveaux désastres de ce pays, que j’appris à mon arrivée ; de la mort surtout de ces bergers qui s’étaient égarés dans la forêt et qu’on retrouva déchirés ; je ne pris plus dès lors conseil que de mon courage, et je résolus de ne pas différer plus longtemps. J’en instruisis soudain mes écuyers, je montai sur mon bon cheval, et, accompagné de mes chiens fidèles, je courus par un chemin détourné et en évitant tous les yeux, à la rencontre de l’ennemi.
« Vous connaissez, seigneur, cette chapelle élevée par un de vos prédécesseurs sur le rocher où l’on découvre toute l’île : son extérieur est humble et misérable, et cependant elle renferme une merveille de l’art : la sainte vierge et son fils adoré par les trois rois. Le pèlerin, parvenu au faîte du rocher par trois fois trente marches, se repose enfin près de son Créateur, en contemplant avec satisfaction l’espace qu’il a parcouru.
« Il est au pied du rocher une grotte profonde, baignée des flots de la mer voisine, où jamais ne pénètre la lumière du ciel ; c’est là qu’habitait le reptile et qu’il était couché nuit et jour, attendant sa proie : ainsi veillait-il comme un dragon de l’enfer au pied de la maison de Dieu, et, si quelque pèlerin s’engageait dans ce chemin fatal, il se jetait sur lui et l’emportait dans son repaire.
« Avant de commencer l’effroyable combat, je gravis le rocher, je m’agenouille devant le Christ, et, ayant purifié mon cœur de toute souillure, je revêts dans le sanctuaire mes armes éclatantes : j’arme ma droite d’une lance, et je descends pour combattre. Puis, laissant en arrière mes écuyers, à qui je donne mes derniers ordres, je m’élance sur mon cheval en recommandant mon âme à Dieu.
« A peine suis-je en plaine, que mes chiens poussent des hurlements, et mon cheval commence à se cabrer d’effroi.... C’est qu’ils ont vu tout près la forme gigantesque de l’ennemi, qui, ramassé en tas, se réchauffait à l’ardeur du soleil. Les dogues rapides fondent sur lui ; mais ils prennent bientôt la fuite, en le voyant ouvrir sa gueule haletante d’une vapeur empoisonnée, et pousser le cri du chacal.
« Cependant, je parviens à ranimer leur courage ; ils retournent au monstre avec une ardeur nouvelle, tandis que, d’une main hardie, je lui lance un trait dans le flanc. Mais, repoussée par les écailles, l’arme tombe à terre sans force, et j’allais redoubler, lorsque mon coursier, qu’épouvantait le regard de feu du reptile et son haleine empestée, se cabra de nouveau, et c’en était fait de moi,
« Si je ne me fusse jeté vite à bas de cheval. Mon épée est hors du fourreau ; mais tous mes coups sont impuissants contre le corselet d’acier du reptile. Un coup de queue m’a déjà jeté à terre, sa gueule s’ouvre pour me dévorer.... quand mes chiens s’élancent sur lui avec rage, le forcent à lâcher prise, et lui font pousser d’horribles hurlements, déchiré qu’il est par leurs morsures.
« Et avant qu’il se soit débarrassé de leur attaque, je lui plonge dans la gorge mon glaive jusqu’à la poignée. Un fleuve de sang impur jaillit de sa plaie ; il tombe et m’entraîne avec lui, enveloppé dans les nœuds de son corps. — C’est alors que je perdis connaissance, et, lorsque je revins à la vie, mes écuyers m’entouraient, et le dragon gisait étendu dans son sang. »
A peine le chevalier eut-il achevé, que des cris d’admiration long-temps comprimés s’élancèrent de toutes les bouches, et que des applaudissements cent fois répétés éclatèrent longtemps sous les voûtes sonores : les guerriers de l’ordre demandèrent même à haute voix que l’on décernât une couronne au héros ; le peuple, reconnaissant, voulait le porter en triomphe.... Mais le grand-maître, sans dérider son front, commanda le silence.
« Tu as, dit-il, frappé d’une main courageuse le dragon qui dévastait ces campagnes ; tu es devenu un dieu pour le peuple... mais, pour notre ordre, un ennemi ! et tu as enfanté un monstre bien autrement fatal que n’était celui-ci.... Un serpent qui souille le cœur, qui produit la discorde et la destruction, en un mot, la désobéissance ! Elle hait toute espèce de subordination, brise les liens sacrés de l’ordre, et fait le malheur de ce monde.
« Le Turc est brave comme nous... c’est l’obéissance qui doit nous distinguer de lui : c’est dans les mêmes lieux où le seigneur est descendu de toute sa gloire à l’état abject d’un esclave, que les premiers de cet ordre l’ont fondé afin de perpétuer un tel exemple : l’abnégation de toutes nos volontés, devoir qui est le plus difficile de tous, a été la base de leur institution ! — Une vaine gloire t’a séduit.... Ote toi de ma vue... Celui qui ne peut supporter le joug du Seigneur n’est pas digne de se parer de sa croix. »
La foule à ces mots s’agite en tumulte et remplit le palais d’impétueux murmures. Tous les chevaliers demandent en pleurant la grâce de leur frère.... Mais celui-ci, les yeux baissés, dépouille en silence l’habit de l’ordre, baise la main sévère du grand-maître, et s’éloigne. Le vieillard le suit quelque temps des yeux, puis, le rappelant du ton de l’amitié : « Embrasse-moi, mon fils ! tu viens de remporter un combat plus glorieux que le premier : prends cette croix ; elle est la récompense de cette humilité qui consiste à se vaincre soi-même. »
_____
JEANNE D’ARC.
Le démon de la raillerie l’a traînée dans la poussière pour souiller la plus noble image de l’humanité. L’esprit du monde est éternellement en guerre avec tout ce qu’il y a de beau et de grand : il ne croit ni à Dieu ni aux esprits célestes, il veut ravir au cœur tous ses trésors, il anéantit toutes les croyances en attaquant toutes les illusions.
Mais la poésie, d’humble naissance comme toi, est aussi une pieuse bergère ; elle te couvre de tous les privilèges de sa divinité, elle t’environne d’un cortège d’étoiles, et répand la gloire autour de toi.... O toi que le cœur a faite ce que tu es, tu vivras immortelle !
Le monde aime à obscurcir tout ce qui brille, à couvrir de fange tout ce qui s’élève. Mais ne crains rien ! il y a encore de bons cœurs qui tressaillent aux actions sublimes et généreuses ; Momus fait les délices de la multitude, un noble esprit ne chérit que les nobles choses.
_____
LE GANT.
Le roi de France assistait à un combat de bêtes féroces, entouré des grands de sa cour, et un cercle brillant de femmes décorait les hautes galeries.
Le prince fait un signe : une porte s’ouvre, un lion sort d’un pas majestueux. Muet, il promène ses regards autour de lui, ouvre une large gueule, secoue sa crinière, allonge ses membres, et se couche à terre.
Et le prince fait un nouveau signe : une seconde porte s’ouvre aussitôt ; un tigre en sort en bondissant ; à la vue du lion, il jette un cri sauvage, agite sa queue en formidables anneaux, décrit un cercle autour de son ennemi, et vient enfin, grondant de colère, se coucher en face de lui.
Le roi fait un signe encore : les deux portes se rouvrent et vomissent deux léopards. Enflammés de l’ardeur de combattre, ils se jettent sur le tigre, qui les saisit de ses griffes cruelles. Le lion lui-même se lève en rugissant, puis se tait, et alors commence une lutte acharnée entre ces animaux avides de sang.
Tout à coup un gant tombe du haut des galeries, lancé par une belle main, entre le lion et le tigre, et la jeune Cunégonde, se tournant d’un air railleur vers le chevalier Delorge : « Sire chevalier, prouvez-moi donc ce profond amour que vous me jurez à toute heure en m’allant relever ce gant. »
Et le chevalier se précipite dans la formidable arène, et d’une main hardie va ramasser le gant au milieu des combattants.
Tous les yeux se promènent de la dame au chevalier avec étonnement, avec effroi... Celui-ci revient paisiblement vers Cunégonde, et de toutes les bouches sort un murmure d’admiration. La dame le reçoit avec un doux sourire, présage d’un bonheur assuré.... Mais le chevalier, lui jetant le gant avec dédain : « Point de remerciements, madame ! » Et il la quitte toute confuse d’une telle leçon.
_____
L’IDÉAL.
Tu veux donc, infidèle, te séparer de moi, avec tes douces illusions, tes peines et tes plaisirs ? Rien ne peut arrêter ta fuite, ô temps doré de ma jeunesse ! c’est en vain que je te rappelle.... Tu cours précipiter tes ondes dans la mer de l’éternité !
Ils ont pâli, ces gais rayons qui jadis éclairaient mes pas ; ces brillantes chimères se sont évanouies, qui remplissaient le vide de mon âme : je ne crois plus aux songes que mon sommeil m’offrait si beaux et si divins, la froide réalité les a frappés de mort !
Comme Pigmalion, dans son ardeur brûlante, embrassait un marbre glacé, jusqu’à lui communiquer le sentiment et la vie, je pressais la nature avec tout le feu de la jeunesse, afin de l’animer de mon âme de poète.
Et, partageant ma flamme, elle trouvait une voix pour me répondre, elle me rendait mes caresses, et comprenait les battements de mon cœur : l’arbre, la rose, tout pour moi naissait à la vie, le murmure des ruisseaux me flattait comme un chant, mon souffle avait donné l’existence aux êtres les plus insensibles.
Alors tout un monde se pressait dans ma poitrine, impatient de se produire au jour, par l’action, par la parole, par les images et les chants... Combien ce monde me parut grand tant qu’il resta caché comme la fleur dans son bouton. Mais que cette fleur s’est peu épanouie ! Qu’elle m’a semblé depuis chétive et méprisable !
Comme il s’élançait, le jeune homme, insouciant et léger dans la carrière de la vie ! Heureux de ces rêves superbes, libre encore d’inquiétudes, l’espérance l’emportait aux cieux ; il n’était pas de hauteur, pas de distance que ses ailes ne pussent franchir !
Rien n’apportait d’obstacle à cet heureux voyage, et quelle foule aimable se pressait autour de son char ! L’amour avec ses douces faveurs, le bonheur couronné d’or, la gloire le front ceint d’étoiles, et la vérité toute nue à l’éclat du jour.
Mais hélas ! au milieu de la route, il perdit ces compagnons perfides ; et l’un après l’autre ils s’étaient détournés de lui : le bonheur aux pieds légers avait disparu, la soif du savoir ne pouvait plus être apaisée, et les ténèbres du doute venaient ternir l’image de la vérité.
Je vis les palmes saintes de la gloire prodiguées à des fronts vulgaires ; l’amour s’envola avec le printemps ; le chemin que je suivais devint de jour en jour plus silencieux et plus désert ; à peine si l’espérance y jetait encore quelques vagues clartés.
De toute cette suite bruyante, quelles sont les deux divinités qui me demeurèrent fidèles, qui me prodiguent encore leurs consolations, et m’accompagneront jusqu’à ma dernière demeure ?.... C’est toi, tendre amitié, dont la main guérit toutes les blessures, toi qui partages avec moi le fardeau de la vie, toi que j’ai cherchée de si bonne heure, et qu’enfin j’ai trouvée.
C’est toi aussi, bienfaisante étude, toi qui sérènes les orages de l’âme, qui crées difficilement, mais ne détruis jamais ; toi qui n’ajoutes à l’édifice éternel qu’un grain de sable sur un grain de sable, mais qui sais dérober au temps avare des minutes, des jours et des années !
_____
LA BATAILLE.
Telle qu’un nuage épais et qui porte une tempête, la marche des troupes retentit parmi les vastes campagnes ; une plaine immense s’offre à leurs yeux, c’est là qu’on va jeter les dés d’airain. Tous les regards sont baissés, le cœur des plus braves palpite, les visages sont pâles comme la mort ; voilà le colonel qui parcourt les rangs : — Halte ! — Cet ordre brusque enchaîne le régiment, qui présente un front immobile et silencieux.
Mais qui brille là bas sur la montagne aux rayons pourprés du matin ? Voyez-vous les drapeaux ennemis ? — Nous les voyons ! que Dieu soit avec nos femmes et nos enfants. — Entendez-vous ces chants, ces roulements de tambours, et ces fifres joyeux ? Comme cette belle et sauvage harmonie pénètre tous nos membres et parcourt la moëlle de nos os !
Frères, que Dieu nous protège.... nous nous reverrons dans un autre monde !
Déjà un éclair a lui le long de la ligne de bataille ; un tonnerre sourd l’accompagne, l’action commence, les balles sifflent, les signaux se succèdent.... Ah ! l’on commence à respirer !
La mort plane, le sort se balance indécis.... Les dés d’airain sont jetés au sein de la fumée ardente !
Voilà que les deux armées se rapprochent : — Garde à vous ! crie-t-on de peloton en peloton. le premier rang plie le genou et fait feu... il en est qui ne se relèveront pas. La mitraille trace de longs vides ; le second rang se trouve le premier.... A droite, à gauche, partout la mort : que de légions elle couche à terre !
Le soleil s’éteint, mais la bataille est toute en feu ; la nuit sombre descend enfin sur les armées. — Frères, que Dieu nous protège.... nous nous reverrons dans un autre monde !
De toutes parts le sang jaillit ; les vivants sont couchés avec les morts..... le pied glisse sur les cadavres..... — « Et toi aussi, Franz ! — Mes adieux à ma Charlotte, ami ! (La bataille s’anime de plus en plus.) — Je lui porterai.... Oh ! camarade, vois-tu derrière nous pétiller la mitraille ? — Je lui porterai tes adieux : repose ici.... je cours là bas où il pleut des balles. »
Le sort de la journée est encore douteux ; mais la nuit s’épaissit toujours.... Frères, que Dieu nous protège...... nous nous reverrons dans un autre monde.
Écoutez ! les adjudants passent au galop.... Les dragons s’élancent sur l’ennemi, et les canons se taisent....... — Victoire ! camarades ! la peur s’est emparée des lâches et ils jettent leurs drapeaux !
Le terrible bataille est enfin décidée : le jour triomphe aussi de la nuit ; tambours bruyants, fifres joyeux, célébrez tous notre victoire ! — Adieu, frères que nous laissons...... nous nous reverrons dans un autre monde !
_____
LA CAUTION.
Méros cache un poignard sous son manteau, et se glisse chez Denis de Syracuse : les satellites l’arrêtent et le chargent de chaînes. « Qu’aurais-tu fait de ce poignard ? » lui demande le prince en fureur : « J’aurais délivré la ville d’un tyran ! — Tu expieras ce désir sur la croix . »
— « Je suis prêt à mourir et je ne demande point ma grâce, mais veuille m’accorder un faveur : Trois jours de délai pour unir ma sœur à son fiancé. Mon ami sera ma caution, et si je manque à ma parole, tu pourras te venger sur lui. »
Le roi se mit à rire, et après un instant de réflexion répondit d’un ton moqueur : « Je t’accorde trois jours ; mais songe que si tu n’as pas reparu, ce délai expiré, ton ami prend ta place et je te tiens quitte. »
Méros court chez son ami : « Le roi veut que j’expie sur la croix ma malheureuse tentative ; cependant il m’accorde trois jours pour assister au mariage de ma sœur ; sois ma caution auprès de lui jusqu’à mon retour. »
Son ami l’embrasse en silence et va se livrer au tyran tandis que Méros s’éloigne. Avant la troisième aurore il avait uni sa sœur à son fiancé, et il revenait déjà en grande hâte pour ne pas dépasser le délai fatal.
Mais une pluie continuelle attaque la rapidité de sa marche ; les sources des montagnes se changent en torrents, et des ruisseaux forment des fleuves. Appuyé sur son bâton de voyage, Méros arrive au bord d’une rivière, et voit soudain les grandes eaux rompre le pont qui joignait les deux rives, et en ruiner les arches avec le fracas du tonnerre.
Désolé d’un tel obstacle, il s’agite en vain sur les bords, jette au loin d’impatients regards : point de barque qui se hasarde à quitter la rive pour le conduire où ses désirs l’appellent, point de batelier qui se dirige vers lui, et le torrent s’enfle comme une mer.
Il tombe sur la rive et pleure en levant ses mains au ciel : « O Jupiter, aplanis ces eaux mugissantes ! Le temps fuit, le soleil parvient à son midi, s’il va plus loin, j’arriverai trop tard pour délivrer mon ami ! »
La fureur des vagues ne fait que s’accroître, les eaux poussent les eaux, et les heures chassent les heures.... Méros n’hésite plus ; il se jette au milieu du fleuve irrité, il lutte ardemment avec lui.... Dieu lui accorde la victoire.
Il a gagné l’autre rive, il précipite sa marche en rendant grâce au ciel... quand tout à coup, du plus épais de la forêt, une bande de brigands se jette sur lui, avide de meurtre, et lui ferme le passage avec des massues menaçantes.
— « Que me voulez-vous ? Je ne possède que ma vie, et je la dois au roi, à mon ami que je cours sauver !... » Il dit, saisit la massue du premier qui l’approche ; trois brigands tombent sous ses coups et les autres prennent la fuite.
Le soleil est brûlant, Méros sent ses genoux se dérober sous lui brisés par la fatigue : « O toi, qui m’as sauvé de la main des brigands et de la fureur du fleuve, me laisseras-tu périr ici en trahissant celui qui m’aime ?
« Qu’entends-je ? serait-ce un ruisseau que m’annonce ce doux murmure ? » Il s’arrête, il écoute, une source joyeuse et frétillante a jailli d’un rocher voisin : le voyageur se baisse ivre de joie, et rafraîchit son corps brûlant.
Et déjà le soleil, en jetant ses regards à travers le feuillage, dessine le long du chemin les formes des arbres avec des ombres gigantesques : deux voyageurs passent, Méros les devance bientôt, mais les entend se dire entre eux : « A cette heure, on le met en croix ! »
Le désespoir lui donne des ailes, la crainte l’aiguillonne encore.... Enfin les tours lointaines de Syracuse apparaissent aux rayons du soleil couchant ; il rencontre bientôt Philostrate, le fidèle gardien de sa maison, qui le reconnaît et frémit.
« Fuis donc ! il n’est plus temps de sauver ton ami ; sauve du moins ta propre vie... En ce moment il expire : d’heure en heure il t’attendait sans perdre l’espoir, et les railleries du tyran n’avaient pu ébranler sa confiance en toi. »
« Hé bien, si je ne puis le sauver, je partagerai du moins son sort : que le sanguinaire tyran ne puisse pas dire qu’un ami a trahi son ami ; qu’il frappe deux victimes, et croie encore à la vertu ! »
Le soleil s’éteignait, quand Méros parvient aux portes de la ville ; il aperçoit l’échafaud et la foule qui l’environne ; on enlevait déjà son ami avec une corde pour le mettre en croix : — « Arrête, bourreau, me voici ! cet homme était ma caution ! »
Le peuple admire.... Les deux amis s’embrassent en pleurant, moitié douleur et moitié joie ; nul ne peu être insensible à un tel spectacle ; le roi lui-même apprend avec émotion l’étonnante nouvelle et les fait amener devant son trône.
Long-temps il les considère avec surprise : « Votre conduite a subjugué mon cœur.... La foi n’est donc pas un vain mot... J’ai à mon tour une prière à vous adresser... Daignez m’admettre à votre union, et que nos trois cœurs n’en forment plus qu’un seul. »
_____
DÉSIR.
Ah ! s’il était une issue pour m’élancer hors de ce vallon où pèse un brouillard glacé, quelle serait ma joie !.... Là bas, j’aperçois de riantes collines, décorées d’une jeunesse et d’une verdure éternelles : oh ! si j’étais oiseau, si j’avais des ailes, je m’en irais là bas sur ces collines !
D’étranges harmonies viennent parfois retentir à mon oreille, échappées des concerts de ce monde enchanté : les vents légers m’en apportent souvent de suaves parfums ; j’y vois briller des fruits d’or au travers de l’épais feuillage, et des plantes fleuries qui ne craignent rien des rigueurs de l’hiver.
Ah ! que la vie doit s’écouler heureuse sur ces collines dorées d’un soleil éternel ! que l’air y doit être doux à respirer ! mais les vagues furieuses d’un torrent m’en défendent l’accès et leur vue pénètre mon âme d’effroi.
Une barque cependant se balance près du bord : mais, hélas ! point de pilote pour la conduire ! — N’importe, entrons-y sans crainte, ses voiles sont déployées.... il faut espérer, il faut oser ; car les dieux ne garantissent le succès d’aucune entreprise, et un prodige seul peut me faire arriver dans ce beau pays des prodiges.
_____
COLOMB.
Courage, brave navigateur ! la raillerie peut attaquer tes espérances, les bras de tes marins peuvent tomber de fatigue....... Va toujours ! toujours au couchant ! Ce rivage que tu as deviné, il t’apparaîtra bientôt dans toute sa splendeur. Mets ta confiance dans le Dieu qui te guide, et avance sans crainte sur cette mer immense et silencieuse. — Si ce monde n’existe pas, il va jaillir des flots exprès pour toi : car il est un lien éternel entre la nature et le génie, qui fait que l’une tient toujours ce que l’autre promet.
_____
LA GRANDEUR DU MONDE.
Je veux parcourir avec l’aile des vents tout ce que l’Éternel a tiré du chaos ; jusqu’à ce que j’atteigne aux limites de cette mer immense et que je jette l’ancre là où l’on cesse de respirer, où Dieu a posé les bornes de la création !
Je vois déjà de près les étoiles dans tout l’éclat de leur jeunesse, je les vois poursuivre leur course millénaire à travers le firmament, pour atteindre au but qui leur est assigné ; je m’élance plus haut.... Il n’y a plus d’étoiles !
Je me jette courageusement dans l’empire immense du vide, mon vol est rapide comme la lumière.... Voici que m’apparaissent de nouveaux nuages, un nouvel univers et des terres et des fleuves...
Tout à coup, dans un chemin solitaire, un pèlerin vient à moi : — « Arrête, voyageur, où vas-tu ? — Je marche aux limites du monde, là où l’on cesse de respirer, où Dieu a posé les bornes de la création ! »
— « Arrête ! tu marcherais en vain : l’infini est devant toi ! » — O ma pensée, replie donc tes ailes d’aigle ! et toi audacieuse imagination, c’est ici, hélas ! ici qu’il faut jeter l’ancre !
_____
ADIEUX AU LECTEUR.
Ma muse se tait, et sent la rougeur monter à ses joues virginales ; elle s’avance vers toi pour entendre ton jugement, qu’elle recevra avec respect, mais sans crainte. Elle désire obtenir les suffrages de l’homme vertueux, que la vérité touche, et non un vain éclat ; celui qui porte un cœur capable de comprendre les impressions d’une poésie élevée, celui-là seul est digne de la couronner.
Ces chants auront assez vécu, si leur harmonie peut réjouir une âme sensible, l’environner d’aimables illusions et lui inspirer de hautes pensées ; ils n’aspirent point aux âges futurs ; ils ne résonnent qu’une fois sans laisser d’échos dans le temps ; le plaisir du moment les fait naître, et les heures vont les emporter dans leur cercle léger.
Ainsi le printemps se réveille : dans tous les champs que le soleil échauffe, il répand une existence jeune et joyeuse ; l’aubépine livre au vent ses parfums ; le brillant concert des oiseaux monte jusqu’au ciel ; tous les sens, tous les êtres partagent la commune ivresse... Mais dès que le printemps s’éloigne, les fleurs tombent à terre fanées, et pas une ne demeure de toutes celles qu’il avait fait naître.
_______