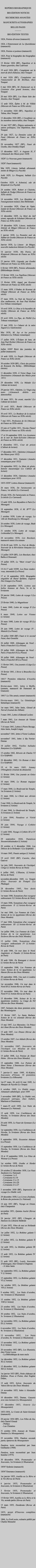22 novembre 1846 — Un tour dans le Nord [IV], dans L’Artiste-Revue de Paris, 4e série, t. VIII, p. 37-41, signé Gérard de Nerval.
Cette quatrième et dernière livraison de Un tour dans le Nord est la reprise de Une journée à Liège, publié le 11 février 1841 dans La Presse, de L’Hiver à Bruxelles, publié le 18 février 1841 dans La Presse, et de Les Délices de la Hollande publié le 8 décembre 1844 dans La Sylphide. Elle ne sera pas reprise en volume.
******
UN TOUR DANS LE NORD.
Il me reste à parler des chambres, conseils et autres élémens de la machine représentative. Mais avant d’entrer à l’Hôtel-de-Ville où se tient le grand conseil communal, arrêtons-nous un peu au carrefour d’une rue écartée, située à quelque distance de ce monument. Là est une bizarre statue servant de fontaine publique, et qui représente un enfant nu ; elle est en bronze noirci par le temps, posée sur une coquille de marbre, et dans une attitude assez triviale. C’est l’illustre Mannekenpis, dit le premier bourgeois de Bruxelles. On sait que cette figure est le palladium de Bruxelles, enlevé et caché plusieurs fois par des mains ennemies, et toujours miraculeusement rapporté sur son piédestal. Le Mannekenpis a eu toutes les aventures du Bambino de Naples, et ne présente toutefois aucun caractère religieux. Plusieurs souverains se sont plu à combler de faveurs ce personnage symbolique et difficilement définissable. Charles-Quint lui a donné la noblesse ; Louis XIV l’a fait chevalier de Saint-Louis ; Napoléon l’a créé chambellan. Son costume actuel, qu’il ne revêt que dans les grandes fêtes, est celui d’officier de la garde civique ; le Mannekenpis est partisan de tous les régimes ; pourtant ce symbole de l’esprit bourgeois n’a point cessé d’être populaire.
En entrant dans l’Hôtel-de-Ville on se trouve au milieu d’une belle cour carrée ornée de groupes de sculpture en bronze et en marbre, dans le goût du XVIIe siècle. Au premier étage sont les vastes salles où régna tant de siècles cette fière bourgeoisie des Flandres, souvent asservie, rarement domptée. Que de révoltes, que de supplices sur cette place du Grand-Marché, que nous avons décrite ! que de drames républicains dans ces salles dorées comme le vieux Versailles, et que Louis XIV, Marie-Thérèse et Napoléon ont vues tour à tour telles qu’elles sont aujourd’hui. Les plafonds et les tapisseries présentent une foule de sujets historiques et allégoriques, qui rappellent la gloire des Provinces-Unies. Les panneaux et les frises, splendidement dorés, ont conservé tout leur éclat ; les hautes cheminées chargées de glaces, d’attributs et de rocailles, n’ont subi aucune altération ; le goût misérable, l’économie de notre époque, ne paraît que dans la forme des chaises et dans l’étoffe des rideaux de calicot rouge à bordure imprimée. Ensuite imaginez une trentaine de messieurs fort laids, en habits, redingotes et paletots, assis autour d’une grande table verte et discutant sur la nécessité de rebâtir un Palais-de-Justice à colonnes et fronton triangulaire, construit depuis vingt ans selon les règles de Vignole, et qui déjà menace ruine, discutant cela dans un édifice du XIIe siècle et se querellant sur des centimes devant ces grands portraits qui les regardent en pitié. Voilà une séance de ce conseil municipal. Le public, rangé sur des chaises le long des murs, ne voit que le dos et les toupets divers de ces illustres citoyens, qui lisent des discours fort longs ou se livrent à des improvisations fort lentes. Du reste, la ville n’a point de bourgmestre pour le moment ; le buste d’un nommé Rouppe, qui a été le dernier bourgmestre de Bruxelles, jette sur l’assemblée des regards paternels.
Pour en finir avec les institutions politiques du pays, remontons la rue de la Madeleine et la Montagne de la Cour, traversons le parc dont les vieux arbres firent partie de l’antique forêt de Soignes, qui jadis couvrait le pays ; nous trouverons, dans l’intérieur du palais dit de la Nation, les deux autres machines à lois fonctionnant vers la même heure : la chambre des sénateurs et la chambre des représentans.
Par un vestibule bien chauffé et tapissé, on monte à une tribune drapée de calicot rouge, et pavoisée de trois étendards tricolores belges, c’est-à-dire jaune, noir et rouge. Il faut avouer que ces trois couleurs s’harmonisent mieux au point de vue de l’ornementation, que nos couleurs françaises, bien qu’elles offrent presque la combinaison des nuances de l’arlequin. De la tribune où nous sommes, l’œil plonge sur une salle de médiocre grandeur, décorée dans le style de l’empire et autour de laquelle règne une table verte en fer à cheval. Une cinquantaine d’hommes mûrs sont rangés autour de cette table dont le milieu reste vide ; ils lisent, causent et discutent entre eux. Là les discours sont rares et les questions doivent se résoudre plus aisément qu’ailleurs. Cette assemblée n’étant du reste remarquable que par une profusion de calicot rouge fatigante pour l’œil, nous allons traverser le palais pour passer à la chambre des représentans.
C’est notre chambre des députés, un peu moins riche, un peu moins dorée, avec ses divisions, son président, ses questeurs, avec moins de députés et plus de places pour le public. Les orateurs parlent de leur place, bien qu’il y ait une fort belle tribune d’acajou ; et, quand la nuit arrive, on distribue partout des bougies, qui font ressembler l’amphithéâtre à un ciel étoilé. Le banc des ministres est garni de personnages assez majestueux. Il est souvent d’autant plus difficile à ces messieurs de s’entendre, que beaucoup viennent de certaines provinces où l’on parle peu le français. J’ai été témoin de la colère d’un député wallon, qui se croyait insulté par le mot susceptible. — Est-ce que vous me croyez susceptible d’une mauvaise action ? criait-il au ministre. Il fallut lui prouver par le dictionnaire de l’Académie qu’il y avait des susceptibilités louables. Ce fut l’expression du ministre en lui donnant cette leçon de français.
Les députés de Bruxelles ne sont point obligés de payer un cens, comme les nôtres ; ils reçoivent une indemnité de 500 fr. par mois. Aussi ne manque-t-on pas de le leur rappeler souvent dans les journaux. Chaque fois que la chambre est moins nombreuse qu’à l’ordinaire, on leur reproche leurs 500 francs de la façon la plus humiliante : — Allez donc à votre devoir, puisque vous êtes payés !... Quand on paye un domestique, il faut qu’il fasse son service !... Gagnez donc votre pain !... etc. — Telles sont les aménités qui se lisent dans les journaux belges. Il faut avouer aussi qu’elles sont fréquemment méritées, toute convenance à part.
La chambre des représentans de Bruxelles est un excellent chauffoir public. Le peu de gens inoccupés que possède cette capitale profite avec ardeur de l’étendue des magnifiques tribunes, de la mollesse des banquettes et du confort des tapis, et vient sommeiller, trois heures de la journée, au murmure doux et régulier de l’éloquence flamande. Parfois seulement quelque député, au sang méridional (wallon ou luxembourgeois) interrompt cette quiétude et se met à jeter des brandons imprévus dans ces graves conférences ; mais de telles surprises sont rares sous le ministère actuel, qui a su dompter la gauche et réduire le parti radical à un silence bienveillant.
Bruxelles, prodigue de nouveaux théâtres, s’est livrée depuis peu à une grande économie de journaux. La capitale du Brabant en avait sept bien comptés ; elle en compte sept encore, mais n’en lit plus qu’un. Ceci n’a rien d’extraordinaire. Paris en fait autant sans le savoir ; Bruxelles le sait, voilà tout. A part l’article politique, autrement dit premier-Paris, pièce de bœuf ou pallas, et le feuilleton, tous nos journaux ne sont qu’un même journal. Il en était ainsi des journaux belges forcément, puisqu’ils répètent à peu près les nôtres. On a eu l’idée de les faire tous chez le même imprimeur ; c’est logique. Les besoins politiques du pays réclamaient toutefois des nuances diverses dans le premier-Bruxelles ; on y satisfait en variant légèrement quelques expressions de ce morceau. On peut faire ainsi deux articles en retournant les phrases de l’un contre l’autre, et même un troisième qui tient le milieu.
Après tout, mieux vaut un bon journal que sept mauvais, et le journal multiple de Bruxelles est rédigé avec talent ; il n’emprunte rien aux autres, et ses titres mêmes sont légitimement acquis. De plus, il donne à ses abonnés des livres pour rien ; voilà ce qui rend si difficile de vaincre la contrefaçon. Le jour où nos libraires suivront l’exemple qu’elle leur indique, les éditeurs belges donneront de l’argent à leurs lecteurs.
En cinquante minutes j’échappe à l’atmosphère embrumée de Bruxelles, et me voilà sur le quai d’Anvers, cherchant l’agence maritime du bateau à vapeur.
Je n’ai jamais vu de si beaux soleils couchans que sur le quai d’Anvers, — hormis peut-être à Constantinople, de la terrasse du petit champ des Morts. — Là seulement, la teinte du ciel est rouge cerise ; ici elle est d’écarlate et de pourpre. Là le soleil descend derrière la mosquée d’Eyoub dentelant le ciel de ses six minarets ; ici c’est derrière les toits crénelés de la Tête-de-Flandre que le même astre disparaît à Anvers deux heures plus tard qu’à Constantinople, — ce dont je n’ai jamais pu trop m’étonner.
Deux heures, oui, deux heures à peu près ! J’ai moi-même constaté à Malte, en revenant d’Orient, une heure trente-cinq minutes de différence avec l’heure solaire, pour les montres qui avaient conservé l’heure de Constantinople. — Des marins m’ont appris là que, lorsqu’on fait le tour du monde, il y a un jour de gagné ou de perdu, selon qu’on navigue à l’Orient ou à l’Occident. C’est un jour sur un an à effacer du calendrier ou à y marquer en blanc ; le journal du bord en tient compte, — et tout homme peut ainsi ajouter un jour à sa vie en voyageant vers l’Occident, car il aura fait en un an ce que le soleil fait en un jour, mais ce jour-là même, de vingt-quatre heures, qu’il gagnera sur l’astre fugitif, se retrouvera en plus parmi les siens.
Si l’on construit jamais un aérostat qui puisse se maintenir immobile au-dessus de l’atmosphère terrestre, c’est-à-dire vingt lieues seulement plus haut que nos têtes, l’aéronaute hardi qui fera cette expérience verra le temps s’arrêter pour lui. Il restera toujours au même âge et à la même heure... mais là, sans doute, est le secret de l’immortalité des dieux !
Ce paradoxe étonnera les esprits timides ; mais croyez bien qu’il est scientifiquement inattaquable, — et il ne fallait rien moins, pour m’en donner l’idée, que l’aspect des affiches-monstres de M. Kirsch le long des maisons du quai d’Anvers.
M. Kirsch parcourt, ainsi que moi, les villes flamandes ; de loin en loin j’aperçois son ballon, qui s’élève majestueusement, vers le soir, à la grande surprise des populations, — et s’en va échouer honteusement, une heure après, soit sur les talus d’un canal, soit dans un champ de pommes de terre... triste fin des efforts renaissans de l’homme à tenter la conquête des cieux.
L’aérostat n’est autre chose que le fantôme de Babel.
Contentons-nous, pour le moment, d’avoir vaincu la terre et les flots. Un monstre de fer et d’acier, créé par le génie humain, m’a posé sur ce rivage, où j’attends qu’un autre monstre d’acier et de bois me vienne prendre demain pour me transporter, en douze heures, dans la patrie d’Érasme..... oïmé ! — l’auteur glorieux de l’Éloge de la Folie !
Si vous voulez voir les Riddecks en attendant, m’a-t-on dit.
Pourquoi pas ? ce n’est point impunément qu’on met le pied dans la ville de Rubens ! on se voit pris de tous côtés dans la couleur... Ici, c’est le soleil se couchant dans des draps de pourpre ; là, ce sont des jardins parés de charmilles aux feuilles rougies par l’automne ; les maisons sont de briques rouges, et ta couleur chérie, ô maître, resplendit encore sur les traits des descendantes de tes modèles ! Ces chairs roses et transparentes, ces chevelures épaisses dont l’or a des reflets vermeils, toute cette luxuriante et vivace nature fleurit sur le sol de ta bonne Flandre, comme les roses de ses jardins !
Les Riddecks sont deux vastes salles de danse qui se trouvent dans une rue parallèle au port. Je pense qu’elles avaient un caractère plus marqué lorsque Rubens venait y étudier la carnation des beautés flamandes, animées par la danse, le genièvre et la bière forte. Aujourd’hui cela ressemble au Colisée, au Wauxhall, au Prado, à tous les bals publics possibles. L’orchestre, assez nombreux, joue des valses et des polkas, — et un public très mélangé garnit les tables, disposées autour de la salle, et qui laissent au milieu un large espace pour la danse. C’est là que se déploient les talens variés des marins de toutes nations, qui importent naturellement les pas les plus excentriques et les enseignent à leurs danseuses belges ou néerlandaises. L’extrême civilisation expose là ses raffinemens en face de la naïve chorégraphie du sauvage, et s’étonne parfois de lui ressembler. N’est-ce pas là encore un bel argument pour cette pensée de Rousseau, que « le sauvage n’est au fond que le dernier reste d’une civilisation abolie ! » — Et nous-mêmes où allons-nous ?
Quelquefois les danseuses, en général vêtues de blanc, valsent entre elles, et c’est alors presque un spectacle d’opéra ; la galerie applaudit joyeusement, et offre avec courtoisie des verres de bière ou de punch, où ces blondes almées veulent bien tremper leurs lèvres un instant. Dans les intervalles du ballet, de jolies marchandes, en costume anversois, offrent des sucreries et des gâteaux aux spectateurs.
Au fond de la salle est une estrade assez vaste, séparée du reste par une rampe à balustres, et où les bourgeois du pays, avec leurs familles, viennent jouir du tableau un peu aventureux de cette gaieté populaire et maritime. C’est une peinture à deux étages, comme dans ce tableau de Rubens, qui représente des personnages de cour sur le pont d’un navire, tandis que grouille et folâtre au-dessous l’essaim charnu des tritons et des néréides !
Et maintenant que vous dirai-je ? Me pardonnerez-vous d’arrêter ici ma course vers le Nord malgré mes promesses et mes projets ? Vous apprendrai-je, pour m’excuser, que je partais pour des contrées beaucoup plus septentrionales quand les brouillards, les tempêtes et les pluies continuelles m’ont cloué sur le quai d’Anvers, où se dessinaient mille sombres tableaux de naufrages lointains ? Ici, des barques qu’on radoube, des paquebots aux roues brisées, des bâtimens dont on répare la quille avec le même bruit qui se fait en fermant les cercueils ; et là, devant la paisible statue de Rubens, un pyroscaphe noir et démâté, la Princesse Victoria. Pourtant ce vaisseau funèbre porte à sa poupe une éclatante figure dorée que la tempête a laissée intacte ; c’est une femme en costume de bal, le corps en avant, le pied levé, qui semble s’élancer gaiement vers quelque fête sous-marine ! Cette sirène engageante n’a pu parvenir à me séduire ; je suis rentré posément dans la ville, j’ai voulu revoir les Rubens de la cathédrale et du musée, errer dans ces belles rues aux maisons espagnoles, où le bruit des guitares se mêle parfois encore aux mille carillons des clochers flamands ; puis, vers cinq heures, j’ai repris le dernier convoi du chemin de fer, qui m’a transporté dans la même soirée à une trentaine de lieues de l’élément perfide, et presque sous d’autres climats.
Vingt minutes après notre départ d’Anvers, nous descendions à Malines pour attendre la correspondance de Liège, qui part de Gand. Nous voilà tous en pleine nuit sur le champ de la station, où s’entrecroisent cinq à six voies différentes : les convois viennent, tournent et fuient autour de nous comme des traîneaux sur la glace ; il en est qui s’arrêtent pourtant ; on crie : Bruxelles ! Tirlemont ! Louvain ! Saint-Trond ! Les gardiens affairés errent avec des torches. Il s’agit de se reconnaître au milieu de ce désordre nocturne, car les jours de cohue, bien des familles sont séparées, le mari s’en va coucher à Ostende, au bord de l’Océan, et la femme au sein des Ardennes, sur la frontière de Prusse. Pour l’étranger, la difficulté se complique des noms de villes prononcées tantôt en français, tantôt en flamand : Gand s’appelle Gent ; Anvers, Antwerpen ; Liège, Luttich, ainsi de suite. Enfin voici que nous roulons bien fidèlement sur la route de cette dernière ville ; la station de Louvain est la première de ce côté. Entre Louvain et Saint-Trond, on rencontre le plus long tunnel du continent, il a dit-on, près de deux kilomètres. A partir de là commence la portion vraiment ennuyeuse du trajet. Il faut remarquer que sur un chemin de fer, l’impatience et l’ennui se produisent en raison de la distance et non de l’espace de temps. Quatre heures de chemin de fer équivalent à douze heures de poste au moins dans l’imagination du voyageur.
Oublions tout cela et allons vite au plus pressé, c’est-à-dire au plus beau.
La cour du Palais-de-Justice de Liège est un vaste carré long, entouré de magnifiques galeries aux colonnes de granit sculptées ; les voûtes et les murs sont en brique rouge, sur laquelle se détache la colonnade noire et polie, ce qui rappelle certains palais de Venise. Des boutiques et des étalages garnissent partout les galeries à l’intérieur, comme dans tous les palais-de-justice du monde. L’extérieur, du côté de la place, ne répond pas à ces magnificences : c’est l’aspect d’un hôpital ou d’une caserne, et pourtant c’est le plus bel édifice de Liège. Il en est de même à peu près des églises, le dehors en est peu remarquable, et trois ou quatre d’entre elles offrent des intérieurs merveilleux. Je ne me hasarderai pas à les décrire après tant d’autres voyageurs, après Dumas, surtout, qui traversa Liège, il y a quelques années.
Les habitans de cette bonne cité ne peuvent pardonner à Dumas d’avoir prétendu qu’on ne peut y trouver à dîner qu’à une certaine heure du milieu de la journée, où ces peuples ont l’habitude de prendre leur nourriture ; secondement, que le pain y est inconnu, et qu’on n’y mange que du gâteau et du pain d’épice ; ensuite, que les Wallons, habitans de la province de Liège, ne peuvent souffrir leurs compatriotes les Belges ; enfin, que les draps de lit sont étroits comme des serviettes, les couvertures à l’avenant, et qu’un Français ne peut demeurer couvert dix minutes dans un lit liégeois. Il y a pourtant beaucoup de vrai dans ces quatre remarques d’Alexandre Dumas.
Seulement il aurait pu généraliser son observation pour une grande partie de la Belgique et ménager davantage ces braves Wallons qui sont pour ainsi dire nos compatriotes, tandis que les Flamands se rapprochent beaucoup plus de la race des peuples du Nord. C’est une chose, en effet, qui frappe vivement le voyageur qu’à sept ou huit lieues de la frontière prussienne on rencontre tout une province où le français se parle beaucoup mieux que dans la plupart des nôtres ; le patois wallon n’est lui-même qu’un français corrompu qui ressemble au picard, tandis que le flamand est une langue de souche germanique.
La journée était superbe et j’ai pu monter à la citadelle pour juger la ville d’un seul coup d’œil. Une longue rue de faubourg qui commence derrière le Palais-de-Justice conduit jusqu’aux remparts d’où l’on découvre toute la vallée de la Meuse. Liège s’étale magnifiquement sur les deux rives avec ses quartiers neufs à droite, et ses vieilles maisons aux toits dentelés à gauche de la citadelle et sur l’autre rive du fleuve ; plusieurs églises, et notamment Saint-Thomas, appartiennent à cette architecture carlovingienne qu’on admire à Aix-la-Chapelle, à Cologne et dans toutes les villes du Rhin. La Meuse est large à peu près comme la Seine et se perd à l’horizon en détours lumineux ; la forêt des Ardennes garnit le flanc des collines les plus éloignées, et la vue s’anime encore dans la campagne des vieilles ruines de tours et de châteaux si fréquentes dans ce pays.
Quant à la citadelle d’où l’on jouit de ce beau spectacle, elle appartient à ce genre de forteresses tellement imprenables, qu’elles sont invisibles. Aucun touriste n’a jamais su trouver la citadelle d’Anvers, à moins de s’y faire conduire ; mais il faudrait du malheur pour ne pas rencontrer celle de Liège, située au sommet d’une montagne. Eh bien ! du rempart où j’étais tout à l’heure, et qui présente l’aspect d’un simple coteau, il faut descendre encore par une foule de sentiers obliques pour arriver par une porte masquée dans l’intérieur de la place, enfoncée dans la montagne comme la gorge du Vésuve.
Les citadelles qu’on bâtissait avant Vauban étaient beaucoup moins terribles, mais plus favorables au coup d’œil. On sait ce qui arriva à celle de Liège, lorsqu’elle dominait la vallée avec des tours majestueuses et de beaux remparts crénelés. Les bourgeois invitèrent un jour toute la garnison aux noces de la fille d’un de leurs bourgmestres, qu’on appelait la belle Aigletine. On était alors en pleine paix, et nul n’avait de méfiance. Pendant la nuit, au bal où les belles Liégeoises déployaient toutes leurs séductions dans un but patriotique, tous les ouvriers de la ville réunis parvinrent à démolir le fort de fond en comble ; de sorte que les soldats, en y retournant au point du jour, trouvèrent la montagne nue comme la main. Le fort actuel défie toute tentative pareille ; il faudrait non pas le démolir, mais le combler.
Il est une heure, et je me hâte de descendre vers la ville, suffisamment averti que plus tard il serait impossible d’y dîner convenablement. Les tables d’hôtes sont d’ailleurs excellentes ; le vin ordinaire coûte 3 francs la bouteille comme dans toute la Belgique ; quant à la bière, à Liège, elle cesse d’être forte ; c’est une bière brune qui ressemble à nos bières de Lyon. Le faro, le lambick, la bière même de Louvain sont considérés là comme des boissons étrangères. Quant au pain, on l’a dit fort justement, il n’y en a pas, et là se trouve réalisé le vœu de cette princesse qui disait : « Si le peuple n’a pas de pain, il faut lui donner du gâteau. »
Je me remets à dévider l’écheveau fort embrouillé des vieilles rues de la ville. C’est l’occupation la plus amusante que puisse souhaiter un voyageur, et je plains sincèrement ceux qui se font conduire aux endroits curieux. Dans toute ville, les trois centres importans sont l’hôtel-de-ville, la cathédrale et le théâtre. Chacun de ces quartiers a, d’ordinaire, une physionomie spéciale ; mais, dans les villes anciennes, il faut chercher d’abord le quartier où se tiennent les halles ; là est le noyau, l’alluvion de trois siècles, la population caractéristique. Ce quartier, à Liège, doit à ses rues étroites et tortueuses plutôt qu’à la forme de ses maisons, une couleur antique encore prononcée. Un carrefour triangulaire, où aboutissent sept à huit rues, encombré de marchands, de foule et de voitures, rappelle tout-à-fait le premier décor de la Juive avec sa porte d’église à droite, à gauche une rue en escalier qui descend vers la Meuse, et au fond, une voie plus large qui conduit au pont des Arches, un vrai pont du moyen-âge fortement cambré, et dont les piles énormes ont dû jadis porter des maisons. Il remonte, du reste, à 1100, quoique souvent réparé depuis. Du milieu de ce pont, la vue est magnifique de tous les côtés ; les hauteurs de la citadelle et les coteaux qui fuient vers le midi, parés des dernières verdures de la saison, la Meuse qui se perd dans les noires Ardennes, les tours et les clochers de briques que le soleil rougit encore ; le faubourg d’outre-Meuse coupé par une autre rivière, l’Ourthe, qui y trace de joyeux îlots ; puis sur le quai de la rive gauche, un vaste emplacement où se tient la foire, où se presse la foule bariolée autour des étalages, des cirques et des bateleurs.
Ayant vu la ville des deux côtés du pont et de la citadelle, il ne m’était plus difficile de m’y reconnaître. En redescendant la rue qui conduit au pont des Arches, on se retrouve sur une place longue, plantée d’arbres, moitié boulevard, moitié marché, ornée au milieu de trois fontaines dans le goût de la renaissance, construites en forme de pavillon comme celle des Innocens. En face, à gauche, est l’Hôtel de Ville, qui n’a rien de remarquable, le seul du reste en Belgique qui ne soit pas un chef-d’œuvre d’architecture gothique. Cela suffit pour indiquer que Liège n’a jamais été une cité républicaine comme ses sœurs du pays de Brabant.
A cette longue place, en succède immédiatement une autre plus carrée, où se trouve le Palais-de-Justice, dont nous avons déjà parlé. Ensuite vient la troisième place, encore contiguë aux deux autres, plantée en quinconce et qu’on appelle la place Verte. Après quoi on arrive au théâtre, grand et lourd, bâti sur le modèle de l’Odéon, et dont Mlle Mars a posé la première pierre en 1818. Cela ne nous rajeunit pas.
De ce côté, s’étend toute la ville neuve, aux larges rues bordées de trottoirs en bitume, aux boutiques parisiennes, offrant derrière leurs vitrages de cuivre et de glaces, les étalages les plus splendides. Bien plus, un passage, le passage Lemonnier, qui fait l’envie et le désespoir de Bruxelles, aussi grand, aussi brillant, aussi éclatant de gaz, de marbres et de dorures que nos plus beaux passages de Paris. Les rues voisines sont à l’avenant ; il faut pénétrer assez loin encore, de ce côté, pour retrouver un fragment de l’antique Liège, autour de la cathédrale consacrée à Saint-Paul. En descendant de nouveau vers la Meuse, on traverse un quartier presque entièrement en construction. J’aperçus, au fond d’une place, un de ces édifices modernes à colonnes, qui servent indifféremment, comme l’a remarqué Victor Hugo, de bourse, d’église, de palais, de temple, d’hôpital, etc. Une porte était ouverte, j’y pénétrai avec toute l’indiscrétion d’un flâneur. Une soixantaine de Liégeois s’y livraient à l’élection d’un conseiller municipal. Quelqu’un m’ayant demandé si j’étais pour M. Lamaille, et si je votais avec le parti catholique, je compris ma position d’intrus, et je laissai les catholiques, les libéraux et les orangistes, ballotter paisiblement leurs candidats.
On peut revenir vers le centre par un long boulevard qui fait un arc depuis la Meuse, et au-delà de la cathédrale, jusqu’à la place du Spectacle ; à gauche, le faubourg s’échelonne vers les hauteurs et présente deux ou trois églises perchées au plus haut de la côte ; à droite se développent les bâtimens et les jardins de la Sauvenière, riante abbaye aux tours de brique rouge et aux clochers d’étain effilés ; une petite rivière, bordée de peupliers et de longs berceaux de feuillage, entoure ce quartier paisible dont la physionomie appartient encore à la ville gothique. Il me reste à aller lire les journaux dans l’un des brillans cafés du passage Lemonnier. Liège en possède une douzaine dont quatre ou cinq sont quotidiens. Le Journal de Liège a la grandeur du Journal des Débats et en représente relativement l’opinion ; ensuite vient le Courrier de la Meuse, puis le Politique, l’Industrie, etc. Les annonces soutiennent surtout ces feuilles importantes et sont fort productives dans toute la province.
Il me reste à dire que toute la ville de Liège est éclairée au gaz, et que la cathédrale n’a pu elle-même échapper à ce progrès des lumières que nos curés parisiens ont repoussé jusqu’ici.
Liège s’honore d’avoir produit Grétry, auquel elle élève en ce moment une statue.
GÉRARD DE NERVAL.
_______