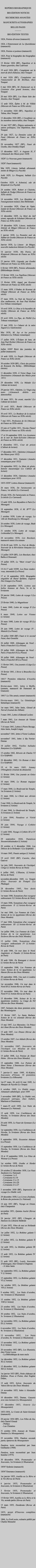11 février 1841 — Une Journée à Liège, dans La Presse, signé Fritz.
L’article sera repris très partiellement le 22 novembre 1846 dans L’Artiste-Revue de Paris sous le titre : Un tour dans le Nord IV, et en 1852 dans Lorely. Souvenirs d’Allemagne : « Rhin et Flandre, III, Liège ».
Nerval est parti en Belgique au milieu du mois d’octobre 1840 en vue de monter un dossier à présenter au ministère de l’Intérieur sur la question de la contrefaçon belge préjudiciable à l’édition française. Il est à Liège en novembre, où l’affaire Labalue bat son plein. Catherine Labalue, meurtrière par arsenic de deux membres de sa famille qu’évoque ici Nerval fut jugée et condamnée à mort à Liège le 20 novembre 1840. L’évocation de l’affaire Labalue sera suprimée dans la reprise de l’article en 1846 dans L’Artiste-Revue de Paris et en 1852 dans Lorely. Souvenirs d’Allemagne. Une semaine après la parution de cet article, Nerval subira sa première crise nerveuse avérée..
Voir la notice LA CRISE NERVEUSE DE 1841.
******
UNE JOURNÉE À LIÈGE.
Je voudrais bien trouver à vous mander d’ici quelque chose d’intéressant, le besoin d’écrire étant une forme du besoin de parler qu’éprouve toute créature isolée de ses proches et de ses amis ; mais quelle attention accorderez-vous à un touriste d’une zone si rapprochée que sa correspondance vous parviendra dans moins d’un jour ? Vous dirai-je, pour m’excuser, que je partais pour des contrées beaucoup plus septentrionales quand les brouillards, les tempêtes et les pluies continuelles m’ont cloué sur le quai d’Anvers, où se dessinaient mille sombres tableaux de naufrages lointains. Ici, des barques qu’on radoube, des paquebots aux roues brisées, des bâtiments dont on répare la quille avec le même bruit qui se fait en fermant les cercueils ; et là, devant la paisible statue de Rubens, ce pyroscaphe noir et démâté, la Princesse Victoria, qui naguère nous amenait tant de chevaux de Hambourg, et qui fut forcé de les jeter tous à la mer. Les malheureux nagèrent longtemps, comme un troupeau marin, dans le sillage du navire, puis le flot les rejeta sanglants et brisés le long des digues du Texel. Pourtant ce vaisseau funèbre porte à sa poupe une éclatante figure dorée que la tempête a laissée intacte ; c’est une femme en costume de bal, le corps en avant, le pied levé, qui semble s’élancer gaîment vers quelque fête sous-marine ! Cette syrène engageante n’a pu parvenir à me séduire ; je suis rentré posément dans la ville, j’ai voulu revoir les Rubens de la cathédrale et du musée, errer dans ces belles rues aux maisons espagnoles, d’où le bruit des guitares se mêle parfois encore aux mille carillons des clochers flamands ; puis, vers cinq heures, j’ai repris le dernier convoi du chemin de fer, qui m’a transporté dans la même soirée à une trentaine de lieues de l’élément perfide, et presque sous d’autres climats.
N’est-ce pas là, du reste, une merveilleuse traversée, et qui vaut bien celle d’Anvers à Londres, que j’allais tenter imprudemment. J’ai entendu quelqu’un soutenir un jour que l’Angleterre n’est pas un pays, et je commence à partager cette opinion. Un endroit où l’on ne peut pénétrer sans risquer sa vie, une terre qui ne tient à rien, un sol où l’on ne met le pied qu’après avoir senti pendant quelques heures trois pouces de planche entre la mort et soi, un royaume qu’il est impossible d’aborder sans subir d’affreuses coliques, ce n’est pas là un pays, ce n’est pas une patrie ; et les Anglais le savent bien, eux qui se sont faits, comme les Juifs, les citoyens du monde entier.
D’ailleurs Londres n’est pas dans Londres, elle est partout où nous sommes ! Ce rail-wail est anglais, cette machine qui halète et qui souffle devant nous, et qui éclaire la route du feu de ses naseaux, n’est encore qu’un cheval anglais du plus pur sang et du plus pur acier, et le wagon qui m’emporte est rempli d’Anglais en mackintosh, qui se rendent à la ville où John Cokerill refusa des statues, à Liège, pleine encore des souvenirs de ce Napoléon industriel.
Vingt minutes après notre départ d’Anvers, nous descendions à Malines pour attendre la correspondance de Liège, qui part de Gand. Nous voilà tous en pleine nuit sur le champ de la station, où s’entrecroisent cinq à six voies différentes : les convois viennent, tournent et fuient autour de nous comme des traîneaux sur la glace ; il en est qui s’arrêtent pourtant ; on crie : Bruxelles ! Tirlemont ! Louvain ! Saint-Trond ! Les gardiens affairés errent avec des torches. Il s’agit de se reconnaître au milieu de ce désordre nocturne, car les jours de cohue, bien des familles sont séparées, le mari s’en va coucher à Ostende, au bord de l’Océan, et la femme au sein des Ardennes, sur la frontière de Prusse. Pour l’étranger, la difficulté se complique des noms de villes prononcées tantôt en français, tantôt en flamand : Gand s’appelle Gent ; Anvers, Antwerpen ; Liège, Luttich, ainsi de suite. Enfin voici que nous roulons bien fidèlement sur la route de cette dernière ville, la station de Louvain est la première de ce côté. Entre Louvain et Saint-Trond, on rencontre le plus long tunnel du continent, il a dit-on, près de deux kilomètres. À partir de là commence la portion vraiment ennuyeuse du trajet. Il faut remarquer que sur un chemin de fer, l’impatience et l’ennui se produisent en raison de la distance et non de l’espace de temps. Quatre heures de chemin de fer équivalent à douze heures de poste au moins dans l’imagination du voyageur.
Pourtant il est fort agréable, ayant dîné à Anvers-sur-l’Escaut, de pouvoir souper de bonne heure encore à Liège-sur-Meuse. La table d’hôte du Grand Monarque attendait notre arrivée, garnie à moitié déjà d’hôtes plus anciens que nous. Je remarque avec plaisir que l’idiome français dominait dans la conversation.
— Enfin, monsieur, disait quelqu’un, croyez-vous, en conscience, que cette femme soit coupable ?
— Monsieur, répondait un autre, si j’étais juré je ne la condamnerais pas !
— Mais, monsieur, comme homme du monde ?
— J’avoue que je n’en ferais pas ma société…
— Allons donc ! disait un troisième, c’est une femme charmante, une figure distinguée, un front de génie, des yeux d’un noir… Et il paraît certain que son mari ne la comprenait pas !
— Ce n’était pas une raison, monsieur, dit un homme grave, pour lui faire avaler quarante-trois grains d’arsenic.
— Et pour en donner autant à sa belle-mère !
Ici je ne pus m’empêcher de sourire, pensant que Liège en était encore à s’occuper du procès Lafarge, et en exagérait singulièrement les détails.
— Monsieur, reprit un des soupeurs, la quantité n’y fait rien ; la science a reconnu que l’arsenic n’est plus une preuve d’empoisonnement ; l’arsenic est dans tout, dans les os, dans les chairs, dans les substances les plus ordinaires ; le morceau que vous portez à votre bouche dans ce moment est rempli d’arsenic...
Ici l’interlocuteur ne put s’empêcher de remetre le morceau dans son assiette.
— Je dirai plus : l’arsenic est indispensable à l’existence de l’homme !
— Oh ! oh ! voilà du paradoxe. Vous allez nous persuader qu’on empoisonnerait un homme en le privant d’arsenic…
— Pourquoi pas ?... Mais admettons le crime. Est-ce la femme, est-ce la société qui est coupable. L’institution du mariage est fausse ; la femme proteste comme elle peut !
— C’est à dire que voilà le résultat des mauvaises lectures, du drame moderne, des romans humanitaires.
— Eh ! monsieur, la malheureuse ne sait pas lire et ne comprend que le patois wallon.
J’avouerai qu’ici je ne comprenais plus rien moi-même à la conversation, les répliques se mêlaient de plus en plus, et la dispute gagnait les bouts de la table ; les noms d’Orfila, de Raspail s’échangeaient comme des défis.
— L’appareil de Marsh...
— Je n’y crois pas.
— Il a tiré cent vingt grains d’arsenic des trois cadavres !
— Je le regarde comme un instrument excellent pour en fabriquer !
— Messieurs, disait un jeune homme, on ne se méfie pas assez des femmes brunes...
— Des femmes maigres surtout !
— Enfin, nous avons une Lafarge Liégeoise.
— Un empoisonnement double liégeois, dit un commis-voyageur.
— C’est encore de la contrefaçon belge !...
— Merci pour nous, monsieur !
J’arrivais peu à peu à être au courant de l’affaire. Catherine Labalue, dont le nom réveille déjà de terribles souvenirs, a empoisonné son mari et sa belle-mère, non pas à la fois, mais à quelques jours de distance, afin de pouvoir épouser son amant nommé Maréchal. Mais ce dernier, marié lui-même, a empoisonné à son tour sa femme, en saupoudrant d’arsenic une tartine de beurre. Et de plus son crime a été révélé par sa propre fille, âgée de dix ans. On a dit que l’affaire Lafarge était un drame du Gymnase. L’affaire Labalue a tous les caractères d’un gros mélodrame de l’Ambigu.
Le lendemain, en visitant le Palais-de-Justice, qui est le monument le plus remarquable de Liège, j’eus la curiosité de monter au premier étage, où se tient la cour d’assises ; la foule était telle que je ne pus rester qu’un instant. Catherine Labalue est une femme petite et maigre, au front proéminent, aux yeux et aux sourcils noirs ; sa chevelure disparaissait sous sa coiffe, et son visage était presque toujours caché sous son mouchoir. On pouvait néanmoins entrevoir une physionomie assez jolie, aux traits marqués et expressifs. Son complice est un homme grand et commun, à figure osseuse, âgé du reste d’une cinquantaine d’années, et, comme tous les gens qui respirent de grandes passions, paraissant fort peu digne d’en inspirer.
L’avocat-général tonnait contre la démoralisation du siècle et terminait par cette phrase à effet : Unis par le vice, unis par l’adultère, unis par le crime… soyez-le par le châtiment !
Les belles dames de la ville faisaient corbeille autour du prétoire. Le reste du public se composait de robes noires et de blouses bleues, car tout le peuple wallon porte la casquette et la blouse presque comme un uniforme ; les détails de ce procès étaient de nature d’ailleurs à offrir à cette population des enseignemens fort peu moraux. J’ai entendu un Allemand d’Aix-la-Chapelle s’élever à ce propos contre la publicité qu’on donne aux débats judiciaires tant en France qu’en Belgique. En Allemagne, les scandales du procès Lafarge et les horreurs du procès Labalue fussent restés à peu près ignorés, tous les procès se jugeant à huis-clos et les journaux censurés ne pouvant guère reproduire que l’énoncé du fait et le texte du jugement. Aussi offrons-nous aux yeux de l’Europe, qui lit avidement nos journaux judiciaires, l’image d’un peuple non moins dangereux dans ses mœurs que dans ses principes publics.
La cour du Palais-de-Justice de Liège est un vaste carré long, entouré de magnifiques galeries aux colonnes de granit sculptées ; les voûtes et les murs sont en brique rouge, sur laquelle se détache la colonnade noire et polie, ce qui rappelle certains palais de Venise. Des boutiques et des étalages garnissent partout les galeries à l’intérieur, comme dans tous les palais-de-justice du monde. L’extérieur, du côté de la place, ne répond pas à ces magnificences : c’est l’aspect d’un hôpital ou d’une caserne, et pourtant c’est le plus bel édifice de Liège. Il en est de même à peu près des églises, le dehors en est peu remarquable, et trois ou quatre d’entre elles offrent des intérieurs merveilleux. Je ne me hasarderai pas à les décrire après tant d’autres voyageurs, après Dumas, surtout, qui traversa Liège, il y a trois ans.
Les habitans de cette bonne cité ne peuvent pardonner à Dumas d’avoir prétendu qu’on ne peut y trouver à dîner qu’à une certaine heure du milieu de la journée, où ces peuples ont l’habitude de prendre leur nourriture ; secondement, que le pain y est inconnu, et qu’on n’y mange que du gâteau et du pain d’épice ; ensuite, que les Wallons, habitans de la province de Liège, ne peuvent souffrir leurs compatriotes les Belges ; enfin, que les draps de lit sont étroits comme des serviettes, les couvertures, à l’avenant, et qu’un Français ne peut demeurer couvert dix minutes dans un lit liégeois. Il y a pourtant beaucoup de vrai dans ces quatre remarques d’Alexandre Dumas.
Seulement il aurait pu généraliser son observation pour une grande partie de la Belgique et ménager davantage ces braves Wallons qui sont pour ainsi dire nos compatriotes, tandis que les Flamands se rapprochent beaucoup plus de la race des peuples du nord. C’est une chose en effet qui frappe vivement le voyageur qu’à sept ou huit lieues de la frontière prussienne on rencontre tout une province où le français se parle beaucoup mieux que dans la plupart des nôtres ; le patois walois n’est lui-même qu’un français corrompu qui ressemble au picard, tandis que le flamand est une langue de souche germanique.
La journée était superbe et j’ai pu monter à la citadelle pour juger la ville d’un seul coup d’œil. Une longue rue de faubourg qui commence derrière le Palais-de-Justice conduit jusqu’aux remparts d’où l’on découvre toute la vallée de la Meuse. Liège s’étale magnifiquement sur les deux rives avec ses quartiers neufs à droite, et ses vieilles maisons aux toits dentelés à gauche de la citadelle et sur l’autre rive du fleuve ; plusieurs églises, et notamment Saint-Thomas, appartiennent à cette architecture carlovingienne qu’on admire à Aix-la-Chapelle, à Cologne et dans toutes les villes du Rhin. La Meuse est large à peu près comme la Seine et se perd à l’horizon en détours lumineux ; la forêt des Ardennes garnit le flanc des collines les plus éloignées, et la vue s’anime encore dans la campagne des vieilles ruines de tours et de châteaux si fréquentes dans ce pays.
Quant à la citadelle d’où l’on jouit de ce beau spectacle, elle appartient à ce genre de forteresses tellement imprenables, qu’elles sont invisibles. Aucun touriste n’a jamais su trouver la citadelle d’Anvers, à moins de s’y faire conduire ; mais il faudrait du malheur pour ne pas rencontrer celle de Liège, située au sommet d’une montagne. Eh bien, du rempart où j’étais tout à l’heure, et qui présente l’aspect d’un simple coteau, il faut descendre encore par une foule de sentiers obliques pour arriver par une porte masquée dans l’intérieur de la place, enfoncée dans la montagne comme la gorge du Vésuve.
Les citadelles qu’on bâtissait avant Vauban étaient beaucoup moins terribles, mais plus favorables au coup d’œil. On sait ce qui arriva à celle de Liège, lorsqu’elle dominait la vallée avec des tours majestueuses et de beaux remparts crénelés. Les bourgeois invitèrent un jour toute la garnison aux noces de la fille d’un de leurs bourgmestres, qu’on appelait la belle Aigletine. On était alors en pleine paix, et nul n’avait de méfiance. Pendant la nuit, au bal, où les belles Liégeoises déployaient toutes leurs séductions dans un but patriotique, tous les ouvriers de la ville réunis parvinrent à démolir le fort de fond en comble ; de sorte que les soldats, en y retournant au point du jour, trouvèrent la montagne nue comme la main. Le fort actuel défie toute tentative pareille ; il faudrait non pas le démolir, mais le combler.
Je me suis inquiété dans plusieurs villes fortes de la Belgique des armemens considérables qui s’y faisaient pour soutenir la neutralité. J’ai remarqué à Menin et à Anvers des préparatifs qui annoncent l’attitude la plus redoutable. On y transporte, il est vrai, peu de canons ; les soldats y sont rares, mais brossés et astiqués avec une discipline sévère. On se livre plus à un lessivage à fond des portes, des vitres et des planchers ; toutes les murailles, galeries et casemates sont repeintes en vert pomme et en jaune-serin ; on ne veut pas que dans le cas d’invasion l’ennemi puisse douter de la propreté flamande. Ce soin ne rappelle-t-il pas celui d’une belle dame qui portait toujours des jupons brodés, parce que, disait-elle, on peut être exposée à rencontrer des insolens !
Il est une heure, et je me hâte de descendre vers la ville, suffisamment averti que plus tard il serait impossible d’y dîner convenablement. Les tables d’hôtes sont d’ailleurs excellentes ; le vin ordinaire coûte trois francs la bouteille comme dans toute la Belgique ; quant à la bière, à Liège, elle cesse d’être forte ; c’est une bière brune qui ressemble à nos bières de Lyon. Le faro, le lambick, la bière même de Louvain sont considérés là comme des boissons étrangères. Quant au pain, on l’a dit fort justement, il n’y en a pas, et là se trouve réalisé le vœu de cette princesse qui disait : Si le peuple n’a pas de pain, il faut lui donner du gâteau.
Je me remets à dévider l’écheveau fort embrouillé des vieilles rues de la ville. C’est l’occupation la plus amusante que puisse souhaiter un voyageur, et je plains sincèrement ceux qui se font conduire aux endroits curieux. Dans toute ville, les trois centres importans sont l’Hôtel-de-Ville, la cathédrale et le théâtre. Chacun de ces quartiers a, d’ordinaire, une physionomie spéciale ; mais dans les villes anciennes, il faut chercher d’abord le quartier où se tiennent les halles ; là est le noyau, l’alluvion de trois siècles, la population caractéristique. Ce quartier, à Liège, doit à ses rues étroites et tortueuses plutôt qu’à la forme de ses maisons, une couleur antique encore prononcée. Un carrefour triangulaire, où aboutissent sept à huit rues, encombré de marchands, de foule et de voitures, rappelle tout à fait le premier décor de la Juive avec sa porte d’église à droite, à gauche une rue en escalier qui descend vers la Meuse, et au fond, une voie plus large qui conduit au pont des Arches, un vrai pont du moyen-âge fortement cambré, et dont les piles énormes ont dû jadis porter des maisons. Il remonte, du reste, à 1100, quoique souvent réparé depuis. Du milieu de ce pont, la vue est magnifique de tous les côtés ; les hauteurs de la citadelle et les coteaux qui fuient vers le midi, parés des dernières verdures de la saison, la Meuse qui se perd dans les noires Ardennes, les tours et les clochers de briques que le soleil rougit encore ; le faubourg d’outre-Meuse coupé par une autre rivière, l’Ourthe, qui y trace de joyeux îlots ; puis sur le quai de la rive gauche, un vaste emplacement où se tient la foire, où se presse la foule bariolée autour des étalages, des cirques et des bateleurs.
Ayant vu la ville des deux côtés du pont et de la citadelle, il ne m’était plus difficile de m’y reconnaître. En redescendant la rue qui conduit au pont des Arches, on se retrouve sur une place longue, plantée d’arbres, moitié boulevard, moitié marché, ornée au milieu de trois fontaines dans le goût de la renaissance, construites en forme de pavillon comme celle des Innocens. En face, à gauche, est l’Hôtel de Ville, qui n’a rien de remarquable, le seul du reste en Belgique qui ne soit pas un chef-d’œuvre d’architecture gothique. Cela suffit pour indiquer que Liège n’a jamais été une cité républicaine comme ses sœurs du pays de Brabant.
À cette longue place, en succède immédiatement une autre plus carrée, où se trouve le Palais-de-Justice, dont nous avons déjà parlé. Ensuite vient la troisième place, encore contiguë aux deux autres, plantée en quinconce et qu’on appelle la place Verte. Après quoi on arrive au théâtre, grand et lourd, bâti sur le modèle de l’Odéon, et dont Mlle Mars a posé la première pierre en 1818. Cela ne nous rajeunit pas.
De ce côté, s’étend toute la ville neuve, aux larges rues bordées de trottoirs en bitume, aux boutiques parisiennes, offrant derrière leurs vitrages de cuivre et de glaces, les étalages les plus splendides. Bien plus, un passage, le passage Lemonnier, qui fait l’envie et le désespoir de Bruxelles, aussi grand, aussi brillant, aussi éclatant de gaz, de marbres et de dorures que nos plus beaux passages de Paris. Les rues voisines sont à l’avenant ; il faut pénétrer assez loin encore, de ce côté, pour retrouver un fragment de l’antique Liège, autour de la cathédrale consacrée à Saint-Paul. En descendant de nouveau vers la Meuse, on traverse un quartier presque entièrement en construction. J’aperçus, au fond d’une place, un de ces édifices modernes à colonnes, qui servent indifféremment, comme l’a remarqué Victor Hugo, de bourse, d’église, de palais, de temple, d’hôpital, etc. Une porte était ouverte, j’y pénétrai avec toute l’indiscrétion d’un flâneur. Une soixantaine de Liégeois s’y livraient à l’élection d’un conseiller municipal. Quelqu’un m’ayant demandé si j’étais pour M. Lamaille, et si je votais avec le parti catholique, je compris ma position d’intru[s], et je laissai les catholiques, les libéraux et les orangistes, ballotter paisiblement leurs candidats.
On peut revenir vers le centre par un long boulevard qui fait un arc depuis la Meuse, et au delà de la cathédrale, jusqu’à la place du Spectacle ; à gauche, le faubourg s’échelonne vers les hauteurs et présente deux ou trois églises perchées au plus haut de la côte ; à gauche [sic pour à droite] se développent les bâtimens et les jardins de la Sauvenière, riante abbaye aux tours de brique rouge et aux clochers d’étain effilés ; une petite rivière bordée de peupliers et de longs berceaux de feuillage entoure ce quartier paisible dont la physionomie appartient encore à la ville gothique. Il me reste à aller lire les journaux dans l’un des brillans cafés du passage Lemonnier. Liège en possède une douzaine dont quatre ou cinq sont quotidiens. Le Journal de Liège a la grandeur du Journal des Débats et en représente relativement l’opinion ; ensuite vient le Courrier de la Meuse, puis le Politique, l’Industrie, etc. Les annonces soutiennent surtout ces feuilles importantes et sont fort productives dans toute la province. J’en ai remarqué quelques unes qui témoignent bizarrement de l’influence du nom de Napoléon dans cette ancienne province française.
« — Chez Regnier, coiffeur, rue Faronstrée : — Fluide de Sainte-Hélène, infaillible pour la conservation des cheveux. La base de cette composition est le suc onctueux d’une plante que le grand homme se plaisait à cultiver dans son exil. »
En voici une autre qui montre l’envie de faire assister, jusqu’à un certain point, les populations belges à la cérémonie que Paris a consacrée aux Cendres : — « Un ancien directeur vient de faire peindre, par un de nos plus habiles décorateurs, une toile avec transparent représentant les funérailles de Napoléon. Cette apothéose se compose d’une toile de fond d’une dimension variable représentant fidèlement l’arrivée du cortège aux Invalides. le char pénètre à travers une double haie de vieux soldats et passe devant la famille royale, les princes, les ministres, précédés de M. Thiers à cheval. En encadrant cette toile dans les accessoires dont chaque théâtre est possesseur, en disposant quelques rangs de soldats faciles à réunir et des figurans costumés ; en plaçant sur les avant-scènes les artistes, les mains chargées de couronnes, de lauriers et de palmes, on parvient à établir un coup-d’œil magnifique.
« Cette décoration, facile à transporter, facile à établir, convient à une foule d’emplacemens, et notamment à tous les théâtres provinciaux et forains. »
Du reste, toute la Belgique attache une gloire personnelle au souvenir de Napoléon. Dans beaucoup d’estaminets le poêle est surmonté d’un grand Napoléon en tôle peinte, et cette figure se reproduit surtout sur les pipes, tabatières et pains d’épices des bons Wallons.
Il me reste à dire que toute la ville de Liège est éclairée au gaz, et que la cathédrale n’a pu elle-même échapper à ce progrès des lumières que nos curés parisiens ont repoussé jusqu’ici.
Tout le monde ne sait pas que Liège fut la patrie de Malherbe. Boileau dit que Malherbe vint… Mais d’où vint-il. Il vint de Liège. Le père de notre poésie nationale était wallon.
Liège peut s’honorer davantage d’avoir produit Grétry, auquel elle élève en ce moment une statue. Elle ne devrait pas oublier non plus un autre de ses glorieux enfans, le poète Régnier.
FRITZ.
_______