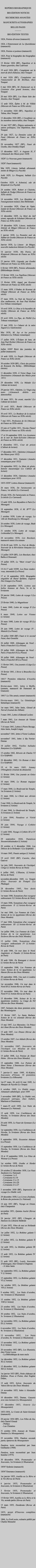1er novembre 1846 — Un tour dans le Nord. III, dans L’Artiste-Revue de Paris, 4e série, t. VII, p. 276-279, signé Gérard de Nerval.
Cette troisième livraison de : Un Tour dans le Nord fait suite aux publications du 16 août 1846, Angleterre et Flandre, et du 30 août 1846, De Ramsgate à Anvers. Elle est la reprise partielle de l’article intitulé L’hiver à Bruxelles, publié le 18 février 1841 dans La Presse, signé Fritz, et de la « lettre » intitulée Les Délices de la Hollande adressée à M. de Villemessant, publiée le 20 octobre 1844 dans La Sylphide. Elle ne sera pas reprise en volume.
******
UN TOUR DANS LE NORD.
III.
Je voudrais bien pouvoir, mon cher Houssaye, vous donner des nouvelles de l’hiver. Cela ne vous déplairait pas sans doute, à vous qui, dans la campagne de Rome, souffrez certainement à l’heure qu’il est des ardeurs du soleil italien. L’hiver ! quand on ne veut pas l’attendre, ce n’est jamais un grand embarras de le trouver. En marchant toujours au nord et suivant la ligne du méridien de Paris, je dois finir par rencontrer ce grand vieillard assis dans quelque île de la Baltique, sur son trône de frimas. Serait-ce le roi de Thulé des ballades allemandes, qui jette aux flots sa coupe d’or ruisselante d’un vin pourpré ? Siégerait-il dans les Orcades brumeuses, dans l’île anglaise d’Héligoland, qui veille au nord de l’Allemagne, ou plutôt à ces dernières pointes de la Norvége, crête dentelée de l’Europe où s’arrêta le poëte Regnard, sous prétexte que la terre s’y était arrêtée long-temps avant lui ?
Mais la terre finit aussi là où je m’arrête sur ce rivage de Néerlande, et l’on peut même dire qu’elle a fait reculer les flots. A l’heure qu’il est, je me promène à cinquante pieds au-dessous du niveau de la mer, et, en levant la tête, je crains toujours de voir passer les poissons et glisser la quille des vaisseaux au-dessus de l’atmosphère humide qui m’environne, et qui, étendue au loin sur les campagnes, y prend souvent l’aspect des eaux. Pourtant, si ces dunes de sable que mon pied foule sont vraiment le fond de la mer, tout me porte à croire que c’est encore de l’air que je respire, et que l’eau n’y réside qu’à l’état de brouillard. Du reste, un beau soleil ardent comme un fer rouge lutte à l’horizon contre ces vapeurs, qui se dissiperont au milieu de la journée ; la verdure éclate dans l’herbe et dans les feuilles sèches, et cède à peine sa nuance aux teintes pourprées de l’automne. Vous croyez donc que l’hiver vient du nord ? c’est un conte, ici même on vous dira qu’il vient de Paris.
Le moyen d’en douter. J’ai quitté Paris en proie à la pluie, à la bise, au froid prématuré ; hors de la ville, les feuilles jaunies tombaient de toutes parts, la campagne était désolée, les familles se pressaient autour du feu. Au second jour de mon voyage, l’horizon s’éclaircit un peu, le ciel prit des teintes d’opale, le feuillage se montra moins rare et plus vert. Dans le milieu du jour, les champs commencèrent à se couvrir de plates-bandes roses, violettes, bleues, qui souriaient parfois sous un pâle rayon de soleil. Je me crus déjà dans le pays des tulipes, mais on me dit le nom de ces fleurs tardives et charmantes. C’était l’œillette, plante qui réunit l’utile à l’agréable, puisqu’elle fournit de l’huile à l’industrie, séduit l’œil blasé des touristes d’automne en leur rappelant le printemps.
Mais comment songer désormais à l’hiver ? A Bruges, le temps est superbe, le soleil dans toute sa force, et l’on nous sert à dîner des petits pois verts et des fraises. Dès-lors, plus une feuille jaune ; l’année remonte à son enfance, et j’ai peur, en allant plus loin, de trouver les arbres en bourgeons. Arrêtons-nous encore dans ces plaines riantes du Brabant, que j’ai déjà plus d’une fois parcourues ; aussi bien, parti d’Ostende à cinq heures, par le chemin de fer belge, il me faudra toujours passer la nuit à Gand, la locomotive étant, à ce qu’il paraît, un animal qui a besoin de dormir.
Le bon Sterne, — hélas ! qui de nous, touristes dégénérés, ne voudrait être dans sa culotte de soie et dans son habit de ratine, — se disait, en touchant le sol de la France, que s’il mourait subitement, rien ne pourrait empêcher l’exercice du droit d’aubaine ! Je pense qu’il en serait aujourd’hui autrement. Mais si, dans une circonstance analogue, le roi des Belges avait à faire valoir des droits sur mon habit bleu-barbeau... j’aurais toujours à me reprocher d’avoir ignoré les lois du pays ; je ne puis donc que m’instruire, en me mêlant à la conversation politique de quelques voyageurs placés auprès de moi dans le wagon.
Le mot d’huître se mêlant très souvent à leur conversation, d’un français déjà frotté de wallon, je ne pus croire que ces bonnes gens s’adressassent si fréquemment cette injure banale, et je cherchai à me mettre au courant de l’affaire.
— Monsieur, me dit l’un d’eux, le ministère trahit la Belgique pour l’Angleterre : mais l’huître belge ne reculera pas !
— Permettez, monsieur, disait un autre, l’huître belge a des privilèges : l’huître anglaise ne réclame que le droit commun.
— Jamais, monsieur ! Les villes flamandes ont leurs franchises, et nous résisterons. Hier, à la kermesse de Courtray, on a exécuté le chant national, malgré la défense du ministère ; nous avons nos droits !
— Quel chant national ? demandai-je.
— Oui, monsieur, notre chant à tous :
- Guerre aux tyrans ! jamais dans la Belgique,
- Jamais l’Anglais ne règnera.
Peu à peu la question s’éclaircissait pour moi : il s’agissait des huîtres d’Ostende, et la discussion avait lieu entre un éleveur d’huîtres et un hôtelier qui revenaient de la kermesse, et dont le patriotisme se réglait sur des intérêts opposés.
Voici l’affaire telle que je la compris dans les journaux belges, en arrivant à Gand.
J’avais toujours douté qu’il y eût des huîtres à Ostende, mais il est vrai de dire qu’il n’y en a pas. L’huître que nous nommons d’Ostende s’appelle à Bruxelles huître anglaise, et est apportée à Ostende par des pêcheurs anglais... lesquels vont la recueillir toute jeune sur les côtes de France, ainsi qu’il est constaté par les plaintes continuelles de nos pêcheurs bretons ou normands.
L’huître d’Ostende n’est donc souvent qu’une huître de Cancale qui a voyagé, et qui vaut alors trois fois davantage. Puisse-t-on en dire autant des littérateurs !
Arrachée à ses bancs paternels, l’huître est transportée à Ostende, la côte la moins rocailleuse du monde, et la plus incapable d’en produire naturellement. On dépose là les jeunes huîtres dans des parcs, où elles se nourrissent et se forment, entourées de soins vigilans. Ceci est l’industrie belge ; mais depuis quelque temps, des Anglais ont imaginé de créer, dans de vieux bateaux, des huîtrières mobiles, qu’ils appellent des parcs flottans. Leur fait-on observer que la terre est à la Belgique, ils répondent que la mer est à l’Angleterre, et que le pavillon couvre l’huître, ainsi que l’homme d’Albion.
Sur quoi les huîtriers belges ont offert de prouver au ministère que l’huître conservée dans des bateaux était malsaine, maigre, et pouvait même causer des empoisonnemens.
Le ministre belge, touché par ces raisons, a frappé l’huître flottante d’un impôt de douze pour cent.
Mais l’huître en sera-t-elle moins malsaine parce qu’elle paiera l’impôt ? s’écrient les huîtriers d’Ostende.
Le ministère essaie de soutenir par ses journaux, qu’un objet qui paie l’impôt n’est jamais malsain.
Je réfléchissais là-dessus dans les rues désertes de Gand, en cherchant à retrouver la place d’Armes et le grand canal, centre intelligent et lumineux de la cité. Pardieu ! me disais-je, une question d’huîtres en vaut bien une autre, et j’ignore si nous tirerons beaucoup mieux que des écailles de celles où nous sommes engagés. Je ne tardai pas à reconnaître, en soupant, que je n’étais pas moi-même désintéressé dans l’affaire ; car l’huître dite d’Ostende, qui, il y a trois ans, valait trois francs le cent en Belgique, se vend cinq francs aujourd’hui, et encore l’on ne sait si l’on mange une huître flottante ou une huître sédentaire.
Mais je m’aperçois ici que j’imite un roi gastronome, qui ne s’est guère occupé que de cuisine dans son Voyage à Gand, publié en 1818. Les touristes, d’ailleurs, ont toujours été un peu goinfres, à commencer par d’Assoucy.
Quel beau spectacle que celui du grand canal, au clair de lune ! A droite, cette halle d’architecture espagnole, dont la porte est gardée par des dieux maniérés se tordant parmi les rocailles ; plus loin, une église sombre, de l’époque des croisades, pleine de blasons et d’armures ; les toits aigus d’un couvent du XVe siècle, luisant de reflets argentés ; à gauche, un quai de mariniers prolongeant ses maisons aux toits dentelés ; puis un palais tout italien, ceint d’une blanche colonnade ; au fond, les pignons, les clochers, les mâts entremêlés dans l’ombre, ou jetant leur image sur l’eau calme du bassin, les ponts élancés de distance en distance, et, dans tout cela, comme un faux air de Venise la belle, avec l’illusion d’une nuit de printemps.
Mais où donc est l’hiver ? je le demande : on m’écrit qu’il règne à Paris.
La place d’Armes, toujours décorée d’arbres verts, retentit du bruit des équipages. L’aristocratie gantoise, si nombreuse encore, si brillante, se rend soit au Casino des nobles, soit au théâtre, situé en face, où l’on joue de préférence l’opéra-comique français. La salle est magnifique et décorée dans le goût de la renaissance ; le public y est aussi rare que dans les rues de la ville, ce qui n’empêche ni le théâtre ni la ville d’exister.
En rentrant à l’hôtel, près du marché aux grains, j’ai vu pourtant les rues voisines remplies d’un foule compacte ; on faisait prendre aux voitures d’autres chemins : une multitude de torches et de pots à feu éclairaient une scène qui, grace à l’architecture des maisons, rappelait ce moyen-âge, hélas ! deux fois passé. Un orchestre fort nombreux donnait une sérénade sous les fenêtres d’une maison sculptée, d’apparence toute castillane, et dont les fenêtres, à tous les étages, étaient garnies de charmantes figures de Gantoises regardant derrière les vitres. C’était l’orchestre du théâtre, qui s’était transporté là après la représentation. En m’approchant davantage je vis que le bas de la maison était occupé par une boutique fermée, au-dessus de laquelle on lisait : « Van-Hien-Ven-Huise, potier d’étain, vend et loue de baignoires. » C’était à l’occasion du mariage de ce brave homme qu’avaient lieu ces solennités.
Au point du jour, la locomotive, reposée, nous traîna en trois heures à Bruxelles. Avant cette époque de progrès, l’on mettait toute la nuit pour faire le même chemin. C’était dans un bateau élégant tiré par des chevaux de poste sur un canal ; on y trouvait des lits comme à l’hôtel ; on se couchait à dix heures après le souper, et, le lendemain matin, l’on se réveillait sans avoir senti la moindre secousse, le voyage était accompli. Heureuse idée, qui mettait à profit le sommeil, et le rendait actif. Le chemin de fer nous fait donc perdre les trois heures qu’il nous prend, en nous communiquant de plus un étourdissement et un mal de tête pour tout le jour.
En quittant le débarcadère, je me suis hâté de courir à cette place du Grand-Marché qui est l’une des plus curieuses du monde, et que l’Europe connaît à peine par le souvenir du supplice d’Egmont.
Je n’en hasarderai pas la description, non plus que celle des autres curiosités de Bruxelles, tant de fois analysées ou dépeintes ; je ne veux que rappeler ce prodigieux spectacle à ceux qui l’ont admiré. C’est par un jour de beau soleil ou par une de ces nuits claires des temps de gelée, dont s’accommode si bien la physionomie de ces pays, qu’il faut traverser la place de Bruxelles. L’Hôtel-de-Ville, immense et magnifique, surmonté de la tour de Saint-Michel, ciselée, brodée, évidée comme une flèche de cathédrale, élevant à trois cents pieds l’image dorée du saint patron ; la Maison-au-Pain, située en face, qui semble un palais sombre de Venise ou de Florence ; vingt maisons d’une architecture merveilleuse, complètent le carré long de la place, sculptées, peintes ou dorées ; l’hôtel où se font les ventes, qui est un vaste palais dans le style de Louis XIV ; la Maison des Brasseurs, qui offre une façade de marbre noir rehaussé d’or ; la Maison des Mariniers, figurant à ses étages supérieurs une poupe de bateau chargée de statues et d’attributs bizarres ; d’autres maisons encore, bossuées, ventrues, festonnées en rocailles selon le vieux goût flamand : tels sont les élémens de cet ensemble unique.
La Bourgogne, l’Espagne et l’Autriche ont tour à tour marqué là le passage de leur domination, y laissant des chiffres, des armoiries, des statues, des devises ; les toits aigus, fleuronnés, découpés hardiment sur le ciel rappellent seuls l’architecture d’un pays froid et brumeux.
Le soir, toutes ces façades s’éclairent, la maison vénitienne, occupée par un casino, semble illuminée d’une fête éternelle ; les autres maisons brillent également du luxe des estaminets et des cafés, qui sont les plus grands et les plus brillans de ce quartier ; l’Hôtel-de-Ville seul projette une masse sombre, dont le centre est troué d’un cadran lumineux. Au milieu de la place, à l’endroit où mourut le comte d’Egmont, on a élevé récemment un candélabre de mauvais goût, comme tous les candélabres de fonte, qui porte un énorme foyer de gaz et nous rappelle tristement que nous vivons dans le siècle des lumières et du progrès.
Après cela, que dire de Bruxelles ? c’est une ville qui ne vaut pas Gand comme étendue ni situation. Et d’abord, ainsi que je disais l’été dernier à propos de Munich, il n’y a pas de grande ville sans fleuve. Qu’est-ce qu’une capitale où l’on n’a pas la faculté de se noyer ?... Gand a l’Escaut, Liège a la Meuse ; Bruxelles n’a qu’un pauvre ruisseau qu’il intitule la Senne, triste contrefaçon. Imaginez ensuite au centre du pays le plus plat de la terre, une ville qui n’est que montagnes : montagne de la Cour, montagne du Parc, montagne des Larmes, montagne aux Herbes potagères, etc. ; on y éreinte les chevaux pour une course de dix minutes ; tout flâneur y devient poussif ; des rues embrouillées au point de passer parfois les unes sous les autres ; des quartiers plongés dans les abîmes, tandis que d’autres se couronnent de toits neigeux comme les Alpes ; le tout offrant du reste un beau spectacle, tant d’en haut que d’en bas. On rencontre dans la rue Royale, qui longe le parc, une vaste trouée, d’où l’on peut voir, à vol d’oiseau, le reste de Bruxelles, mieux qu’on ne voit Paris du haut de Notre-Dame ; les couchers de soleil y sont d’un effet prodigieux. Sainte-Gudule s’avance à gauche sur sa montagne escarpée comme une femme agenouillée au bord de la mer et qui lève les bras vers Dieu ; plus loin, au sein des flots tourmentés que figurent les toits, le bâtiment de l’Hôtel-de-Ville élève son mât gigantesque ; ensuite vient un amas confus de toits en escaliers, de clochers, de tours, de dômes ; à l’horizon brillent les bassins du canal, chargés d’une forêt de mâts ; à gauche s’étendent les allées du boulevard de Waterloo, les bâtimens du chemin de fer, le jardin botanique avec sa serre qui semble un palais de féerie, et dont les vitres se teignent des ardentes lueurs du soir. Voilà Bruxelles dans son beau, dans sa parure féodale, portant, comme des bijoux d’ancêtres, ses toits sculptés, ses clochetons et ses tourelles. Il faut redescendre et plonger dans les rues pour s’apercevoir qu’elle a revêtu les oripeaux modernes et n’a gardé du temps passé que sa coiffe étrange et splendide.
La rue Royale, garnie de palais et d’hôtels aristocratiques, est éclairée déjà d’un double rang de candélabres à gaz. Les dernières teintes du soir dessinent à gauche les arbres effeuillés du parc, ses blanches statues, ses ravins factices où reposent les soldats hollandais de septembre ; le palais de la Nation, d’architecture classique, avec colonnes et fronton, s’étend encore à gauche du jardin. Six ministères font partie de cette vaste ligne de bâtimens. En se dirigeant le long du parc, vers la place Royale, on rencontre, au milieu d’une trouée de maisons donnant encore sur la ville-basse, la statue élevée récemment au général Belliard. Une terrasse, chargée de balustres et de vases antiques, se profile plus loin sur le ciel jusqu’à la montagne de la Cour et donne aux bâtimens qui l’accompagnent les airs d’une villa romaine. Le parc s’arrête à cet endroit de l’autre côté de la rue, et borde encore de ses gracieux ombrages la place irrégulière du palais Léopold. Ce palais est modeste et contemple humblement celui de la Nation, situé à l’autre extrémité du parc, avec son arbre de liberté planté au milieu de sa cour.
La place Royale commence en retour d’équerre de cette longue ligne de bâtimens ; c’est là le centre aristocratique de Bruxelles, comme la place du marché en est le centre populaire, comme la place de la Monnaie en est le centre industriel et bourgeois. Une église, en forme de temple, occupe le fond de ce carré régulier d’hôtels et de palais modernes, et fait face à la rue de la Montagne, qui, prolongée de celle de la Madeleine, est devenue la grande artère de la circulation et du commerce bruxellois. Cette voie lumineuse est toujours frémissante de foule et de voitures, serpente longuement de la ville haute à la ville basse, avec ses tournans, ses places étroites, ses descentes rapides, le luxe antique de ses maisons sculptées, l’éclat moderne de ses boutiques parisiennes, dont la double ligne, rayonnante de gaz, de marbre et de dorures, ne s’interrompt pas un seul instant. Ce long bazar a plusieurs appendices encore qui s’en vont animer les quartiers voisins. Hors de là, tout est calme et sombre ; le gaz des réverbères et des estaminets n’éclaire plus que de longs quartiers solitaires, ou des faisceaux de ruelles inextricables, des bassins, des bras de rivière obstrués de masures ; les longs boulevards qui donnent sur la campagne, les quais multipliés qui bordent les canaux, les estaminets même sont paisibles quoique remplis de monde. Quelquefois seulement, une rue en kermesse étale ses transparens, ses illuminations et ses images de héros saints ou profanes, et fourmille de danseurs, de musiciens et de chanteurs, sans que sa joie et son enthousiasme se répandent plus loin.
Le jour, la physionomie de la ville n’offre rien de plus remarquable ; c’est la vie de Paris dans un cercle étroit. Seulement le peuple dîne vers une heure, les bourgeois de trois à quatre, les gens riches de cinq à six. Le soir, les estaminets, les cercles et les théâtres se disputent ces divers élémens de la population. On sait qu’à l’époque des combats de septembre les Hollandais et les Belges suspendaient d’un commun accord les hostilités, vers une heure, pour aller dîner, et vers sept heures du soir pour aller passer leur soirée à l’estaminet. Ces peuples se comprenaient du moins dans ces habitudes régulières de la vie flamande. Le Parc et le boulevard de Waterloo sont le rendez-vous du beau monde vers le milieu du jour. Là circulent les brillans équipages qui, pour de plus longues promenades, se dirigent vers Laecken ou vers les campagnes charmantes situées hors de la porte de Louvain. Là sont les maisons de plaisance, les villas, les châteaux princiers.
On sait combien la religion est toujours puissante en Belgique ; aussi les églises présentent partout un air de vie qui satisfait. Les sonneries retentissent souvent ; mais les carillons ont disparu de Bruxelles, et, dans les autres villes même, n’exécutent plus guère que des airs d’opéras. Je ne parlerai pas de Sainte-Gudule, de sa chaire bizarrement sculptée, de ses magnifiques vitraux de la renaissance qui vous font rêver en plein Brabant l’horizon bleu de l’Italie, traversé de figures divines. Le musée s’est bien appauvri par la restitution des tableaux du prince d’Orange. Il offre encore quelques Rubens, quelques Van Dyck et un Jordaens célèbre. Tout cela a été décrit bien des fois. La bibliothèque, située dans le bâtiment du musée qui communique à la place Royale, est connue surtout par une magnifique collection de manuscrits. Dans une autre aile se trouvent le musée de l’Industrie, et une collection d’armures antiques assez pauvre pour un tel pays. Ajoutez à cela des Instituts, des Conservatoires, des écoles des Beaux-Arts, aussi nombreux qu’à Paris et aussi utiles, et répondant surtout à la prétention qu’ont les Belges de ne nous être inférieurs en rien !
Bruxelles s’agrandit ; cette ville est bâtie, comme on sait, sur le versant peu modéré, pour nous servir d’une expression de Sainte-Beuve, de l’unique montagne du Brabant ; c’est l’enfer des chevaux bien plus que Paris. Ces animaux auraient plus de plaisir à monter au clocher de Compostelle qu’à gravir la rue de la Madeleine et la rue de la Montagne. Aussi Bruxelles commence à se diviser en ville haute et en ville basse, qui n’auront bientôt ensemble aucune communication. Il est plus simple pour l’habitant de la place de la Monnaie de se rendre à Anvers que sur la place de la Montagne de la Cour. Aussi, pour que la population croissante trouvât des plaisirs à sa portée et à sa hauteur, a-t-on imaginé d’agrandir le théâtre du Parc, et d’y faire jouer l’opéra-comique, afin d’épargner aux habitans des hauts-lieux le voyage du théâtre de la Monnaie, et, comme ce dernier gagne des spectateurs en raison de l’agrandissement de la ville basse, on a créé sur le boulevard extérieur un théâtre des Nouveautés, qui est le prodige de l’optique et qui marche à la vapeur.
Ce théâtre laisse bien en arrière nos théâtres parisiens. Tout y est nouveau, l’éclairage, les décorations, le ciel, le jeu des machines. Malheureusement l’homme vient gâter ce séduisant ensemble ; il existe sur la scène une illusion que le jeu des acteurs détruit souvent ; on pourrait dire qu’au théâtre une décoration trop vraie fait paraître l’acteur plus faux.
Imaginez d’abord une salle ronde couverte d’une coupole de cristal ; il n’y a pas de lustre, mais des becs de gaz nombreux, disposés au-delà des verres dépolis, et dont le reflet seul est visible, versent sur l’assemblée une lumière douce, pareille à celle du jour ; des guirlandes de fleurs transparentes parcourent le ciel factice, où les lueurs mobiles imitent l’éclat des nuages pourprés. C’est charmant, c’est idéal, et cela éclaire peu ; mais des girandoles nombreuses sont placées aux premières galeries, et ne diminuent leur lumière que pour les scènes de nuit, où ce système d’éclairage triomphe incontestablement.
Tournez-vous maintenant vers la scène, et vous y verrez d’autres merveilles. Et d’abord, plus de ces affreux morceaux de toile que l’on appelle des bandes d’air, plus de ces nuages tachés et recousus qui sont plus lourds que les arbres et les maisons. Le fond du théâtre est occupé par un ciel invariable, ayant la forme d’une demi-coupole, et où les gradations et dédradations de lumière s’exécutent admirablement. Un vrai soleil, une vraie lune, c’est-à-dire deux globes lumineux, éclairent tour à tour, comme dans la nature, ce ciel magique, au delà duquel on pourrait soupçonner l’infini. Un oiseau s’y briserait les ailes ; des reflets de transparens y projettent les brouillards ou les nuages ; le soleil s’y couche ou s’y lève au milieu des vapeurs pourprées ; on obtient des soleils d’Italie ou des soleils de Flandre, selon le besoin.
Songez maintenant à nos décorations arriérées, à nos portans de coulisses, à nos files de quinquets, à nos praticables : rien de tout cela n’existe au théâtre des Nouveautés ; le procédé est le plus simple du monde : on a placé autour de la scène une vaste toile en hémicycle, découpée pour les toits ou le sommet des arbres, et qui se profile en perspective sur le ciel. La décoration placée, on ouvre comme des portes certaines parties destinées à faire avance ou à fournir un passage aux acteurs ; c’est l’affaire d’un instant. Ces vastes toiles, pliées en trois sur elles-mêmes, descendent des frises toutes seules par l’effet d’une machine à vapeur placée sous le théâtre ; le travail des machinistes se borne à les déployer ; le tout se meut sans plus d’embarras qu’un théâtre de marionnettes. Ainsi, là encore, la machine a détrôné l’homme ; quel malheur qu’elle ne puisse pas se substituer aux acteurs !
Ce beau théâtre n’a en ce moment-ci qu’un seul défaut. Il est fermé.
GÉRARD DE NERVAL.
_______