GÉRARD DE NERVAL - SYLVIE LÉCUYER tous droits réservés @
CE SITE / REPÈRES BIOGRAPHIQUES / TEXTES / NOTICES / BELLES PAGES / MANUSCRITS AUTOGRAPHES / RECHERCHES AVANCÉES
NOTICES
« Les images de deuil et de désolation qui ont entouré mon berceau »
La Généalogie fantastique, Labrunie et Bonaparte, qui suis-je
les Dublanc
les Labrunie
les Paris de Lamaury
les Olivier
les Boucher
les Laurent
Carte des itinéraires valoisiens de Nerval
Le temps vécu de la petite enfance (1810-1815)
Le clos Nerval
L’oncle Antoine Boucher
Voix et Chansons
Les plaisirs et les jeux
Le temps des retours en Valois (1850-1854):
Le Valois transfiguré: Aurélia
Promenades en Valois, diaporama
LES ANNÉES CHARLEMAGNE
Père et fils rue Saint-Martin
Les cahiers de poésies de 1824
Le collège Charlemagne
Satiriste, anticlérical et anti-ultra
Auteur à 17 ans chez Ladvocat et Touquet
Pseudonyme Beuglant
LA CAMARADERIE DU PETIT CÉNACLE
1830, les Trois Glorieuses
Se rallier à Victor Hugo
L’atelier de Jehan Duseigneur
Traduire les poètes allemands
« En ce temp, je ronsardisais »
« Arcades ambo »
Jenny Colon
Le Monde dramatique
Le choix du nom de Nerval
La fin du Doyenné
L’expérience napolitaine:
Un Roman à faire
Octavie
Le Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi
Élaboration fantasmatique et poétique:
A J-y Colonna
El Desdichado
Delfica
Myrtho
LE VOYAGE EN ALLEMAGNE DE 1838
« La vieille Allemagne notre mère à tous, Teutonia ! »
De Strasbourg à Baden et de Baden à Francfort
Les quatre lettres de 1838 au Messager
Les trois lettres de 1840 dans La Presse
Retour à Paris. Léo Burckart, heurs et malheurs du « beau drame allemand »
Les deux Léo Burckart
Espoir de reconnaissance et humiliation
Diplomate ou bohème?
Les Amours de Vienne
L’expérience viennoise fantasmée
Les Amours de Vienne. Pandora
Schönbrunn, belle fontaine et Morte fontaine
Décembre 1840 à Bruxelles
Les journées de février-mars 1841 à Paris
Les feuillets Lucien-Graux
Lettres à Bocage, Janin et Lingay
Hantise du complot
Éblouissement poétique:Lettres à Victor Loubens et à Ida Ferrier
Les sonnets « à Muffe »
L’itinéraire de Paris vers l’Orient: Marseille et Trieste
Le compagnon de voyage Joseph de Fonfrède
Escales dans l’Archipel grec :
Cythère
Syra
Visite aux pyramides
Adoniram et Balkis, Les Nuits du Ramazan :
Le projet de 1835
Le récit du conteur
Échos psychiques et littéraires
LE REGARD DES AUTRES
THÉOPHILE GAUTIER (1811-1872)

Théophile Gautier passe pour le meilleur ami de Nerval. Amitié d’enfance, née sur les bancs du collège Charlemagne, continuée par le compagnonnage du petit Cénacle puis du Doyenné, confirmée par un contrat commun chez Renduel pour une œuvre à deux qui ne fut jamais écrite, voyage de concert en Belgique, engagement commun à La Presse par Girardin, correspondance abondante par laquelle on sait que Nerval dormait souvent chez Gautier, Gautier enfin, pleurant à chaudes larmes devant le corps de Nerval au matin du 26 janvier 1855. Mais il y a cette image de Nerval pour parler d’eux : les Dioscures, ces jumeaux dont l’un disparaît quand l’autre apparaît… des voyages multiples, mais qu’ils ne firent plus jamais ensemble après la Belgique, et finalement l’impression, en lisant des articles publiés par Gautier sur Nerval, d’une sorte de gêne : ami trop encombrant, mal compris, sentiment de culpabilité rétrospective ? Gautier est de ceux qui soutiendront la thèse de l’assassinat contre celle du suicide.
Même sujet d’étonnement, à propos d’une amitié réputée si vive, concernant les lacunes dans l’autoportrait publié en 1874 sous le titre Portraits contemporains. De ses années à Charlemagne, Gautier dit seulement de façon laconique : « De ces années de collège, il ne me reste aucun souvenir agréable, et je ne voudrais pas les revivre ». De l’impasse du Doyenné, il dit seulement qu’y habitaient aussi Camille Rogier, Gérard de Nerval et Arsène Houssaye. À propos de La Presse, il dit : « On me chargea du feuilleton dramatique de La Presse qu je fis d’abord avec Gérard et ensuite tout seul pendant plus de vingt ans ».
1836, Un Tour en Belgique :
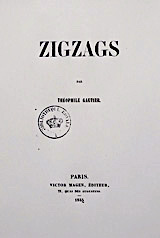
Gautier publie dès septembre 1836 plusieurs articles sur le voyage en Belgique entrepris avec Nerval en juillet. Nerval, lui n’a jamais rien publié sur ce voyage. Gautier reprend ses articles en volumes dans Zigzags en 1845 sous le titre: Un Tour en Belgique. Dans ce récit alerte et allègre du voyage en quête de la « femme Rubens », l’image de Nerval (« mon brave camarade Fritz »), est donnée sur le ton de la blague étudiante, mais quelque peu désobligeante :
En chemin vers la Belgique :
« Je ne vous ferai pas la topographie de mon illustre camarade, de peur d’offenser sa modestie et de violer son incognito. Vous y perdez beaucoup : car, dans cette heureuse expédition à la recherche du bouffon, ce que j’ai vu de plus bouffon, c’est très certainement lui ; je vous dirai seulement qu’il ne jeta pas une fois les yeux sur le pays qu’il traversait, et qu’il employait tout son temps à lire la Nouvelle Héloïse ou la Fleur des exemples, occupation on ne peut plus édifiante. »
À l’auberge :
« Quoique, mon ami et moi, nous eussions tâché de n’être pas à table à l’auberge à côté d’une dame, de peur d’être obligés de nous montrer honnêtes et galants, chose fort ennuyeuse quand on veut dîner sérieusement, nous ne pûmes éviter qu’il s’en trouvât une à notre droite. J’avoue que rien au monde ne me déplaît comme de donner à une inconnue, faite de façon à vous estimer heureux de ne l’avoir jamais rencontrée, la seule chose que je puisse manger d’un poulet, c’est-à-dire l’aile et le blanc. Fritz, qui vit ma douleur, tourna habilement la difficulté, en prenant au passage de l’assiette tout ce que le poulet pouvait avoir d’ailes. Par cette manœuvre savante, je ne pus offrir à la dame ni aile ni blanc, Fritz les ayant confisqués d’autorité ; je pris par contenance un petit morceau de peau grillée, et la dame désappointée n’eut pour sa part qu’une cuisse filandreuse et sèche comme elle-même ; puis, le magnanime Fritz, feignant d’avoir eu les yeux plus grands que le ventre, me repassa la moitié de sa capture : de cette façon, je mangeai l’aile, et je n’eus pas l’air malhonnête, et le beau sexe de la diligence put garder une opinion favorable de moi.
Voilà de ces actions dont on se souvient jusqu’au monument, et qui forment des amitiés indissolubles : Oreste et Pylade, Énée et Achate, Thésée et Pirithous s’étaient sans doute rendu de pareils services à tables d’hôtes. Ô amitié ! quoique M. Alexandre Dumas t’appelle dans Antony un sentiment faux et bâtard, je te proclame ici une chose fort agréable et supérieure à l’amour, sous le rapport des ailes de poulet. »
En voiture, de nuit, entre Courtenay et Péronne, comme une prémonition de la rue de la Vieille Lanterne :
« Pour Fritz, il s’avisa d’un moyen de dormir, qu’un autre eût employé pour se tenir éveillé : il noua son foulard par les deux bouts à la vache de la voiture, passa son mufle dans cette espèce de licol, et but bientôt, à pleines gorgées, à la noire coupe du sommeil. Ce qui m’a beaucoup surpris, c’est qu’il ne se soit pas étranglé bel et bien ; apparemment que Dieu, toujours bon, toujours paternel, veut lui épargner la peine de se pendre lui-même. »
À la frontière, durant la visite des bagages par la douane :
« En attendant que la visite fût finie, nous nous jetâmes, tout altérés de couleur locale et crevant en outre de soif, dans le triomphant estaminet du Lion belge, où nous nous répandîmes dans le corps plus de bière qu’il n’en pouvait raisonnablement tenir. Ce fut un mélange de faro, de lambic, de bière blanche de Louvain, à mettre à flot l’arche de Noé. Nous prîmes aussi du café belge, du genièvre belge, du tabac belge, et nous nous assimilâmes la Belgique par tous les moyens possibles. »
De côté de Mons, toujours pas de « femme Rubens »
« Vers cette latitude, une inquiétude sérieuse vint me prendre au collet. Le lecteur n’a sans doute pas oublié les causes de mon excursion dans ces régions polaires et arctiques, et que, comme un autre Jason, j’étais parti pour aller conquérir la toison d’or, ou, pour parler en style plus humble, chercher la femme blonde et le type de Rubens ; but innocent et louable s’il en fut. Je n’avais pas encore vu une seule femme blonde, quoique j’eusse mon télescope constamment braqué, et que mon ami Fritz regardât à gauche, tandis que j’explorais le côté droit de la route, de peur de laisser passer, dans un moment de distraction ou de négligence, quelque Rubens sans cadre, sous forme d’une honnête Flamande.
Je communiquai mes craintes au digne Fritz qui, avec le beau sang-frois qui le caractérise dans toutes les occasions difficiles de sa vie, me répondit qu’il ne fallait pas encore perdre courage ; que Rubens était d’Anvers, et que c’était probablement à Anvers que se trouvaient les modèles de ses tableaux ; mais que si à Anvers (en flamand Antwerpen) je ne rencontrais pas de blonde, non seulement il me permettrait de me désespérer, mais encore il m’y engagerait de son mieux, et ne me refuserait même pas la douceur de me jeter dans l’Escaut, canalisé ou non, à mon choix. »
Premières promenades dans Bruxelles ; de jeunes ouvrières se mettent à rire en les voyant :
« Elles éclatèrent de rire comme un cent de mouches, et parurent nous trouver très bouffons, moi surtout, à cause de mes cheveux longs, et Fritz, pour une raison que je n’ai pas bien démêlée, car il n’avait rien que de très majestueux en soi-même, et son aspect, ce soir-là, était des plus convenables.
Nous nous lançames ensuite à travers la ville, à tout hasard, comme deux sangliers dans un fourré. Fritz, qui a un mouvement particulier d’aileron qui le fait marcher en volant, et voler en marchant, à l’instar des autruches, allait devant ; moi, je suivais bien loin derrière en soufflant comme un dogue qui a avalé une fourchette en léchant un chaudron, et d’autant plus inquiet que j’avais oublié le nom de la rue où était l’auberge. »
La nuit, un rêve de Nerval, et le lendemain, de la bière encore :
« Quant au sommeil belge, il est exactement pareil au sommeil parisien. Seulement, Fritz rêva qu’il se baignait dans la rivière jaune de la Chine, et qu’il avait eu une indigestion de nids d’hirondelles, en sortant de souper avec un mandarin dont les ongles avaient huit pouces de long. Voilà ce qui se passa de plus remarquable dans cette nuit.
Le matin nous déjeunâmes comme un troupeau de lions à jeun depuis quinze jours, et je n’ose dire par modestie ce que nous nous infiltrâmes de bière dans le corps. Après cela, nous sentîmes un besoin prononcé de rouler par la ville le tonneau de faro et de lambic que nous avions caché sous notre peau. »
Le récit se termine par la visite de la cathédrale d’Anvers, où se trouvent les « trois Rubens miraculeux ». Gautier passe donc sous silence la détérioration de la santé de Nerval au cours de ce voyage.
______

L'Histoire du romantisme, publiée en 1874, évoque le compagnonnage des jeunes années, de 1830 à 1834 :
La génération de 1830 :
"Les générations actuelles doivent se figurer difficilement l'effervescence des esprits à cette époque ; il s'opérait un mouvement pareil à celui de la Renaissance. Une sève nouvelle circulait impétueusement. Tout germait, tout bourgeonnait, tout éclatait à la fois. Des parfums vertigineux se dégageaient des fleurs ; l'air grisait, on était fou de lyrisme et d'art. Il semblait qu'on vînt de retrouver le grand secret perdu, et cela était vrai, on avait retrouvé la poésie 〈...〉 Dans l'armée romantique comme dans l'armée d'Italie, tout le monde était jeune. " (Chapitre I, "Premières rencontres" )
Le petit Cénacle, chez Jehan Du Seigneur, rue de Vaugirard :
" Dans une petite chambre qui n'avait pas de sièges pour tous ses hôtes, se réunissaient des jeunes gens véritablement jeunes et différents en cela des jeunes d'aujourd'hui, tous plus ou moins quinquagénaires. Le hamac où le maître du logis faisait la sieste, l'étroite couchette dans laquelle l'aurore le surprenait souvent à la dernière page d'un volume de vers, suppléaient à l'insuffisance des commodités de la conversation. On n'en parlait que mieux debout, et les gestes de l'orateur ou du déclamateur ne s'en développaient que plus amplement 〈...〉
La chambre était pauvre, mais d'une pauvreté fière et non sans quelque ornement. Un passe-partout de sapin verni contenait des croquis d'Eugène et d'Achille Devéria ; auprès du passe-partout, une baguette d'or encadrait une tête de Louis Boulanger d'après Titien ou Giorgione, peinte sur carton, en pleine pâte, d'un ton superbe. Sur un pan de mur, un morceau de cuir de Bohème, à fond d'or, gaufré de couleurs métalliques, avait non pas la prétention de tapisser la chambre, mais d'étaler, pour le plaisir des peintres, un fauve miroitement d'or et de tons chatoyants dans un angle obscur 〈...〉
La réunion se composait habituellement de Gérard de Nerval, de Jehan du Seigneur, d'Auguste Mac Keat, de Philothée O'Neddy (chacun arrrangeait un peu son nom pour lui donner plus de tournure, de Napoléon Tom, de Joseph Bouchardy, de Célestin Nanteuil, un peu plus tard, de Théophile Gautier, de quelques autres encore, et enfin de Pétrus Borel lui-même 〈...〉 Gérard était parmi nous le seul lettré dans l'acception où se prenait ce mot au milieu du XVIIIe siècle." (Chapitre II, "Le petit Cénacle")
Les dîners du petit Cénacle chez Graziano, à la barrière de l'Étoile :
"C'était en 183..., les Champs-Élysées n'avaient pas l'aspect brillant et fastueux qu'ils ont maintenant ; la solitude s'y accouplait à l'ombre, dans de grands espaces vagues ; sous des arbres où n'arrivaient plus les rayons des réverbères, des spectres obscènes ou sinistres se glissaient. Quelques cafés borgnes occupaient le centre des carrés dont les arbres avaient longtemps gardé marquée la dent des chevaux d'Ukraine 〈à noter que dans Promenades et Souvenirs, Nerval écrit : "les cavales de l'Ukraine rongèrent encore une fois l'écorce des arbres de nos jardins"〉. Bien petit était le nombre des maisons groupées près de la chaussée ; le mouvement de la population ne s'était pas encore porté par là.
Les deux rotondes de la barrière de l'Étoile, avec leurs colonnes aux assises alternativement rondes et carrées, subsistaient encore et même ne faisaient pas mal au bout de la perspective 〈...〉 la grande route de Neuilly gagnait Courbevoie accompagnée de plus d'arbres que de maisons à travers des terrains vagues ou de limites de planches situés en contrebas de la chaussée. Dans ces steppes poussiéreux brillait, comme le coquelicot sur le bord d'un de ces champs de blé de la banlieue ravagé par les flâneurs et flâneuses du dimanche, le cabaret unique qui s'appelait en ce temps-là Petit Moulin Rouge, qu'on est prié de ne pas confondre avec le Grand Moulin Rouge de l'allée des Veuves ; l'installation, la chère, la compagnie surtout y différaient. On n'y voyait ni lorettes, ni cocottes, ni biches, ni petites dames, ni figurantes de la danse ou du chant, ni même de grisettes. L'armée des mercenaires n'était pas encore entrée en campagne, et d'ailleurs, comme le disait Gérard de Nerval, en ce temps-là il y avait encore des amours. Il fallait entendre avec quels accents de galanterie, surannée à dessein et remontant aux délicatesses du bon vieux temps, il disait ces mots. C'était tout un poème. Chacun de nous avait dans son coin sa Laure ou sa Béatrix pour laquelle il rimait 〈...〉
Le premier cénacle avait eu sa mère Saguet, le second cénacle eut Graziano, et nous ne fûmes pas médiocrement fiers de notre Napolitain, qui faisait la cuisine à de pauvres ouvriers italiens, heureux de retrouver dans cette banlieue les pâtes et le fromage de leur patrie. Non seulement nous faisions de la couleur locale dans nos vues et dans nos tableaux, mais nous en mangions 〈...〉
Au fond, cela n'avait rien de titanique de manger du macaroni au cabaret, et les foudres ne devaient pas s'en émouvoir dans l'arsenal céleste. Il eût fallu pour donner du ragoût et du montant à la petite fête, quelque chose de risqué, d'audacieux, de révolté, de byronien, de satanique en un mot.
Nous admirions fort les prouesses du jeune lord et ses bacchanales nocturnes dans l'abbaye de Newstead 〈...〉 il est vrai qu'il nous manquait Newstead, les cloîtres se prolongeant dans l'ombre, le cygne se jouant dans l'eau diamantée sous un rayon de lune, peut-êre bien aussi les jeunes pécheresses blondes, brunes, ou même rousses ; mais on pouvait se procurer un crâne ; ce fut Gérard de Nerval qui s'en chargea. Son père, en sa qualité de chirurgien d'armée, avait une assez belle collection anatomique.
Le crâne avait appartenu à un tambour-major tué à la Moskova, et non à une jeune fille morte de la poitrine, nous dit Gérard, et je l'ai monté en coupe au moyen d'une poignée de commode en cuivre fixée à l'intérieur de la boîte osseuse par un écrou tourné sur un pas de vis. On remplit la coupe, on la fit passer à la ronde, et chacun en approcha ses lèvres avec une répugnance plus ou moins bien dissimulée" (Chapitre V, "Graziano")
Le Doyenné. Gautier parle désormais de lui à la première personne du pluriel :
« Nous habitions alors impasse du Doyenné. Camille Rogier avait un appartement assez vaste, dans une vieille maison tout près d’une église en ruine, dont un reste de voûte faisait un assez bel effet au clair de lune, et dont les fenêtres donnaient sur des terrains vagues encombrés de pierres de taille entre lesquelles verdissaient les orties, et que la galerie du Louvre baignait de son ombre froide. Arsène Houssaye et Gérard demeuraient avec Camille et faisaient ménage commun. Nous occupions tout seul, dans la même rue, un petit logement où nous ne rentrions guère que la nuit, car nous passions les journées avec les camarades dans le grand salon de Rogier, vaste pièce aux boiseries tarabiscotées et ornées de rocaille, aux glaces d’un cristal louche surmontées d’impostes, aux étroites fenêtres vitrées de petits carreaux à la mode de l’autre siècle. Comme une ombre des marquises d’autrefois, errait dans ce logis fantastique, avec un œil de poudre sur ses blonds cheveux et une rose pompon à la main, cette jolie et délicate Cydalise, pastel sans cadre que devait effacer, au sortir du bal, un aigre souffle de bise. Ce fut dans cet appartement qu’eut lieu cette fête où, selon le conseil de Gérard, les rafraîchissements furent remplacés par des fresques barbouillées sur les vieilles boiseries grises, au grand effroi du propriétaire, qui considérait les peintures comme des taches. Corot, Adolphe Leleux, Célestin Nanteuil, Camille Rogier, Lorentz, Chassériau, alors bien jeunes, exercèrent leurs brosses et improvisèrent des fantaisies charmantes. Rogier, qui dessinait de très fines illustrations pour les Contes d'Hoffmann, et gagnait assez d'argent pour s'acheter des bottes à l'écuyère et des habits de velours nacarat, sur lesquels s'étalait sa magnifique barbe rousse, objet de notre envie, ayant à faire des dessins pour les Mille et une Nuits, partit pour l'Orient, où il resta et devint directeur des Postes de Beyrouth. Réduite à trois, l'association se transporta rue Saint-Germain-des-Prés. Nous faisions notre cuisine nous-mêmes, Arsène Houssaye excellait dans la panade, nous dans la confection du macaroni. Gérard allait, avec l'aplomb le plus majestueux, chercher de la galantine, des saucisses ou des côtelettes de porc frais aux cornichons chez le charcutier voisin. Nous vivions ainsi de la façon la plus amicale, et ce sont les plus belles années de notre vie. Gérard, qui dormait très peu, lisait fort avant dans la nuit et avait trouvé un singulier mode d'éclairage : il posait en équilibre sur sa tête un de ces larges chandeliers de cuivre qu'on appelle martinet, et la lueur se projetait sur les pages ouvertes ; mais quelquefois le sommeil le gagnait et le chandelier tombait, au risque de mettre le feu au lit. Michel-Ange et Girodet peignaient nocturnement de la sorte." (Préface aux Œuvres complètes de Gérard de Nerval, édition Michel Lévy, 1868)
Le chapitre VIII de l'Histoire du romantisme est consacré à Nerval, mais s'arrête aux années 1830-1834 :
"Ce n'était pas un homme de cabinet que Gérard. Être enfermé entre quatre murs, un pupitre devant les yeux, éteignait l'inspiration et la pensée ; il appartenait à la littérature ambulante comme Jean-Jacques Roussea et Restif de la Bretonne, et ne perdait pas son temps dans ses courses, qui toutes avait un but d'obligeance ou de bonne camaraderie.
Il travaillait en marchant et de temps à autre il s'arrêtait brusquement, cherchant dans une de ses poches profondes un petit cahier de papier cousu, y écrivait une pensée, une phrase, un mot, un rappel, un signe intelligible seulement pour lui, et refermant le cahier reprenait sa course de plus belle. C'était sa manière de composer. Plus d'une fois nous lui avons entendu exprimer le désir de cheminer dans la vie le long d'une immense bandelette se repliant à mesure derrière lui, sur laquelle il noterait les idées qui lui viendraient en route de façon à former au bout du chemin un volume d'une seule ligne. Cet esprit était une hirondelle apode. Il était tout ailes et n'avait pas de pieds, tout au plus une imperceptible griffe pour se suspendre un moment aux choses et reprendre haleine ; il allait, venait, faisait de brusques zigzags aux angles imprévus, montait, descendait, montait plutôt, planait et se mouvait dans le milieu fluide avec la joie et la liberté d'un être qui est dans son élément 〈image toute baudelairienne d'Élévation : " mon esprit tu te meus avec agilité, Et comme un bon nageur que se pâme dans l'onde ... "〉 Ce n'était pas chez lui mobilité inquiète, légèreté frivole, sautillement fantasque, mais agilité d'allure, aisance à flotter et à s'élever.
Quelquefois on l'apercevait au coin d'une rue, le chapeau à la main, dans une sorte d'extase, absent évidemment du lieu où il se trouvait, ses yeux étoilés de lueurs bleues, ses légers cheveux blonds déjà un peu éclaircis faisant comme une fumée d'or sur son crâne de porcelaine, la coupe la plus parfaite qui ait jamais enfermé un cervelle humaine, gravissant les spirales de quelque Babel intérieure. Quand nous le rencontrions ainsi absorbé, nous avions garde de l'aborder brusquement, de peur de le faire tomber du haut de son rêve comme un somnambule qu'on réveillerait en sursaut, se promenant les yeux fermés et profondément endormi sur le bord d'un toit. Nous nous placions dans son rayon visuel et lui laissions le temps de revenir du fond de son rêve, attendant que son regard nous rencontrât de lui-même, et il rentrait bien vite, en apparence du moins, dans la vie réelle, par quelque mot amical ou spirituel 〈...〉 Il n'y avait pas alors le moindre nuage noir dans le ciel d'aurore, il était impossible d'y découvrir les germes des désastres futurs 〈...〉
Mais jouissons tranquillement de cette aube sans nuage et revenons au Gérard de ce temps-là, qui ne s'appelait pas Gérard de Nerval, mais Labrunie. Gérard était son nom de baptême. Comme Stendhal, il aimait à dissimuler sa personnalité sous différents pseudonymes ; quand il se sentait reconnu sous son faux nez, il le jetait et prenait un autre masque et un autre domino. Il a signé successivement Fritz, Aloysius et autres noms, et il sera difficile aujourd'hui de reconnaître ses œuvres dans les catacombes poudreuses du journalisme 〈...〉
Son nom prononcé le faisait subitement disparaître. Des journax en vogue jouissant d'une grande publicité et d'un grand renom littéraire lui demandaient sa collaboration ou des articles. Il préférait les enfouir dans quelque petite feuille obscure, peu rétribuée, aux abonnés problématiques, comme s'il eût été heureux de n'être pas lu ⎼ singulier bonheur ! ⎼ mais que l'on conçoit pourtant avec certaines âmes fières et délicates qu'un éloge maladroit choque autant qu'une critique brutale.
A cette époque d'excentricité où chacun cherchait à se signaler par quelque singularité de costume, chapeau de feutre mou à la Rubens, manteau à pan de velours jeté sur l'épaule, pourpoint à la Van Dyck, polonaise à brandebourgs, redingote hongroise soutachée, ou tout autre vêtement exotique, Gérard s'habillait de la façon la plus simple, la plus invisible pour ainsi dire, comme quelqu'un qui veut passer dans la foule sans être remarqué. Il portait l'été des vêtements d'orléans noire, et l'hiver un paletot bleu foncé auquel on aurait recommandé de ressembler au paletot de tout le monde ; peut-être ne voulait-il être connu et digito monstrari et diceri : hic est que lorsqu'il serait digne de la réputation et qu'il aurait approché assez de son idéal pour être confronté avec lui sans rougir.
Gérard, nous ne savons trop pourquoi, a toujours passé pour être paresseux comme une couleuvre. C'est une réputation qu'on a faite à bien d'autres qui ont travaillé toute leur vie, à qui on pourrait faire un bûcher de leurs œuvres. Ce bayeur aux corneilles, ce chasseur de papillons, ce souffleur de bulles, ce faiseur de ronds dans l'eau menait au contraire l'existence intellectuelle la plus active. Sous une apparence paisible, il vivait dans une grande effervescence intérieure. A cette époque il faut reporter une Laforêt qui représentait Molière chez lui avec cette servante au grand cœur et de grand bon sens 〈...〉 C'était un pastiche du style de Molière, fait avec une science profonde de la langue, du style et des allures de style du XVIIe siècle si profondément ignoré des classiques modernes qui ne jurent que par lui. Le tout maintenu dans une gamme de tons amortis si harmonieuse que la décoration du temps donne aux vieilles tapisseries. Nous ignorons ce que cette comédie qui avait été reçue à l'Odéon, si nos souvenirs ne nous trompent, peut être devenue.
On ignore également au fond de quel tiroir à la clef perdue depuis longtemps, au fond de quelle malle oubliée et de quel grenier hanté des rats, est allé, après bien des vicissitudes, échouer Le Prince des sots, une imitation des plus spirituelles et des mieux réussies des grandes Dyableries du Moyen-Âge. Le Prince des sots, dont l'argument était une troupe de jongleurs s'introduisant, sous prétexte de représentation, dans un château féodal, pour enlever une beauté retenue par un père ou un mari tyrannique, contenait une petite pièce renfermée dans la grande, comme ces boules d'ivoire que la dextérité patiente des Chinois sculpte les unes dans les autres. C'était un mystère à la façon gothique qui avait pour décoration une gueule d'enfer toute rouge, surmontée d’un paradis bleu tout constellé d'or. Un ange descendu des voûtes bleues jouait avec le diable des âmes aux dés. Nous ne nous rappelons plus quel était l'enjeu de l'ange. Par excès de zèle, et pour ramener plus d'amis au ciel, l'ange trichait. Le diable se fâchait et appelait l'ange "grand dadais, céleste volaille", et le menaçait, s'il récidivait, "de lui plumer les ailes", ce qui l'empêcherait de remonter chez son patron. La querelle s'envenimait, et il en naissait un tumulte dont l'amoureux, protégé par le prince des sots, profitait pour enlever sa maîtresse. Le mystère était écrit en vers de huit pieds, comme les anciens mystères.
Le Prince des sots était précédé d'un prologue de notre composition 〈...〉 Nous avions même joint au manuscrit un dessin colorié représentant la gueule d'enfer avec une naïveté gothique affectée. Nous donnons ce renseignement et ce signalement à notre cher ami et confrère Charles Asselineau, l'archiviste Lindurst du romantisme, qui retire de l'oubli tous ces volumes aux vignettes étranges, à la typographie caractéristique, qu'il catalogue, décrit, adorne avec l'enthousiasme minutieux du vrai bibliophile. M. Asselineau, comme tout être délicat favorisé par le ciel d'une jolie manie, a sa tulipe noire, son dahlia bleu, son desideratum ; il voudrait posséder en original de Gérard 〈...〉
Toutes les idées de la jeunesse étaient tournées vers le théâtre, ce centre lumineux vers lequel convergent les attentions les plus diverses 〈...〉 Le roman-feuilleton n'était pas inventé. Le théâtre était donc le seul balcon où le poète pût se montrer à la foule, aussi fabriquait-on beaucoup de drames dans le petit cénacle.
Il va sans dire qu'ils étaient tous uniformément refusés. Cependant nous avons de la peine à croire qu'ils fussent uniformément mauvais, et nous regrettons la perte d'un drame en vers de Nerval, la Dame de Carouge, auquel nous avions largement collaboré et qui contenait au moins un idée originale. C'était l'histoire d'un captif, un émir arabe ou sarrasin, ramené de Palestine par un baron croisé, et devenant amoureux de le châtelaine. Le contraste de l'islam et du christianisme, de la tente nomade et du donjon féodal, de la froideur du Nord et des passions ardentes du désert, de la férocité sauvage et de la chevalerie, exprimé en vers qui ne devaient manquer ni d’énergie ni de beauté, ou tout au moins de facture, car les élèves de Victor Hugo savent faire des vers, nous semblait devoir prêter à quelques situations dramatiques. Ce parut être l'opinion d'Alexandre Dumas, qui, cinq ou six ans plus tard, fit sur cette donnée, que Gérard lui avait sans doute communiquée, Charles VII chez ses grands vassaux. Seulement, chez nous, Yacoub s'appelait Hafiz. Nous nous trouvâmes très honorés qu'un personnage de notre invention ait été jugé digne d'être mis sur le théâtre et de servir de pivot à un drame de l'auteur de Henri III et de Christine à Fontainebleau 〈...〉
Outre cela, Gérard avait fait un drame en prose de Nicolas Flamel, dont un fragment d'une rare originalité et d'une grande puissance d’effet subsiste imprimé dans le Mercure de France. Où est le reste ? Le bibliophile Jacob le sait peut-être. Il s'occupait aussi d'un drame social, dont le donnée se rapprochait de celle d'Eugène Aram, et surtout une Reine de Saba qui n'arriva pas jusqu'à Salomon, et dont nous vous conterons les longues aventures. Vous voyez que ce paresseux avait l'oisiveté laborieuse."
Malheureusement, au chapitre suivant, la découverte d'une lettre de Bouchardy datant de 1830 vient faire digression, et Gautier ne parlera pas de la Reine de Saba. Des éléments intéressants pourtant dans ce chapitre IX intitulé "Le Carton vert" :
"Toutes les fois qu'il nous arrive, dans nos heures de désœuvrement et de mélancolie, poussé par une de ces récurrences vers le passé dont on n'est pas maître, de rouvrir le vieux carton vert où gisent dans la poussière plus que sous l'oubli les papiers que Gérard abandonnait chez nous, comme l'oiseau laisse de ses plumes aux endroits qu'il traverse, nous pouvons être sûrs qu'en voilà pour la journée.
Parmi les notes, les extraits, les brouillons, les renseignements sommaires, les commencements d'articles, les variantes de la même idée retournée de cent façons, les maximes philosophiques ou morales condensées en vers dorés de Pythagore, forme que Gérard affectionnait beaucoup, les répliques de drames taillées et numérotées comme des pierre de taille attendant leur place dans l'arc de voûte, tous les morceaux de cette architectonique littéraire disséminée et brouillée sans que nul œil, même celui de l'ami, puisse en reconnaître le plan, nous retrouvons de temps à autre d'anciennes lettres de nous imprégnées de vinaigre, lacérées aux Échelles du Levant par les ciseaux de la Santé, jaunes comme les bandelettes qui enveloppent les momies, adressées à notre ami du temps de son voyage en Orient et qui, plus heureuses que nous, ont fait caravane avec lui 〈...〉 Comme tout cela est loin 〈...〉 Nous revoyons là nos anciens paradoxes qui gambadent avec assez d'agilité pour leur âge et dont quelques-uns sont devenus des vérités 〈...〉 Il ne faut pas renier sa jeunesse. L'homme mûr ne fait qu'exécuter les rêves du jeune homme. Toute belle œuvre est un germe planté en avril qui s'épanouira en octobre. Qui n'a pas ses idées à sa majorité ne les aura jamais. Nous demandons pardon de philosopher ainsi et d'enfiler les aphorismes comme Sancho Pança enfilait les proverbes devant un carton à moitié vide de son contenu : une multitude de petits carrés de papier où, sous formules abréviatives, en caractères microscopiques entremêlés de chiffres et de signes aussi difficiles à lire que les notes secrètes d'un Raymond Lulle, d'un Faust ou d'un Her Trippa, sont résuméesn concentrées, quintessenciées comme quelques gouttes d'élixir, toutes les doctrines de la terre : théogonies, mythologies, religions, systèmes, interprétations, gloses, utopies papillonnent et tourbillonnent confusément, présentant quelquefois un signe hermétique ou cabalistique, car Gérard ne dédaignait pas une visite à Nicolas Flamel et un bout de conversation avec la femme blanche et le serviteur rouge, et si l'on tirait à soi l'un de ces papiers, les quelques lignes qu'il renferme vous occuperaient, comme un cryptogramme du scarabée d'Edgar Poe, et vous demanderait une effroyable intensité d'attention 〈...〉
Nous avions promis de raconter le voyage de Belkis, la reine de Saba que Gérard était allé chercher au fond de l'Orient en compagnie de La Huppe, pour l'amener soi-disant à Salomon, l'érotique auteur de Sir-Hasirimi, mais réellement pour Meyer-Beer, de Berlin, l'auteur de Robert le diable, qui voulait en faire un rôle de soprano à faire tourner la tête à toutes les prime donne. Mais il n'y a pas eu moyen. La lettre de Bouchardy exigeait à toute force l'insertion, comme un appel de l'âme des compagnons morts 〈...〉 Belkis attendra ; quelques semaines ne vieilliront pas celle dont la jeunesse se compte par milliers d'années."
En fait, cette analyse ne viendra jamais...
______