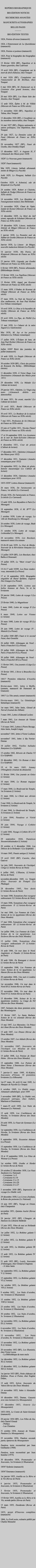29 septembre 1844 — Théâtre. Pantaloon Stoomwerktuigmaker, dans L’Artiste, 4e série, t. II, p. 76-78, signé Gérard de Nerval. Au sommaire, l’article s’intitule : « Une soirée au théâtre d’Amsterdam. »
Nerval est parti en Belgique et en Hollande avec Arsène Houssaye en septembre-octobre 1844. Il publie sur ce voyage trois articles. Le premier est consacré à une représentation théâtrale à Amsterdam. Drame, pantomime, ballet ? la pièce est impossible à identifier tant Nerval déploie de verve dans l’évocation quasi onirique du spectacle. Cet article, qui ne fut jamais repris en volume, est un bel exemple de l'écriture excentrique, fantaisiste, que Nerval sait utiliser pour rendre compte d'expériences « enthousiastes », voire hallucinatoires.
******
THÉÂTRE.
PANTALOON STOOMWERKTUIGMAKER.
Théâtre, — mais quel théâtre ? Je ne sais trop où ma fantaisie m’a fourvoyé ce soir. — Est-ce la ville, est-ce le faubourg ? — J’ai franchi deux ponts, suivi deux rues dans toute leur longueur, et puis sur une place carrée, — celle de l’Odéon est coupée en demi-cercle, — et si loin que mes pas m’aient conduit... ce ne peut être là l’Odéon, que je connais si bien !
Mais où suis-je ? la chose est inquiétante ; me serais-je trompé d’omnibus, trompé de chemin de fer ?
Il y a des jours où l’on marche dans la vie comme dans un rêve : ma place ce soir aurait dû être à la représentation des Femmes savantes, pour les débuts de mademoiselle Eugénie Sauvage, et voilà que par une succession imprévue d’événements, de voitures, de locomotives et peut-être même de bateaux à vapeur, — je me vois planté à sept heures du soir sous un péristyle d’ordre dorique, devant une affiche blanche, — ordinairement les affiches de théâtre sont imprimées sur papier de couleur, — qui annonce une première représentation dont le titre, perdu dans l’ombre, se lit difficilement, bien qu’imprimé en caractères romains.
Tâchons à présent de nous reconnaître, car assurément le contrôleur ne me reconnaît pas. — Il s’agit de prendre un billet au bureau comme à tout théâtre où l’on n’a pas ses entrées ; je donne cinq francs, l’on me rend quelques billons entremêlés de force centimes, et maintenant, comme tout critique qui a payé et que l’on n’a pas payé, j’ai bien le droit d’être sévère. Prenons place avec majesté.
La salle est toute blanc et or, et ressemblerait à celle de l’Opéra-Comique si elle n’était moins large et plus profonde. Quel luxe aujourd’hui dans ces intérieurs ! Il en est des théâtres comme des boutiques : la demeure est splendide, la marchandise ne vaut rien. Mais le public n’est-il pas un spectacle déjà ? Les femmes sont encadrées dans les loges comme des portraits ; en voici de charmantes, blondes la plupart, et d’une fraîcheur éclatante qui indique des nuits tranquilles et de longs jours de repos ; la jeunesse sourit sur ces lèvres rosées qui semblent des fleurs, et sur ces joues luisantes et vermeilles comme des fruits d’automne. D’ordinaire, on en remarque deux ou trois d’aussi jolies dans une salle de spectacle, mais, ce soir, par un bizarre enchantement, les trois quarts des femmes me semblent belles !
Il paraît que la mode est à présent, parmi les jolies filles, de porter de longs tire-bouchons tordus très fin et abondants sur les tempes où ils flottent royalement comme des torsades dorées... Il faut avoir beaucoup de cheveux pour suivre cette mode-là, à moins de mettre des touffes, — comme chaque femme dit que font toutes les autres femmes à Paris.
Cette mode qui règne dans les coiffures n’accompagne du reste aucune innovation dans la mise de ces belles dames : seulement je remarque avec surprise cinq à six riches étrangères qui, par une fantaisie inexplicable, sont allées se mêler à la foule du peuple qui encombre les galeries. Mais à bien les regarder même, ce sont des princesses tout au moins. Elles portent chacune un bonnet de fine dentelle brodée, qui colle sur la tête et descend jusqu’au front que ceint un large bandeau d’or, et le long des tempes, où viennent s’ajuster des nœuds éclatants d’or et de pierreries ; des franges de dentelle tombent en barbe jusqu’à leurs blanches épaules qu’elles effleurent, et lorsque les femmes tournent la tête, on voit sous le tulle léger luire une sorte de casque d’argent. Si ce sont là des personnes du peuple, des paysannes, comme l’indiquerait leur place au spectacle, c’est assurément de celles-là qu’une reine d’Angleterre disait, pendant un voyage : « Mais il semble que dans ce pays la seule qui ne soit pas reine, c’est moi ! »
Et à ce propos, où donc suis-je décidément ? Parti en omnibus pour rendre compte d’une première représentation d’un théâtre éloigné, — par quelle inextricable déviation de lignes, de correspondances, de stations, me trouvai-je, non à l’Odéon, mais au théâtre de Schoow... allons donc ! — de Schoowburg.
J’ai bien peur qu’un théâtre de ce nom-là n’existe pas à Paris. Le pire est que je ne comprendrai pas ce qui s’y joue. Plaignez les destins d’un feuilletoniste égaré !
— Monsieur, quelle est donc, s’il vous plaît, la nouvelle pièce que l’on donne ce soir ?
— Monsieur, cela s’appelle Pantaloon Stoomverktuigmaker, ou…
— Ou quoi ? monsieur, je retiendrais mieux le second titre.
— Ou Harlequin beschermd door amoor.
— Bien obligé ! ne répétez pas ; cela doit être un ouvrage très bien écrit.
— C’est un nieuw-groot-ballet-pantomime.
— Ah ! cela vaut encore mieux.
— Voulez-vous consulter le livret ?
— Merci, je préfère m’en passer. Je comprends toujours les ballets, mais les livrets très rarement.
Franchement, j’ai failli me croire, non dans un théâtre parisien, mais dans un théâtre français, car tout le monde parlait ma langue autour de moi, et j’entendais seulement comme par bouffées, venir des places occupées par le peuple quelques phrases d’un idiome qui ressemble aux accents d’un canard en gaieté. Quel bonheur de n’avoir pas à l’entendre sur la scène, si le mot pantomime n’est pas un vain mot !
L’ouverture commence, les musiciens attaquent avec feu de vieux airs du siècle dernier ; la perruque du bonhomme Hændel tressaillerait de joie ; mon cœur s’épanouit à ces mélodies d’un style suranné qui se résolvent par instants en ritournelles.
La toile est peinte dans le sentiment de l’ouverture. On y voit un Apollon entouré des Muses, groupe maniéré qui sent le Vanloo ; au premier plan, un génie verse des libations sur l’autel du Dieu des beaux-arts. Voici la légende inscrite au bas de la toile :
- Der kunsten god, aan’ty, met geestdrift aangebéen
- Kroont hier, in’t heilig koor, verdienste-en deugd-alléén.
Cela forme assurément deux vers, dont je comprends trois mots, qui sont allemands ; du reste l’allégorie est parlante.
Les loges d’avant-scène sont remplacées de chaque côté par un portique de colonnes d’un marbre rougeâtre, qui encadre les statues colossales de Melpomène et de Thalie à demi peintes et à demi dorées ; c’est dans le piédestal cylindrique, derrière un grillage qui en dessine l’architecture, qu’on a pratiqué seulement des loges de rez-de-chaussée.
Cette avant-scène est grandiose, et l’on pourrait en proposer le modèle à nos théâtres, s’ils voulaient faire le sacrifice de quelques places en faveur de l’effet artistique de leur salle. Il est beau d’avoir des dieux pour spectateurs, surtout quand on n’est pas sûr que toutes les places soient toujours occupées par des mortels.
Le rideau se lève ; voici un jardin, voilà une serre, et une charmante jardinière, fraîche, légère et court-vêtue, prend doin des fleurs qui sont peut-être des tulipes, et danse tour à tour en tenant une bêche ou en promenant l’arrosoir. Un galant postillon survient, arrête la jardinière par la taille, et cueille un baiser, qu’on ne lui refuse pas trop. Le maître du jardin, vieillard encore vert, ce qui veut dire un homme un peu mûr, survient un bâton à la main, suivi de son valet, et tous deux, bien armés, vont faire un mauvais sort au galant postillon. Au moment où il risque d’être assommé, la déesse Vénus descend sur un nuage, s’interpose dans la querelle, et fait sentir à l’homme mûr qu’il est trop vieux pour être jaloux. À lui les tulipes inoffensives, mais au postillon la jardinière vive et jeune comme lui.
Le vieillard n’est pas convaincu ; il représente qu’il a bon pied et bon œil, et de l’argent que le postillon n’a pas : avec cela on est heureux, la jardinière le comprendra plus tard ; l’amour a des ailes, et le postillon est doué d’une faculté d’inconstance de la force de plusieurs chevaux.
Il faut dire que ce bon homme est, non seulement propriétaire du jardin, mais fabricant de machines à vapeur, ce qui explique l’énergie de sa comparaison. La bonne Vénus se recueille un instant, et lui dit : « Mon cher, tu es un honnête indistriel, un bourgeois honorable, tu ferais un bon mari selon les idées du siècle ; mais moi je te connais ; sous l’ancien régime, tu t’appelais Pantalon. »
La déesse le touche de son sceptre ; les habits modernes tombent en guenilles, et l’on voit gambader et grimacer un personnage de Callot au long nez, à la barbe pointue, mi-parti de rouge et de noir. — « Et toi, dit Vénus au postillon, tu t’es toujours appelé Arlequin. Tu es comme autrefois franc, aimable, tendre, mais imprévoyant. Tu ne t’aperçois pas que ce vieillard, avec ses machines fumeuses, détruit ton état, dévore ton pain, et que ta force et ton adresse à conduire des chevaux frinfants, ne servent de rien contre ses inventions damnées. C’est l’enfer qui le soutient ; mais le ciel et l’amour viendront à ton aide, car ils sont toujours du parti de la jeunesse et de la beauté. »
Arlequin salue, et menace déjà Pantalon de sa batte magique. La jardinière est devenue Colombine, et le valet du vieillard l’éternel esclave de qui le paye, de qui le fait manger, le serviteur de la matière, dont son maître représente la force et lui l’instinct, on le prévoit bien, c’est Pierrot.
Arlequin et Colombine ont déjà disparu ; ils ont fui, mais comment ? sur un cheval, sans doute. Pantalon et Pierrot, désespérant de les atteindre, se rendent dans l’atelier des machines pour en choisir une de la plus grande vitesse.
Là s’étalent toutes les inventions de la mécanique moderne, tous les prodiges de la vapeur. Pantalon fait amener une locomotive, et monte à cheval sur le cylindre. Pierrot le suit sur une sellette à vapeur pour homme seul, alimentée d’un petit fourneau qu’il entretient soigneusement.
Ils arrivent à temps tous les deux pour surprendre les amants, qui rêvent au bord d’un frais rivage. Arlequin le reçoit à coups de batte, mais voyant la garde accourir à leurs cris, il s’embarque sur un charmant navire orné de guirlandes et conduit par les Amours.
Comment le suivre cette fois ? Pantalon entend la sonnerie d’un bateau à vapeur, et prend passage sur cet aimable stoom-boot, qui disparaît en un instant. Pierrot, abandonné sur la rive, construit, à l’aide de divers ingrédients, une machine aérienne dont le principe de locomotion est un vaste soufflet qui enfle des voiles et joue le rôle du vent. Mais les véritables Vents, ces joufflus descendants d’Éole, se fâchent contre l’ingénieux Pierrot, et sa machine renversée le laisse tomber dans la mer. Un poisson a pitié de lui, et le transporte sur son dos au rivage sans aucun frais d’invention.
La maréchaussée les saisit tous les deux, et veut emprisonner Pierrot comme ayant pris un poisson sans autorisation de pêche. Pierrot fait observer que c’est le poisson qui l’a pêché lui-même. L’autorité admet cette défense, et conduit le poisson au corps-de-garde pour lui appliquer la loi.
Cependant Arlequin est devenu fermier et Colombine fermière ; Pierrot les reconnaît et s’en va avertir son maître qu’il a retrouvé. Pantalon accourt avec ses ouvriers ; l’on saisit Colombine et l’on démolit la maison pour y faire passer un chemin de fer. Quant à Arlequin, on le bourre dans un mortier et on l’envoie dans la devanture de la boutique d’un apothicaire. Ce malheureux reste incrusté dans le vitrage, les membres en croix, la tête en bas.
Pantalon conduit dans sa maison Colombine prisonnière, et pour l’amadouer, il lui fait servir un souper magnifique. Colombine n’a pas faim ; le vieillard décrit sa passion, et Pierrot, avec une longue canne armée d’un crochet, enlève peu à peu toutes les pièces du souper. Mais on le conçoit bien, cela ne lui profite guère, et il est en proie à tous les accidents de la gourmandise contrariée ; il se brûle, il s’enfle, il tombe malade et s’en va chez l’apothicaire qui lui pose des sangsues grosses comme le bras. rendu à la santé, il voit Arlequin toujours écartelé dans la devanture, et l’enlève sur ses épaules pour lui rendre les derniers devoirs.
Arlequin mis dans les mains des croque-morts ne peut échapper au progrès, et part pour la fosse commune dans un corbillard à vapeur. Ce serait le cas de dire que les morts vont vite ; mais Arlequin n’est qu’engourdi. Pierrot rentre chez Pantalon en se frottant les mains et trouve ce dernier peu avancé dans les bonnes grâces de Colombine. Le vieillard a réservé pour la fin les grands moyens de séduction ; il fait apporter son coffre-fort et en tire force banknotes, force inscriptions de rentes et beaucoup d’actions de sociétés industrielles. Pierrot glisse la main à la dérobée dans le coffre pour saisir une pincée de billets de banque, mais il retire un grand bras rouge qui lui donne une poignée de mains fort brûlante ; c’est le bras du diable ; tout le papier monnaie flambe et se consume en un instant.
On a mis Arlequin au cercueil malgré ses protestations ; pleurez Arlequin. Colombine inconsolable descend dans de sombres caveaux ; Pantalon et Pierrot courent à sa poursuite et arrivent au moment où elle retrouve Arlequin rendu à la vie. L’Amour, qui règne même aux enfers, leur ouvre une grotte charmante à travers les rochers, tandis qu’un diable géant qui grandit jusqu’aux frises enlève et balance par les cheveux Pantalon et Pierrot. Le fond s’entr’ouvre et fait place au palais éternel de l’hyménée décoré d’un soleil tournant.
Voilà tout ce que j’ai pu saisir du sens de ce nieuw-groot-ballet. N’y aurait-il pas là une satire agréable de l’esprit industriel du siècle, qui poursuit des progrès stériles en laissant échapper comme un rêve la jeunesse, la fantaisie et l’amour. On peut broder encore mille autres affabulations sur la trame d’un si riche canevas. — À quoi vous me direz que ce n’était pas la peine d’aller si loin pour voir jouer solennellement dans un grand théâtre la même pièce qui, avec peu de variations, compose sous différents titres tout le répertoire des Funambules.
Je répondrai premièrement — que nous n’allons pas assez aux Funambules ;
Ensuite que ce théâtre est trop petit, trop enfumé et trop indigne d’un grand peuple, — et que la parade n’a pas chez nous la place qu’elle devrait avoir.
On la trouve, il est vrai, sur de plus grandes scènes, mais combien on la paye plus cher !
Un critique que je rencontre en sortant, M. Arsène Houssaye, m’assure que je viens d’assister à une représentation du Grand-Théâtre d’Amsterdam.
GÉRARD DE NERVAL.