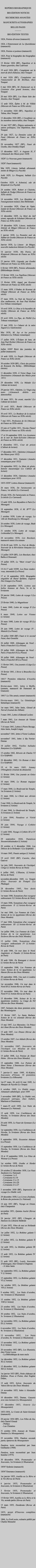<<< Les Nuits d'octobre, 1re, 2e, 3e, 4e 5e livraisons
******
23 octobre 1852 — Les Nuits d’octobre, dans L’Illustration, 2e livraison, signé Gérard de Nerval.
De conversations en visites de restaurants, le train de trois heures et demie est raté, et il faut attendre maintenant celui de sept heures le lendemain matin. Désœuvré, Nerval va donc passer la nuit à vagabonder dans un Paris nocturne et un peu louche, qui ressemble à ceux de Sébastien Mercier et de Restif de La Bretonne. Le récit perd donc apparemment de vue son projet initial de voyage à Meaux pour entraîner le lecteur dans un périple nocturne dans le Paris « obscur », le « Paris canaille », ponctué de haltes arrosées au café Vachette, chez le rôtisseur et au « Bal des chiens » de la rue Saint-Honoré, au carreau des Halles, aux « charniers » de la Fontaine des Innocents, chez Baratte, chez Paul Niquet, haltes entrecoupées d’anecdotes plus ou moins connues sur les salades et les chocolats de Saint-Cricq, le café des Aveugles du Palais-Royal, d’incursions dans des lieux étranges tels la société chantante maçonnique près de l’Athénée.
******
LES NUITS D’OCTOBRE.
PARIS, — PANTIN, — ET MEAUX.
___
VI. — DEUX SAGES.
Nous nous entendons si bien, mon ami et moi, qu’en vérité, sans le désir d’agiter notre langue et de nous animer un peu, il serait inutile que nous eussions ensemble la moindre conservation. Nous ressemblerions au besoin à ces deux philosophes marseillais qui avaient longtemps abîmé leurs organes à discuter sur le grand Peut être. A force de dissertations, ils avaient fini par s’apercevoir qu’ils étaient du même avis, — que leurs pensées se trouvaient adéquates, et que les angles sortants du raisonnement de l’un s’appliquaient exactement aux angles rentrants du raisonnement de l’autre.
Alors, pour ménager leurs poumons, ils se bornaient sur toute question philosophique, — politique, — ou religieuse, à un certain « Hum ou heuh, » — diversement accentué, qui suffisait pour amener la résolution du problème.
L’un, par exemple, montrait à l’autre, — pendant qu’ils prenaient le café ensemble, — un article sur la fusion. — Hum ! disait l’un ; heuh ! disait l’autre.
La question des classiques et des scolastiques, soulevée par un journal bien connu, était pour eux comme celle des réalistes et des nominaux du temps d’Abeilard ; heuh ! disait l’un ; — hum ! disait l’autre.
Il en était de même pour ce qui concerne la femme ou l’homme, le chat ou le chien. Rien de ce qui est dans la nature, ou qui s’en éloigne, n’avait la vertu de les étonner autrement.
Cela finissait toujours par une partie de dominos ; — jeu spécialement silencieux et méditatif.
— Mais pourquoi, dis-je à mon ami, n’est-ce pas ici comme à Londres ? Une grande capitale ne devrait jamais dormir.
— Parce qu’il y a ici des portiers, — et qu’à Londres, chacun ayant un passe-partout de la porte extérieure, rentre à l’heure qu’il veut.
— Cependant, moyennant cinquante centimes, on peut ici rentrer partout après minuit.
— Et l’on est regardé comme un homme qui n’a pas de conduite.
— Si j’étais préfet de police, au lieu de faire fermer les boutiques, les théâtres, les cafés et les restaurants, à minuit, je payerais une prime à ceux qui resteraient ouverts jusqu’au matin. Car enfin je ne crois pas que la police ait jamais favorisé les voleurs ; mais il semble, d’après ces dispositions, qu’elle leur livre la ville sans défense, — une ville surtout où un grand nombre d’habitants : imprimeurs, acteurs, critiques, machinistes, allumeurs, etc., ont des occupations qui les retiennent jusqu’après minuit. — Et les étrangers, que de fois je les ai entendus rire... en voyant que l’on couche les Parisiens sitôt.
— La routine ! dit mon ami.
VII. — LE CAFÉ DES AVEUGLES.
— Mais, reprit-il, si nous ne craignons pas les tirelaines, nous pouvons encore jouir des agréments de la soirée ; ensuite nous reviendrons souper, soit à la Pâtisserie du boulevard Montmartre, soit à la Boulangerie, que d’autres appellent la Boulange, rue Richelieu. Ces établissements ont la permission de deux heures. Mais on n’y soupe guère à fond. Ce sont des pâtés, des sandwich, — une volaille peut-être, ou quelques assiettes assorties de gâteaux, que l’on arrose invariablement de madère. — Souper de figurante ou de pensionnaire... lyrique. Allons plutôt chez le rôtisseur de la rue Saint-Honoré.
Il n’était pas encore tard en effet. Notre désœuvrement nous faisait paraître les heures longues... En passant au perron pour traverser le Palais-National, un grand bruit de tambour nous avertit que le Sauvage continuait ses exercices au café des Aveugles.
L’orchestre homérique (1) exécutait avec zèle les accompagnements. La foule était composée d’un parterre inouï, garnissant les tables, et qui, comme aux Funambules, vient fidèlement jouir tous les soirs du même spectacle et du même acteur. Les dilettantes trouvaient que M. Blondelet (le sauvage) semblait fatigué, et n’avait pas dans son jeu toutes les nuances de la veille. Je ne pus apprécier cette critique ; mais je l’ai trouvé fort beau. Je crains seulement que ce ne soit aussi un aveugle, et qu’il n’ait des yeux d’émail.
Pourquoi des aveugles, direz-vous, dans ce seul café, qui est un caveau ? C’est que vers la fondation, qui remonte à l’époque révolutionnaire, il se passait là des choses qui eussent révolté la pudeur d’un orchestre. Aujourd’hui, tout est calme et décent. Et même la galerie sombre du caveau est placée sous l’œil vigilant d’un sergent de ville.
Le spectacle éternel de l’Homme à la poupée nous fit fuir, parce que nous le connaissions déjà. Du reste, cet homme imite parfaitement le français-belge.
Et maintenant, plongeons-nous plus profondément encore dans les cercles inextricables de l’enfer parisien. Mon ami m’a promis de me faire passer la nuit à Pantin.
(1) O nh orwn , aveugle.
VIII. — PANTIN.
Pantin — c’est le Paris obscur — quelques-uns diraient le Paris canaille ; mais ce dernier s’appelle, en argot, Pantruche. N’allons pas si loin.
En tournant la rue de Valois, nous avons rencontré une façade lumineuse d’une douzaine de fenêtres ; — c’est l’ancien Athénée, inauguré par les doctes leçons de Laharpe. Aujourd’hui c’est le splendide estaminet des Nations, contenant douze billards. Plus d’esthétique, plus de poésie ; — on y rencontre des gens assez forts pour faire circuler des billes autour de trois chapeaux espacés sur le tapis vert, aux places où sont les mouches. Les blocs n’existent plus ; le progrès a dépassé ces vaines promesses de nos pères. Le carambolage seul est encore admis ; mais il n’est pas convenable d’en manquer un seul (de carambolage).
J’ai peur de ne plus parler français, — c’est pour quoi je viens de me permettre cette dernière parenthèse. — Le français de M. Scribe, celui de la Montansier, celui des estaminets, celui des lorettes, des concierges, des réunions bourgeoises, des salons, commence à s’éloigner des traditions du grand siècle. La langue de Corneille et de Bossuet devient peu à peu du sanscrit (langue savante). Le règne du prâcrit (langue vulgaire) commence pour nous, — je m’en suis convaincu en prenant mon billet et celui de mon ami, — au bal situé rue Honoré, que les envieux désignent sous le nom de Bal des Chiens. Un habitué nous a dit : Vous roulez (vous entrez) dans le bal (on prononce b-a-l), c’est assez rigollot ce soir.
Rigollot signifie amusant.
En effet, c’était rigollot.
La maison intérieure, à laquelle on arrive par une longue allée, peut se comparer aux gymnases antiques. La jeunesse y rencontre tous les exercices qui peuvent développer sa force et son intelligence. Au rez-de-chaussée, le café-billard ; au premier, la salle de danse ; au second, la salle d’escrime et de boxe ; au troisième, le daguerréotype, instrument de patience qui s’adresse aux esprits fatigués, et qui, détruisant les illusions, oppose à chaque figure le miroir de la vérité.
Mais, la nuit, il n’est question ni de boxe, ni de portraits, — un orchestre étourdissant de cuivres, dirigé par M. Hesse, dit Décati, vous attire invinciblement à la salle de danse, où vous commencez à vous débattre contre les marchandes de biscuits et de gâteaux. On arrive dans la première pièce où sont les tables, et où l’on a le droit d’échanger son billet de 25 centimes contre la même somme en consommation. Vous apercevez des colonnes entre lesquelles s’agitent des quadrilles joyeux. Un sergent de ville vous avertit paternellement que l’on ne peut fumer que dans la salle d’entrée, — le prodrome —.
Nous jetons nos bouts de cigares, immédiatement ramassés par des jeunes gens moins fortunés que nous. — Mais, vraiment, le bal est très-bien ; on se croirait dans le monde, — si l’on ne s’arrêtait à quelques imperfections de costume. C’est, au fond, ce qu’on appelle à Vienne un bal négligé.
Ne faites pas le fier. — Les femmes qui sont là en valent bien d’autres, et l’on peut dire des hommes, en parodiant certains vers d’Alfred de Musset sur les derviches turcs :
- Ne les dérange pas, ils t’appelleraient chiens...
- Ne les insulte pas, car ils te valent bien !
Tâchez de trouver dans le monde une pareille animation. La salle est assez grande et peinte en jaune. Les gens respectables s’adossent aux colonnes, avec défense de fumer, et n’exposent que leurs poitrines aux coups de coude, et leurs pieds aux trépignements éperdus du galop ou de la valse. Quand la danse s’arrête, les tables se garnissent. Vers onze heures, les ouvrières sortent et font place à des personnes qui sortent des théâtres, des cafés-concerts et de plusieurs établissements publics. L’orchestre se ranime pour cette population nouvelle, et ne s’arrête que vers minuit.
IX. — LA GOGUETTE.
Nous n’attendîmes pas cette heure. Une affiche bizarre attira notre attention. Le règlement d’une goguette était affiché dans la salle :
SOCIÉTÉ LYRIQUE DES TROUBADOURS.
- Bury, président, Beauvais, maître de chant, etc.
- Art.1er. Toutes chansons politiques ou atteignant la religion ou les mœurs sont formellement interdites.
- 2° Les échos ne seront accordés que lorsque le président le jugera convenable.
- 3° Toute personne se présentant en état de troubler l’ordre de la soirée, l’entrée lui en sera refusée.
- 4° Toute personne qui aurait troublé l’ordre, qui, après deux avertissements dans la soirée, n’en tiendrait pas compte sera priée de sortir immédiatement.
- Approuvé, etc.
Nous trouvons ces dispositions fort sages ; mais la Société lyrique des Troubadours, si bien placée en face de l’ancien Athénée, ne se réunit pas ce soir-là. Une autre goguette existait dans une autre cour du quartier. Quatre lanternes mauresques annonçaient la porte, surmontée d’une équerre dorée.
Un contrôleur vous prie de déposer le montant d’une chopine (six sous) et l’on arrive au premier, où derrière la porte se rencontre le chef d’ordre. — « Êtes-vous du bâtiment ? nous dit-il. — Oui, nous sommes du bâtiment, répondit mon ami. »
Ils se firent les attouchements obligés et nous pûmes entrer dans la salle.
Je me rappelai aussitôt la vieille chanson exprimant l’étonnement d’un louveteau (1) nouveau-né, qui rencontre une société fort agréable, et se croit obligé de la célébrer : « Mes yeux sont éblouis, dit-il. Que vois-je dans cette enceinte ?
- « Des menuisiers ! des ébénisses !
- Des entrepreneurs de bâtisses !...
- Qu’on dirait un bouquet de fleurs,
- Paré de ses mille couleurs ! »
Enfin, nous étions du bâtiment, — et le mot se dit aussi au moral, attendu que le bâtiment n’exclut pas les poëtes ; — Amphyon, qui élevait des murs au son de sa lyre, était du bâtiment. — Il en est de même des artistes peintres et statuaires, qui en sont les enfants gâtés.
Comme le louveteau, je fus éblouis de la splendeur du coup d’œil. Le chef d’ordre nous fit asseoir à une table d’où nous pûmes admirer les trophées ajustés entre chaque panneau. Je fus étonné de ne pas y rencontrer les anciennes légendes obligées : « Respect aux dames ! Honneur aux Polonais. » Comme les traditions se perdent !
En revanche, le bureau drapé de rouge était occupé par trois commissaires fort majestueux. Chacun avait devant soi sa sonnette, et le président frappa trois coups avec le marteau consacré. La mère des compagnons était assise au pied du bureau. On ne la voyait que de profil, mais le profil était plein de grâce et de dignité.
— Mes petits amis, dit le président, notre ami*** va chanter une nouvelle composition intitulée « La feuille de saule ».
La chanson n’était pas plus mauvaise que bien d’autres. Elle imitait faiblement le genre de Pierre Dupont. Celui qui la chantait était un beau jeune homme aux cheveux noirs, si abondants qu’il avait dû s’entourer la tête d’un cordon, afin de les maintenir ; il avait une voix douce, parfaitement timbrée, et les applaudissements furent doubles, — pour l’auteur et pour le chanteur.
Le président réclama l’indulgence pour une demoiselle dont le premier essai allait se produire devant les amis. Ayant frappé les trois coups, il se recueillit, et au milieu du plus complet silence on entendit une voix jeune, encore imprégnée des rudesses du premier âge, mais qui se dépouillant peu à peu (selon l’expression d’un de nos voisins), arrivait aux traits et aux fioritures les plus hardis. L’éducation classique n’avait pas gâté cette fraîcheur d’intonation, cette pureté d’organe, cette parole émue et vibrante qui n’appartiennent qu’aux talents vierges encore des leçons du Conservatoire.
(1) Fils de maître, selon les termes de compagnonnage
GÉRARD DE NERVAL.
(La suite prochainement.)
_______