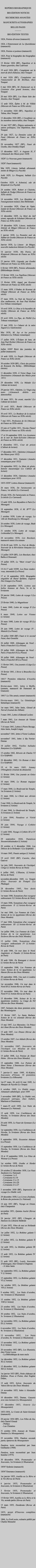30 octobre 1830 (BF) — Choix des Poésies de Ronsard, Dubellay, Baïf, Belleau, Dubartas, Chassignet, Desportes, Régnier, précédé d’une Introduction, par M. Gérard, Paris, Bureau de la Bibliothèque Choisie, 1830.
Nerval a publié des extraits de son Introduction au Choix de Poésies en deux livraisons, sous les titres : De la littérature française au Moyen âge, et : Défense et illustration de la langue française, respectivement les 21 (t. XXX, p. 343-352) et 28 août 1830 (t. XXX, p. 392-402), dans Le Mercure de France au XIXe siècle. Cette Introduction sera reproduite en 1852 dans La Bohême galante, 2e, 3e, et 4e livraisons.
Parmi l’ensemble des pièces du XVIe siècle retenues, seul le sonnet de Du Bartas : « Ce roc voûté par art » fera l’objet d’une appropriation par Nerval qui en fait le sonnet A Madame Sand en 1841.
Voir la notice LA CAMARADERIE DU PETIT CÉNACLE
******
CHOIX DES POÉSIES
DE RONSARD, DUBELLAY, BAÏF, BELLEAU,
DUBARTAS, CHASSIGNET, DESPORTES, RÉGNIER.
INTRODUCTION.
Il s’agite actuellement en littérature une question fort importante : on demande si la poésie moderne peut retirer quelque fruit de l’étude des écrivains français, antérieurs au dix septième siècle.
L’Académie des Jeux floraux avait même indiqué ce sujet pour son prix d’éloquence de cette année ; et l’on sent bien que si une académie de province hasarde une pareille question, c’est que le statu quo de Malherbe et de Boileau menace terriblement ruine.
J’ignore si le procès-verbal des Jeux floraux est déjà publié : à Paris nous ne le voyons guère ; mais un journal de province, qui donnait dernièrement quelques détails sur ce concours, nous apprend que le morceau couronné répondait affirmativement à la question.
Elle y était vue de haut et traitée largement, comme on dit aujourd’hui : « Le moyen âge, s’écriait le Lauréat, déborde sur nous par la littérature.... L’imagination peut seule rouvrir les sources du génie ; elle s’est précipitée sur les temps barbares ; elle y a cherché les vivantes puissances du moyen âge, le christianisme, la chevalerie, les querelles religieuses, les révolutions politiques, etc... » Mais l’accessit était d’un avis bien contraire ; toute la poésie possible, à son sens, était contenue dans le grand siècle : au-delà, rien que barbarie et confusion..., quelques épigrammes de Marot exceptées ; rien que l’on pût comprendre avant Ronsard, et quatre vers de lisible, tout au plus, chez celui-ci (d’après Laharpe). Puis l’accessit tançait vertement ces novateurs rétrogrades qui veulent nous ramener à l’enfance de la poésie, nous proposant pour modèles des poètes barbares qui n’avaient pas la moindre teinture des littératures anciennes, comme si les inimitables écrivains du siècle de Louis XIV n’étaient pas les seuls dignes d’être imités !
Travaillez, jeunes lauréats, travaillez ; il se peut que chacun de vous ait raison : que l’un nous offre des compositions où revive tout ce moyen âge qu’il dépeint si bien, que l’autre surpasse, s’il peut, les illustres modèles qu’il se propose... Mais qu’il les surpasse, entendez-vous ? car il est impossible d’admettre une littérature qui ne soit pas progressive. Regardez-y à deux fois : c’est une terrible prétention que celle de perfectionner Racine, et cependant la question est là.
Franchement, je vois chez le jeune novateur plus de conscience d’artiste, jointe à plus de modestie : il respecte trop nos grands auteurs pour se hasarder dans le genre qu’ils ont si glorieusement occupé ; il se propose des modèles moins supérieurs dans une littérature peu frayée, et qui n’a atteint aucune sorte de perfection : ces modèles, il peut sans trop d’orgueil espérer de les effacer, heureux s’il dotait notre siècle d’une source féconde d’inspiration et communiquait à d’autres l’envie de la surpasser lui-même dans cette entreprise.
Car il faut l’avouer, avec tout le respect possible pour les auteurs du grand siècle, ils ont trop resserré le cercle des compositions poétiques ; sûrs pour eux-mêmes de ne jamais manquer d’espace et de matériaux, ils n’ont point songé à ceux qui leur succédaient, ils ont dérobé leurs neveux, selon l’expression du Métromane : au point qu’il ne nous reste que deux partis à prendre, ou de les surpasser, ainsi que je viens de dire, ou de poursuivre une littérature d’imitation servile qui ira jusqu’où elle pourra ; c’est-à-dire qui ressemblera à cette suite de dessins si connue, où par des copies successives et dégradées, on parvient à faire du profil d’Apollon une tête hideuse de grenouille.
De pareilles observations sont bien vieilles, sans doute, mais il ne faut pas se lasser de les remettre devant les yeux du public, puisqu’il y a des gens qui ne se lassent pas de répéter les sophismes qu’elles ont réfutés depuis long-temps. En général, on paraît trop craindre, en littérature, de redire sans cesse les bonnes raisons ; on écrit trop pour ceux qui savent ; et il arrive de là que les nouveaux auditeurs qui surviennent tous les jours à cette grande querelle, ou ne comprennent point une discussion déjà avancée, ou s’indignent de voir tout à coup, et sans savoir pourquoi, remettre en question des principes adoptés depuis des siècles.
Il ne s’agit donc pas (loin de nous une telle pensée !) de déprécier le mérite de tant de grands écrivains à qui la France doit sa gloire ; mais n’espérant point de faire mieux qu’eux, de chercher à faire autrement, et d’aborder tous les genres de littérature dont ils ne se sont point emparés.
Et ce n’est pas à dire qu’il faille pour cela imiter les étrangers. Mais seulement suivre l’exemple qu’ils nous ont donné, en étudiant profondément nos poètes primitifs, comme ils ont fait des leurs.
Car toute littérature primitive est nationale, n’étant créée que pour répondre à un besoin, et conformément au caractère et aux mœurs du peuple qui l’adopte ; d’où il suit que, de même qu’une graine contient un arbre entier, les premiers essais d’une littérature renferment tous les germes de son développement futur, de son développement complet et définitif.
Il suffit pour faire comprendre ceci, de rappeler ce qui s’est passé chez nos voisins : après des littératures d’imitation étrangère, comme était notre littérature dite classique, après le siècle de Pope et d’Adison, après celui de Vieland et de Lessing, quelques gens à courte vue ont pu croire que tout était dit pour l’Angleterre et pour l’Allemagne....
Tout ! excepté les chefs-d’œuvre de Walter Scott et de Byron, excepté ceux de Schiller et de Goëthe ; les uns, produits spontanés de leur époque et de leur sol ; les autres, nouveaux et forts rejetons de la souche antique : tous abreuvés à la source des traditions, des inspirations primitives de leur patrie, plutôt qu’à celle de l’hypocrène.
Ainsi, que personne ne dise à l’art : tu n’iras pas plus loin ! au siècle, tu ne peux dépasser les siècles qui t’ont précédé !.. C’est là ce que prétendait l’antiquité en posant les bornes d’Hercule : le moyen âge les a méprisées et il a découvert un monde.
Peut-être ne reste-t-il plus de mondes à découvrir ; peut-être le domaine de l’intelligence est-il au complet aujourd’hui et que l’on peut en faire le tour, comme du globe : mais il ne suffit pas que tout soit découvert ; dans ce cas même, il faut cultiver, il faut perfectionner ce qui est resté inculte ou imparfait. Que de plaines existent que la culture aurait rendues fécondes ! que de riches matériaux auxquels il n’a manqué que d’être mis en œuvre par des mains habiles ! que de ruines de monuments inachevés.... Voilà ce qui s’offre à nous, et dans notre patrie même, à nous qui nous étions bornés si long-temps à dessiner magnifiquement quelques jardins royaux, à les encombrer de plantes et d’arbres étrangers conservés à grands frais, à les surcharger de dieux de pierre, à les décorer de jets d’eau et d’arbres taillés en portiques.
Mais arrêtons-nous ici, de peur qu’en combattant trop vivement le préjugé qui défend à la littérature française, comme mouvement rétrograde, un retour d’étude et d’investigation vers son origine, nous ne paraissions nous escrimer contre un fantôme, ou frapper dans l’air comme Entelle : le principe était plus contesté au temps où un célèbre écrivain allemand envisageait ainsi l’avenir de la poésie française :
« Si la poésie (nous traduisons M. Schlegel) pouvait plus tard refleurir en France, je crois que cela ne serait point par l’imitation des Anglais ni d’aucun autre peuple ; mais par un retour à l’esprit poétique en général, et en particulier à la littérature française des temps anciens. L’imitation ne conduira jamais la poésie d’une nation à son but définitif, et surtout l’imitation d’une littérature étrangère parvenue au plus grand développement intellectuel et moral dont elle est susceptible : mais il suffit à chaque peuple de remonter à la source de sa poésie, et à ses traditions populaires, pour y distinguer et ce qui lui appartient en propre et ce qui lui appartient en commun avec les autres peuples. Ainsi , l’inspiration religieuse est ouverte à tous, et toujours il en sort une poésie nouvelle, convenable à tous les esprits et à tous les temps : c’est ce qu’a compris Lamartine, dont les ouvrages annoncent à la France une nouvelle ère poétique, etc. »
Mais avions-nous en effet une littérature avant Malherbe ? observent quelques irrésolus, qui n’ont suivi de cours de littérature que celui de Laharpe. — Pour le vulgaire des lecteurs, non ! Pour ceux qui voudraient voir Rabelais et Montaigne mis en français moderne ; pour ceux à qui le style de La Fontaine et de Molière paraît tant soit peu négligé, non ! Mais pour ces intrépides amateurs de poésie et de langue française, que n’effraie pas un mot vieilli, que n’égaie pas une expression triviale ou naïve, que ne démontent point les oncques, les ainçois, et les ores, oui ! Pour les étrangers qui ont puisé tant de fois à cette source, oui !... Du reste, ils ne craignent point de le reconnaître (1), et rient bien fort de voir souvent nos écrivains s’accuser humblement d’avoir pris chez eux des idées qu’eux-mêmes avaient dérobées à nos ancêtres.
Mais avant d’aller plus loin, posons la question de manière à la faire mieux comprendre, et profitons pour cela de la division indiquée par M. Sainte-Beuve, dans son excellent tableau de la poésie au seizième siècle, qui attribue à l’école de Ronsard, et non pas à Malherbe, l’établissement du système classique en France ; on n’avait pas jusque-là appuyé assez sur cette circonstance, à cause du peu de cas que l’on faisait, à tort, des poètes du seizième siècle.
Nous dirons donc maintenant : existait-il une littérature nationale avant Ronsard ? mais une littérature complète, capable par elle-même, et à elle seule, d’inspirer des hommes de génie, et d’alimenter de vastes conceptions ? Une simple énumération va nous prouver qu’elle existait : qu’elle existait divisée en deux parties bien distinctes, comme la nation elle-même, et dont par conséquent l’une que les critiques allemands appellent littérature chevaleresque semblait devoir son origine aux Normands, aux Bretons, aux Provençaux et peut-être aux Francs (la noblesse s’en empara), dont l’autre, native du cœur même de la France, et essentiellement populaire, est assez bien caractérisée par l’épithète de gauloise.
La première comprend : les poèmes historiques, tels que les roumans de Rou (Rollon) et du Brut, la Philippide, le combat des trente Bretons, etc. ; les poëmes chevaleresques, tels que le Saint-Graal, Tristan, Partenopex, Lancelot, etc. ; les poèmes allégoriques, tels que le roman de la Rose, du Renard, etc., et enfin toute la poésie légère, chansons, ballades, lais, chants royaux, plus la poésie provençale ou romane tout entière.
La seconde comprend les mystères, moralités et farces (y compris Patelin) ; les fabliaux, contes, facéties, livres satiriques, noëls, etc., toutes œuvres où le plaisant dominait, mais qui ne laissent pas d’offrir souvent des morceaux profonds ou sublimes, et des enseignemens d’une haute morale parmi des flots de gaîté frivole et licencieuse.
Eh bien ! qui n’eût promis un avenir à une littérature aussi forte, aussi variée dans ses élémens, et qui ne s’étonnera de la voir tout à coup renversée, presque sans combat, par une poignée de novateurs qui prétendaient ressusciter la Rome morte depuis seize cents ans, la Rome romaine, et la ramener victorieuse, avec ses costumes, ses formes et ses dieux, chez un peuple du nord, à moitié composé de nations germaniques, et dans une société toute chrétienne : ces novateurs, c’étaient Ronsard et les poètes de son école ; le mouvement imprimé par eux aux lettres s’est continué jusqu’à nos jours.
Ce serait perdre de vue le plan de ce volume que de nous occuper à faire l’histoire de la décadence de la haute poésie en France ; car elle était vraiment en décadence au siècle de Ronsard ; flétrie dans ses germes, morte sans avoir acquis le développement auquel elle semblait destinée ; tout cela, parce qu’elle n’avait trouvé pour l’employer que des poètes de cour qui n’en tiraient que des chants de fêtes, d’adulation et de fade galanterie ; tout cela, faute d’hommes de génie qui sussent la comprendre, et en mettre en œuvre les riches matériaux. Ces hommes de génie se sont rencontrés cependant chez les étrangers, et l’Italie surtout nous doit ses plus grands poètes du moyen âge : mais chez nous, à quoi avaient abouti les hautes promesses des douzième et treizième siècles ? A je ne sais quelle poésie ridicule, où la contrainte métrique, où des tours de force en fait de rime, tenait lieu de couleur et de poésie ; à de fades et obscurs poèmes allégoriques, à des légendes lourdes et diffuses, à d’arides récits historiques rimés, tout cela recouvert d’un langage poétique, plus vieux de cent ans que la prose et le langage usuel, car les rimeurs d’alors imitaient si servilement les poètes qui les avaient précédés, qu’ils en conservaient même la langue surannée. Aussi, tout le monde s’était dégoûté de la poésie dans les genres sérieux, et l’on ne s’occupait plus qu’à traduire les poèmes et romans du douzième siècle dans cette prose qui croissait tous les jours en grâce et en vigueur. Enfin, il fut décidé que la langue française n’était pas propre à la haute poésie, et les savants se hâtèrent de profiter de cet arrêt, pour prétendre qu’on ne devait plus la traiter qu’en vers latins et en vers grecs.
Quant à la poésie populaire, grâce à Villon et à Marot, elle avait marché de front avec la prose illustrée par les Joinville, les Froissart et les Rabelais : mais Marot éteint, son école n’était plus de taille à le continuer : ce fut elle cependant qui opposa à Ronsard la plus sérieuse résistance, et certes, bien qu’elle ne comptât plus d’hommes supérieurs, elle était assez forte sur l’épigramme : la tenaille de Mellin (2) , qui pinçait si fort Ronsard au milieu de sa gloire, a fait proverbe.
Je ne sais si le peu de phrases que je viens de hasarder suffit pour montrer la littérature d’alors dans cet état d’interrègne qui suit la mort d’un grand génie, ou la fin d’une brillante époque littéraire, comme cela s’est vu plusieurs fois depuis ; je ne sais si l’on se représente bien le troupeau des écrivains du second ordre se tournant inquiet à droite et à gauche et se cherchant un guide : les uns fidèles à la mémoire des grands hommes qui ne sont plus et laissant dans les rangs une place pour leur ombre ; les autres tourmentés d’un vague désir d’innovation qui se produit en essais ridicules ; les plus sages faisant des théories et des traductions.... Tout à coup un homme apparaît, à la voix forte, et dépassant la foule de la tête : celle-ci se sépare en deux partis, la lutte s’engage ; et le géant finit par triompher, jusqu’à ce qu’un plus adroit lui saute sur les épaules et soit seul proclamé très-grand.
Mais n’anticipons pas : nous sommes en 1549, et à peu de mois de distance apparaissent la défense et illustration de la langue française (3), et les premières odes pindariques de Pierre de Ronsard.
La défense de la langue française, par J. Dubellay, l’un des compagnons et des élèves de Ronsard, est un manifeste contre ceux qui prétendaient que la langue française était trop pauvre pour la poésie, qu’il fallait la laisser au peuple et n’écrire qu’en vers grecs et latins ; Dubellay leur répond : « que les langues ne sont pas nées d’elles-mêmes en façon d’herbes, racines et arbres ; les unes infirmes et débiles en leurs espérances ; les autres saines et robustes, et plus aptes à porter le faix des conceptions humaines, mais que toute leur vertu est née au monde du vouloir et arbitre des mortels. C’est pourquoi on ne doit ainsi louer une langue et blâmer l’autre, vu qu’elles viennent toutes d’une même source et origine : c’est la fantaisie des hommes ; et ont été formées d’un même jugement à une même fin : c’est pour signifier entre nous les conceptions et intelligences de l’esprit. Il est vrai que par succession de temps, les unes pour avoir été plus curieusement réglées sont devenues plus riches que les autres ; mais cela ne se doit attribuer à la félicité desdites langues ; mais au seul artifice et industrie des hommes. A ce propos, je ne puis assez blâmer la sotte arrogance et témérité d’aucuns de notre nation, qui n’étant rien moins que grecs ou latins déprisent ou rejettent d’un sourcil plus que stoïque, toutes choses écrites en Français. »
Il continue en prouvant que la langue française ne doit pas être appelée barbare, et recherche cependant pourquoi elle n’est pas si riche que les langues grecque et latine : « on le doit attribuer à l’ignorance de nos ancêtres, qui, ayant en plus grande recommandation le bien faire que le bien dire, se sont privés de la gloire de leurs bienfaits, et nous du fruit de l’imitation d’iceux, et par le même moyen, nous ont laissé notre langue si pauvre et nue, qu’elle a besoin des ornemens, et, s’il faut parler ainsi, des plumes d’autrui. Mais qui voudrait dire que la grecque et romaine eussent toujours été en l’excellence qu’on les a vues au temps d’Horace et de Démosthène, de Virgile et de Cicéron ? Et si ces auteurs eussent jugé que jamais pour quelque diligence et culture qu’on y pût faire, elles n’eussent su produire plus grand fruit, se fussent-ils tant efforcés de les mettre au point où nous les voyons maintenant ? Ainsi puis-je dire de notre langue qui commence encore à fleurir, sans fructifier : cela, certainement, non pour le défaut de sa nature, aussi apte à engendrer que les autres, mais par la faute de ceux qui l’ont eue en garde et ne l’ont pas cultivée à suffisance. Que si les anciens Romains eussent été aussi négligés à la culture de leur langue, quand premièrement elle commença à pulluler ; pour certain, en si peu de temps elle ne fût devenue si grande ; mais eux en guise de bons agriculteurs, l’ont premièrement transmuée d’un lieu sauvage dans un lieu domestique, puis, afin que plutôt et mieux elle pût fructifier, coupant à l’entour les inutiles rameaux, l’ont pour échange d’iceux restaurée de rameaux francs et domestiques, magistralement tirés de la langue grecque, lesquels soudainement se sont si bien entés et faits semblables à leurs troncs, que désormais ils n’apparaissent plus adoptifs, mais naturels. »
Suit une diatribe contre les traducteurs qui abondaient alors, comme il arrive toujours à de pareilles époques littéraires. Dubellay prétend « que ce labeur de traduire n’est pas un moyen suffisant pour élever notre vulgaire à l’égard des autres plus fameuses langues. Que faut-il donc ? Imiter, imiter les Romains, comme ils l’ont fait des Grecs ; comme Cicéron a imité Démosthène, et Virgile, Homère. »
Nous venons de voir ce qu’il pense des faiseurs de vers latins, et des traducteurs ; voici maintenant pour les imitateurs de la vieille littérature : « Et certes, comme ce n’est point chose vicieuse, mais grandement louable, d’emprunter d’une langue étrangère les sentences et les mots, et les approprier à la sienne : ainsi est-ce chose grandement à reprendre, voire odieuse à tout lecteur de libérale nature, de voir en une même langue une telle imitation, comme celle d’aucuns savants mêmes, qui s’estiment être des meilleurs plus ils ressemblent un Héroët ou un Marot. Je t’admoneste donc, ô toi qui désires l’accroissement de ta langue et veux y exceller, de n’imiter à pied levé, comme naguère a dit quelqu’un, les plus fameux auteurs d’icelle ; chose certainement aussi vicieuse, comme de nul profit à notre vulgaire, vu que ce n’est autre chose, sinon lui donner ce qui était à lui. »
Il jette un regard sur l’avenir et ne croit pas qu’il faille désespérer d’égaler les Grecs et les Romains : « Et comme Homère se plaignait que de son temps les corps étaient trop petits, il ne faut point dire que les esprits modernes ne sont à comparer aux anciens ; l’architecture, l’art du navigateur et autres inventions antiques, certainement sont admirables, et non si grandes toutefois qu’on doive estimer les cieux et la nature d’y avoir dépensé toute leur vertu, vigueur et industrie. Je ne produirai pour témoin de ce que je dis l’imprimerie, sœur des muses et dixième d’elles, et cette non moins admirable que pernicieuse foudre d’artillerie ; avec tant d’autres non antiques inventions qui montrent véritablement que par le long cours des siècles, les esprits des hommes ne sont point si abâtardis qu’on voudrait bien dire. Mais j’entends encore quelque opiniâtre s’écrier : ta langue tarde trop à recevoir sa perfection ; et je dis que ce retardement ne prouve point qu’elle ne puisse la recevoir ; je dis encore qu’elle se pourra tenir certaine de la garder longuement, l’ayant acquise avec si longue peine : suivant la loi de nature qui a voulu que tout arbre qui naît fleurisse et fructifie bientôt, bientôt aussi vieillisse et meure, et au contraire que celui-là dure par longues années, qui a longuement travaillé à jeter ses racines. »
Ici finit le premier livre où il n’a encore été question que de la langue et du style poétique : dans le second, la question est abordée plus franchement, et l’intention de renverser l’ancienne littérature et d’y substituer les formes antiques est exprimée avec plus d’audace :
« Je penserai avoir beaucoup mérité des miens si je leur montre seulement du doigt le chemin qu’ils doivent suivre pour atteindre à l’excellence des Anciens : mettons donc pour le commencement ce que nous avons, ce me semble, assez prouvé au premier livre. C’est que sans l’imitation des Grecs et Romains, nous ne pouvons donner à notre langue l’excellence et lumière des autres plus fameuses. Je sais que beaucoup me reprendront d’avoir osé, le premier des Français, introduire quasi une nouvelle poésie, ou ne se tiendraient pleinement satisfaits, tant pour la brièveté dont j’ai voulu user que pour la diversité des esprits dont les uns trouvent bon ce que les autres trouvent mauvais. Marot me plaît, dit quelqu’un, parce qu’il est facile et ne s’éloigne point de la commune manière de parler ; Héroët, dit quelqu’autre, parce que tous ses vers sont doctes, graves, élaborés ; les autres d’un autre se délectent. Quant à moi telle superstition ne m’a point retiré de mon entreprise, parce que j’ai toujours estimé notre poésie française être capable de quelque plus haut et merveilleux style que celui dont nous nous sommes si longuement contentés. Disons donc brièvement ce que nous semble de nos poètes français.
« De tous les anciens poètes français, quasi un seul, Guillaume de Loris et Jean de Meun (4), sont dignes d’être lus, non tant pour ce qu’il y ait en eux beaucoup de choses qui se doivent imiter des modernes, que pour y voir quasi une première image de la langue française, vénérable pour son antiquité. Je ne doute point que tous les pères crieraient la honte être perdue si j’osais reprendre ou émender quelque chose en ceux que jeunes ils ont appris, ce que je ne veux faire aussi ; mais bien soutiens-je que celui-là est trop grand admirateur de l’ancienneté qui veut défrauder les jeunes de leur gloire méritée : n’estimant rien, sinon ce que la mort a sacré, comme si le temps ainsi que les vins rendait les poésies meilleures. Les plus récents, même ceux qui ont été nommés par Clément Marot en une certaine épigramme à Salel, sont assez connus par leurs œuvres ; j’y renvoie les lecteurs pour en faire jugement. »
Il continue par quelques louanges et beaucoup de critiques des auteurs du temps, et revient à son premier dire, qu’il faut imiter les Anciens, « et non point les auteurs français, pour ce qu’en ceux-ci on ne saurait prendre que bien peu, comme la peau et la couleur, tandis qu’en ceux-là on peut prendre la chair, les os, les nerfs et le sang.
« Lis donc, et relis premièrement, ô poète futur, les exemplaires grecs et latins : puis me laisse toutes ces vieilles poésies françaises aux jeux floraux de Toulouse et au Puy de Rouan : comme rondeaux, ballades, virelais, chants royaux, chansons et autres telles épiceries qui corrompent le goût de notre langue, et ne servent sinon à porter témoignage de notre ignorance. Jette-toi à ces plaisants épigrammes, non point comme font aujourd’hui un tas de faiseurs de contes nouveaux qui en un dixain sont contents de n’avoir rien dit qui vaille aux neuf premier vers, pourvu qu’au dixième il y ait le petit mot pour rire, mais à l’imitation d’un Martial, ou de quelque autre bien approuvé ; si la lascivité ne te plaît, mêle le profitable avec le doux ; distille avec un style coulant et non scabreux de tendres élégies, à l’exemple d’un Ovide, d’un Tibulle et d’un Properce ; y entremêlant quelquefois de ces fables anciennes, non petit ornement de poésie. Chante-moi ces odes inconnues encore de la langue française, d’un luth bien accordé au son de la lyre grecque et romaine, et qu’il n’y ait rien où apparaisse quelque vestige de rare et antique érudition. Quant aux épîtres, ce n’est un poème qui puisse grandement enrichir notre vulgaire, parce qu’elles sont volontiers choses familières et domestiques, si tu ne les voulais faire à l’imitation d’élégies comme Ovide, ou sentencieusement graves comme Horace : autant te dis-je des satyres que les Français, je ne sais comment, ont nommé coqs à l’âne, auxquelles je te conseille aussi peu t’exercer, si ce n’est à l’exemple des anciens en vers héroïques, et sous ce nom de satyre, y taxer modestement les vices de ton temps et pardonner aux noms des personnes vicieuses. Tu as pour ceci Horace, qui, selon Quintilien, tient le premier lieu entre les satyriques. Sonne-moi ces beaux sonnets (5) ; non moins docte que plaisante invention italienne, pour lequel tu as Pétrarque et quelques modernes Italiens. Chante-moi d’une musette bien résonnante les plaisantes églogues rustiques à l’exemple de Théocrite et de Virgile. Quant aux comédies et tragédies, si les rois et les républiques les voulaient restituer en leur ancienne dignité qu’ont usurpée les farces et moralités, je serais bien d’opinion que tu t’y employasses, et si tu le veux faire pour l’ornement de la langue, tu sais où tu en dois trouver les archétypes. »
Je ne crois pas qu’on me reproche d’avoir cité tout entier ce chapitre où la révolution littéraire est si audacieusement proclamée ; il est curieux d’assister à cette démolition complète d’une littérature du moyen âge, au profit de tous les genres de composition de l’antiquité et la réaction analogue qui s’opère aujourd’hui doit lui donner un nouvel intérêt.
Dubellay conseille encore l’introduction dans la langue française de mots composés du latin et du grec, recommandant principalement de s’en servir dans les arts et sciences libérales. Il recommande, avec plus de raison, l’étude du langage figuré dont la poésie française avait jusqu’alors peu de connaissance ; il propose de plus quelques nouvelles alliances de mots accueillies depuis presque toutes : « d’user hardiment de l’infinitif pour le nom, comme l’aller, le chanter, le vivre, le mourir ; de l’adjectif substantivé, comme le vide de l’air, le frais de l’ombre, l’épais des forêts ; des verbes et des participes, qui de leur nature n’ont point d’infinitif après eux, avec des infinitifs, comme : tremblant de mourir pour craignant de mourir, etc. Garde-toi encore de tomber en un vice commun, même aux plus excellents de notre langue : c’est l’omission des articles.
« Je ne veux oublier l’émendation, partie certes la plus utile de nos études ; son office est d’ajouter, ôter, ou changer à loisir ce que la première impétuosité et ardeur d’écrire n’avait permis de faire ; il est nécessaire de remettre à part nos écrits nouveaux nés, les revoir souvent, et en la manière des ours, leur donner forme, à force de lécher. Il ne faut pourtant y être trop superstitieux, ou, comme les éléphants, leurs petits, être dix ans à enfanter ses vers. Surtout nous convient avoir quelques gens savans et fidèles compagnons qui puissent connaître nos fautes et ne craignent pas de blesser notre papier avec leurs ongles. Encore te veux-je avertir de hanter quelquefois non-seulement les savans, mais aussi toutes sortes d’ouvriers et gens mécaniques, savoir leurs inventions, les noms des matières et termes usités en leurs arts et métiers pour tirer de là de belles comparaisons et descriptions de toutes choses.
« Vous semble-t-il pas, messieurs, qui êtes si ennemis de votre langue, que notre poète ainsi armé puisse sortir en campagne, et se montrer sur les rangs avec les braves escadrons grecs et romains. Et vous autres si mal équipés, dont l’ignorance a donné le ridicule nom de rimeur à notre langue, oserez-vous bien endurer le soleil, la poudre et le dangereux labeur de ce combat ? Je suis d’avis que vous vous retiriez au bagage avec les pages et laquais, ou bien (car j’ai pitié de vous) sous les frais ombrages, entre les dames et damoiselles où vos beaux et mignons écrits, non de plus longue durée que votre vie, seront reçus, admirés et adorés. Que plût aux Muses pour le bien que je veux à notre langue que vos ineptes œuvres fussent bannies non seulement, comme elles le sont, des bibliothèques des savans, mais de toute la France. »
On voit que les disputes littéraires de ce temps n’étaient pas moins animées qu’elles le sont aujourd’hui. Dubellay s’écrie qu’il faudrait que tous les rois amateurs de leur langue, défendissent d’imprimer les œuvres de ces ignorans.
« Oh ! combien je désire voir sécher ces printemps, châtier ces petites jeunesses, rabattre ces coups d’essai, tarir ces fontaines, bref abolir ces beaux titres suffisans pour dégoûter tout lecteur savant d’en écouter davantage ! Je ne souhaite pas moins que ces dépourvus, ces humbles espérants, ces bannis de Liesse, ces esclaves, ces traverseurs (6), soient renvoyés à la table ronde, et ces belles petites devises aux gentilshommes et damoiselles, d’où on les a empruntées. Que dirai-je plus ? Je supplie à Phébus Apollon, que la France, après avoir été si longuement stérile, grosse de lui, enfante bientôt un poète dont le luth bien résonnant fasse tarir ces enrouées cornemuses, non autrement que les grenouilles quand on jette une pierre en leur marais. »(7)
Après une nouvelle exhortation aux Français d’écrire en leur langue, Dubellay finit ainsi : « Or nous voici grâce à Dieu, après beaucoup de périls et de flots étrangers, rendus au port à sûreté. Nous avons échappé du milieu des Grecs et au travers des escadrons romains, pénétré jusqu’au sein de la France, tant désirée France. Là, donc, Français, marchez courageusement vers cette superbe cité romaine, et de ses serves dépouilles ornez vos temples et autels. Ne craignez plus ces oies criardes, ce fier Manlie et ce traître Camille, qui sous ombre de bonne foi vous surprennent tous nus comptant la rançon du Capitole. Donnez en cette Grèce menteresse et y semez encore un coup la fameuse nation des Gallogrecs. Pillez-moi sans conscience les sacrés trésors de ce temple Delphique, ainsi que vous avez fait autrefois, et ne craignez plus ce muet Apollon ni ses faux oracles.Vous souvienne de votre ancienne Marseille, seconde Athènes, et de votre Hercule gallique tirant les peuples après lui par leurs oreilles avec une chaîne attachée à sa langue. »
C’est un livre bien remarquable que ce livre de Dubellay ; c’est un de ceux qui jettent le plus de jour sur l’histoire de la littérature française, et peut-être aussi le moins connu de tous les traités écrits sur ce sujet : je ne sache pas qu’aucun auteur s’en soit servi depuis deux siècles, si ce n’est M. Sainte-Beuve qui en a donné une analyse. Je n’aurais pas hasardé cette citation, beaucoup plus longue encore, si je ne la regardais comme l’histoire la plus exacte que l’on puisse faire de l’école de Ronsard.
En effet, tout est là : à voir comme les réformes prêchées, les théories développées dans La Défense et illustration de la langue française, ont été fidèlement adoptées depuis et mises en pratique dans tous leurs points, il est même difficile de douter qu’elle ne soit l’œuvre de cette école tout entière : je veux dire de Ronsard, Pontus de Tyard, Rémi Belleau, Etienne Jodelle, J. Antoine de Baïf, qui joints à Dubellay, composaient ce qu’on appela depuis la Pléiade (8). Du reste, la plupart de ces auteurs avaient déjà écrit beaucoup d’ouvrages dans le système prêché par Dubellay, bien qu’ils ne les eussent point fait encore imprimer : de plus il est question des odes dans l’Illustration, et Ronsard dit plus tard dans une préface avoir le premier introduit le mot ode dans la langue française ; ce qu’on n’a jamais contesté.
Mais soit que ce livre ait été de plusieurs mains, soit qu’une seule plume ait exprimé les vœux et les doctrines de toute une association de poètes, il porte l’empreinte de la plus complète ignorance de l’ancienne littérature française ou de la plus criante injustice. Tout le mépris que Dubellay professe, à juste titre, envers les poètes de son temps imitateurs des vieux poètes, y est, à grand tort, reporté aussi sur ceux-là qui n’en pouvaient mais. C’est comme si, aujourd’hui, on en voulait aux auteurs du Grand Siècle de la platitude des rimeurs modernes qui marchent sous leur invocation.
Se peut-il que Dubellay, qui recommande si fort d’enter sur le tronc national près à périr des branches étrangères, ne songe point même qu’une meilleure culture puisse lui rendre la vie et ne le croie pas susceptible de porter des fruits par lui-même. Il conseille de faire des mots d’après le grec et le latin, comme si les sources eussent manqué pour en composer de nouveaux d’après le vieux français seul ; il appuie sur l’introduction des odes, élégies, satires, etc., comme si toutes ces formes poétiques n’avaient pas existé déjà sous d’autres noms ; du poème antique, comme si les chroniques normandes et les romans chevaleresques n’en remplissaient pas toutes les conditions, appropriées de plus au caractère et à l’histoire du moyen âge ; de la tragédie, comme s’il eût manqué aux mystères autre chose que d’être traités par des hommes de génie pour devenir la tragédie du moyen âge, plus libre et plus vraie que l’ancienne. Supposons en effet un instant les plus grands poètes étrangers et les plus opposés au système classique de l’antiquité, nés en France au seizième siècle, et dans la même situation que Dubellay et ses amis. Croyez-vous qu’ils n’eussent pas été là, et avec les seules ressources et les élémens existans alors dans la littérature française, ce qu’ils furent à différentes époques et dans différens pays ? Croyez-vous que l’Arioste n’eût pas aussi bien composé son Roland furieux avec nos fabliaux et nos poèmes chevaleresques ; Shakespear, ses drames avec nos romans, nos chroniques, nos farces et même nos mystères ; Le Tasse sa Jérusalem, avec nos livres de chevalerie et les éblouissantes couleurs poétiques de notre littérature romane, etc. Mais les poètes de la réforme classique n’étaient point de cette taille, et peut-être est-il injuste de vouloir qu’ils aient vu dans l’ancienne littérature française ce que ces grands hommes y ont vu, avec le regard du génie, et ce que nous n’y voyons aujourd’hui sans doute que par eux. Au moins rien ne peut-il justifier ce superbe dédain qui fait prononcer aux poètes de la Pléiade, qu’il n’y a absolument rien avant eux, non seulement dans les genres sérieux, mais dans tous ; ne tenant pas plus compte de Rutebœuf que de Charles d’Anjou, de Villon que de Charles d’Orléans, de Clément Marot que de Saint-Gelais, et de Rabelais que de Joinville et de Froissart dans la prose. Sans cette ardeur d’exclure, de ne rebâtir que sur des ruines, on ne peut nier que l’étude et même l’imitation momentanée de la littérature antique, n’eussent pu être, dans les circonstances d’alors, très favorables aux progrès de la nôtre et de notre langue aussi ; mais l’excès a tout gâté : de la forme on a passé au fond ; on ne s’est pas contenté d’introduire le poème antique, on a voulu qu’il dît l’histoire des anciens et non la nôtre ; la tragédie, on a voulu qu’elle ne célébrât que les infortunes des illustres familles d’Œdipe et d’Agamemnon : on a amené la poésie à ne reconnaître et n’invoquer d’autres dieux que ceux de la mythologie : en un mot cette expédition présentée si adroitement par Dubellay comme une conquête sur les étrangers, n’a fait au contraire que les amener vainqueurs dans nos murs ; elle a tendu à effacer petit à petit notre caractère de nation, à nous faire rougir de nos usages et même de notre langue au profit de l’antiquité, à nous amener, en un mot, à ce comble de ridicule, qu’au dix-neuvième siècle même nous représentions encore nos rois et nos héros en costumes romains, séduits que nous sommes par de fausses idées de goût et de convenance. Bon Dieu ! que diront un jour nos arrière-neveux en découvrant des pierres sépulchrales de chrétiens, qui portent pour légende : diis manibus !(9) des monuments où il est inscrit : mdcccxxx anno regnante carolo decimo, praefectus et aediles posuerunt, etc (10). Ne seront-ils pas fondés à croire qu’en l’an 1830 la domination romaine subsistait encore en France ; de même qu’en lisant quelques lambeaux échappés au temps de notre poésie, ils pourront se persuader que le paganisme était aussi notre religion dominante ? C’est certainement à ce défaut d’accord et de sympathie de la littérature classique avec nos mœurs et notre caractère national, qu’il faut attribuer, outre les ridicules anomalies que je viens de citer en partie, le peu de popularité qu’elle a obtenu.
Voici une digression qui m’entraîne bien loin : j’y ai jeté au hasard quelques raisons déjà rebattues, il y en a des volumes de beaucoup meilleures ; et cependant que de gens refusent encore de s’y rendre ! Une tendance plus raisonnable se fait, il est vrai, remarquer depuis quelques années (11), on se met à lire un peu d’histoire de France ; et quand dans les collèges on sera parvenu à la savoir presque aussi bien que l’histoire ancienne, et quand aussi on consacrera à l’étude de la langue française quelques heures arrachées au grec et au latin, un grand progrès sera sans doute accompli pour l’esprit national, et peut-être s’ensuivra-t-il moins de dédain pour la vieille littérature française, car tout cela se tient.
J’ai accusé l’école de Ronsard de nous avoir imposé une littérature classique quand nous pouvions fort bien nous en passer, et surtout de nous l’avoir imposée si exclusive, si dédaigneuse de tout le passé qui était à nous ; mais à considérer ses travaux et ses innovations sous un autre point de vue, celui des progrès du style et le la couleur poétique, il faut avouer que nous lui devons beaucoup de reconnaissance ; il faut avouer que dans tous les genres qui ne demandent pas une grande force de création, dans tous les genres de poésie gracieuse et légère, elle a surpassé et les poètes qui l’avait précédée, et beaucoup de ceux qui l’ont suivie. Dans ces sortes de compositions aussi l’imitation classique est moins sensible : les petites odes de Ronsard, par exemple, semblent la plupart inspirées par les chansons du douzième siècle qu’elles surpassent souvent encore en naïveté et en fraîcheur ; ses sonnets aussi, et quelques-unes de ses élégies sont empreintes du véritable sentiment poétique, si rare, quoi qu’on en dise, que tout le dix-huitième siècle, tout riche qu’il est en poésies diverses, semble en être absolument dénué.
Mais pour faire sentir les immenses progrès que Ronsard a fait faire à la langue poétique, si pâle jusqu’à lui dans les genres sérieux, il est bon de donner une idée de ce qu’elle était au moment qu’il l’a prise. Pour cela, je transcris au hasard le début d’un poème publié la même année que ses odes pindariques, et par un des auteurs les plus estimés du temps (Pandore, par Guillaume de Tours)
- O dieu Phébus, des saints poètes père,
- Du grand tonnant la lignée tant clère,
- Qui sus ton chef à perruque dorée
- Portes les fleurs de Daphnes transmuée
- Dans un laurier toujours verd qu’on blasonne,
- Car tu t’en ceints, et en fais ta couronne,
- Viens, viens à nous, viens ici en la guise
- Qu’en Hélicon, haute montagne sise
- Très hautement les doctes sœurs enseignes
- Là des pieds nus dansantes aux enseignes
- De leur gaîté, tout autour des autiers
- De ton parent Jupiter et au tiers
- Toi réjoui de douce mélodie
- Les adoucis et de ta poésie ;
- Sois ci présent, et au labeur et peine
- De toi chantant donne joyeux étrenne
- De bien ditter et lui donne faveur,
- Car il nous plaît la fable qui n’est moindre
- D’aultres narrez intexer et la joindre
- Que bien ditta Astreus sainct poète, etc.
En vérité, rien qui surpasse ces vers, dans toute la haute poésie d’alors ; si quelqu’un en doute, qu’il lise encore les hymnes de Marot, de Marot si poète dans les genres plaisans, et il verra quel abîme existait entre le style élevé et le genre gracieux et naïf. Maintenant jugez de quelle admiration le public de 1550 dut se sentir saisi en entendant des strophes pareilles à celles que je vais citer, et qui faisaient partie d’une ode pindarique où le poète racontait la guerre des dieux contre les titans (12).
- Bellone eut la tête couverte
- D’un acier, sur qui rechignait
- De Méduse la gueule ouverte,
- Qui pleine de flammes grognait ;
- En sa dextre elle enta la hache
- Par qui les rois sont irrités,
- Alors que, dépite, elle arrache
- Les vieilles tours de leurs cités !
- Adonc le Père puissant,
- Qui de nerfs roidis s’efforce !
- Ne mit en oubli la force
- De son foudre rougissant :
- Mi-courbant la tête en bas,
- Et bien haut levant le bras,
- Contre eux guigna sa tempête,
- Laquelle, en les foudroyant,
- Sifflait, aigu-tournoyant,
- Comme un fuseau sur leur tête.
- De feu, les deux piliers du monde,
- Brûlés jusqu’au fond, chancelaient :
- Le ciel ardait, la terre et l’onde
- Tout pétillans étincelaient, etc.
La langue est encore la même que dans le morceau cité plus haut ; mais quelle différence dans la vigueur du style et l’éclat de la pensée ! Eh bien ! veut-on savoir tout d’un coup à quoi s’en tenir sur les progrès que Ronsard a fait faire à la langue poétique, qu’on rapproche ce fragment, composé dans ses premières années, des vers suivans, composés dix ans après, pour l’avènement au trône de Charles IX. Ce sont quelques-uns des conseils qu’il lui adresse :
- Ne vous montrez jamais pompeusement vêtu :
- L’habillement des rois est la seule vertu :
- Que votre corps reluise en vertus glorieuses,
- Non par habits chargés de pierres précieuses.
- D’amis plus que d’argent montrez-vous désireux,
- Les princes sans amis sont toujours malheureux ;
- Aimez les gens de bien, ayant toujours envie
- De ressembler à ceux qui sont de bonne vie ;
- Punissez les malins et les séditieux :
- Ne soyez point chagrin, dépit ni furieux,
- Mais honnête et gaillard, portant sur le visage
- De votre gentille âme un gentil témoignage.
- Or, sire, pour autant que nul n’a le pouvoir
- De châtier les rois qui font mal leur devoir,
- Corrigez-vous vous-même, afin que la justice
- De Dieu qui est plus grand vos fautes ne punisse.
- Je dis ce puissant Dieu, dont la force est partout,
- Qui conduit l’univers de l’un à l’autre bout,
- Et fait à tous humains ses justices égales,
- Autant aux laboureurs qu’aux personnes royales.
- Lequel nous supplions vous tenir en sa loi,
- Et vous aimer autant qu’il fit David son roi,
- Et rendre comme à lui votre sceptre tranquille,
- Car sans l’aide de Dieu la force est inutile.
On pourra juger d’après ces vers, dont le style est en général celui de tous les discours de Ronsard, combien est ridicule l’accusation d’obscurité et de dureté qui depuis deux siècles flétrit sa poésie ; et il nous sera de plus loisible d’avancer que La Harpe ne les avait jamais lues, lorsqu’il s’écrie qu’on ne peut pas lire et comprendre quatre vers de suite de Ronsard. Qu’on me permette de citer encore une ce ses élégies, qui sans être partout aussi pure que le morceau précédent, lui est supérieure, ce me semble, sous le rapport de la poésie :
A MARIE.
- Six ans étaient coulés, et la septième année
- Était presques entière en ses pas retournée,
- Quand loin d’affection, de désir et d’amour,
- En pure liberté je passais tout le jour,
- Et franc de tout souci qui les âmes dévore,
- Je dormais dès le soir jusqu’au point de l’aurore ;
- Car seul, maître de moi, j’allais, plein de loisir
- Où le pied me portait, conduit à mon désir,
- Ayant toujours aux mains, pour me servir de guide,
- Aristote ou Platon, ou le docte Euripide,
- Mes bons hôtes muets, qui ne fâchent jamais ;
- Ainsi je les reprends, ainsi je les remets.
- O douce compagnie, et utile et honnête !
- Un autre caquetant m’étourdirait la tête.
- Puis, du livre ennuyé, je regardais les fleurs,
- Feuilles, tiges, rameaux, espèces et couleurs ;
- Et l’entrecoupement de leurs formes diverses,
- Peintes de cent façons, jaunes, rouges et perses (13).
- Ne me pouvant souler, ainsi qu’en un tableau,
- D’admirer la nature et ce qu’elle a de beau,
- Et de dire en passant aux fleurettes écloses :
- Celui est presque Dieu qui connaît toutes choses,
- Écarté du vulgaire et loin des courtisans
- De fraude et de malice impudens artisans.
- Tantôt j’errais seulet par les forêts sauvages
- Sur les bords émaillés des peinturés rivages,
- Tantôt par les rochers reculés et déserts,
- Tantôt par les taillis, verte maison des cerfs.
- J’aimais le cours suivi d’une longue rivière,
- A voir onde sur onde allonger sa carrière,
- Et flot à l’autre flot en roulant s’attacher ;
- Et penché sur le bord, me plaisait d’y pêcher,
- Étant plus réjoui d’une chasse muette,
- Troubler des écaillés la demeure secrète,
- Tirer avec la ligne en tremblant emporté
- Le crédule poisson pris à l’haim appâté,
- Qu’un grand prince n’est aise ayant pris à la chasse
- Un cerf qu’en haletant tout un jour il pourchasse :
- Heureux si vous eussiez d’un mutuel émoi
- Pris l’appât amoureux aussi bien comme moi...
- Las ! couché dessus l’herbe en mes discours je pense
- Que pour aimer beaucoup j’ai peu de récompense,
- Et que mettre son cœur aux dames si avant,
- C’est vouloir peindre en l’onde et arrêter le vent.
- M’assurant toutefois qu’alors que le vieil âge
- Aura, comme sorcier, changé votre visage,
- Et lorsque vos cheveux deviendront argentés,
- Et que vos yeux d’amour ne seront plus hantés,
- Que toujours vous aurez quelque soin qui vous touche,
- En l’esprit mes écrits, mon nom en votre bouche.
Le lecteur doit être bien surpris de ne point rencontrer là cette muse en françois parlant grec et latin contre laquelle Boileau s’escrime si rudement, de fort bien comprendre ce patois que jargonnoit Ronsard à la cour des Valois, et de ne le point trouver si éloigné qu’il croyait du beau français d’aujourd’hui : c’est qu’il n’est pas en littérature de plus étrange destinée que celle de Ronsard : idole d’un siècle éclairé ; illustré de l’admiration d’hommes tels que les de Thou, les L’Hospital, les Pasquier, les Scaliger, proclamé plus tard par Montaigne l’égal des plus grands poètes anciens, traduit dans toutes les langues, entouré d’une considération telle que le Tasse, dans un voyage à Paris, ambitionna l’avantage de lui être présenté ; honoré à sa mort de funérailles presque royales et des regrets de la France entière, il semblait devoir, selon l’expression de M. Sainte-Beuve, entrer dans la postérité comme dans un temple. Non ! la postérité est venue, et elle a convaincu le seizième siècle de mensonge et de mauvais goût, elle a livré au rire et à l’injure les morceaux de l’idole brisée, et les dieux nouveaux se sont substitués à la trop célèbre Pléiade en se parant de ses dépouilles.
La Pléiade, soit : qu’importent tous ces poètes à la suite, qui sont Baïf, Belleau, Ponthus, sous Ronsard ; qui sont Racan, Segrais, Sarrazin, sous Malherbe ; qui sont Desmahis, Bernis, Villette, sous Voltaire, etc. Mais pour Ronsard il y a encore une postérité : et aujourd’hui surtout qu’on remet tout en question, et que les hautes renommées sont pesées, comme les âmes aux enfers, nues, dépouillées de toutes les préventions, favorables ou non, avec lesquelles elles s’étaient présentées à nous, qui sait si Malherbe se trouvera encore de poids à représenter le père de la poésie classique ; ce ne serait point là le seul arrêt de Boileau qu’aurait cassé l’avenir.
Nous n’exprimons ici qu’un vœu de justice et d’ordre, selon nous, et nous n’avons pas jugé l’école de Ronsard assez favorablement pour qu’on nous soupçonne de partialité. Si notre conviction est erronée, ce ne sera pas faute d’avoir examiné les pièces du procès, faute d’avoir feuilleté les livres oubliés depuis près de trois cents ans. Si tous les auteurs d’histoires littéraires avaient eu cette conscience, on n’aurait pas vu des erreurs grossières se perpétuer dans mille volumes différens, composés les uns sur les autres ; on n’aurait pas vu des jugemens définitifs se fonder sur d’aigres et partiales critiques échappées à l’acharnement momentané d’une lutte littéraire, ni de hautes réputations s’échafauder avec des œuvres admirées sur parole.
Non, sans doute, nous ne sommes pas indulgens envers l’école de Ronsard : et en effet, on ne peut que s’indigner, au premier abord, de l’espèce de despotisme qu’elle a introduit en littérature, de cet orgueil avec lequel elle prononçait le odi profanum vulgus d’Horace, repoussant toute popularité comme une injure, et n’estimant rien que de noble, et sacrifiant toujours à l’art le naturel et le vrai. Ainsi aucun poète n’a célébré davantage et la nature et le printemps que ne l’ont fait ceux du seizième siècle, et croyez-vous qu’ils aient jamais songé à demander des inspirations à la nature et au printemps ? Jamais ! Ils se contentaient de rassembler ce que l’antiquité avait dit de plus gracieux sur ce sujet, et d’en composer un tout, digne d’être apprécié par les connaisseurs ; il arrivait de là qu’ils se gardaient de leur mieux d’avoir une pensée à eux, et cela est tellement vrai, que les savans commentaires dont on honorait leurs œuvres ne s’attachaient qu’à y découvrir le plus possible d’imitations de l’antiquité. Ces poètes ressemblaient en cela beaucoup à certains peintres qui ne composent leurs tableaux que d’après ceux des maîtres, imitant un bras chez celui-ci, une tête chez cet autre, une draperie chez un troisième, le tout pour la plus grande gloire de l’art, et qui traitent d’ignorans ceux qui se hasardent à leur demander s’il ne vaudrait pas mieux imiter tout bonnement la nature.
Puis après ces réflexions qui vous affectent désagréablement à la première lecture des œuvres de la Pléiade, une lecture plus particulière vous réconcilie avec elle : les principes ne valent rien ; l’ensemble est défectueux, d’accord ; et faux et ridicule, mais on se laisse aller à admirer certaines parties des détails ; ce style primitif et verdissant assaisonne si bien de vieilles pensées déjà banales chez les Grecs et les Romains, qu’elles ont pour nous tout le charme de la nouveauté : quoi de plus rebattu, par exemple, que cette espèce de syllogisme sur lequel est fondée l’odelette de Ronsard : Mignonne, allons voir si la rose, etc. Eh bien ! la mise en œuvre en a fait l’un des morceaux les plus frais et les plus gracieux de notre poésie légère. Celle de Belleau, intitulée : Avril, toute composée au reste d’idées communes, n’en ravit pas moins quiconque a de la poésie dans le cœur : qui pourrait dire en combien de façons est retournée dans beaucoup d’autres pièces l’éternelle comparaison des fleurs et des amours qui ne durent qu’un printemps ; et tant d’autres lieux communs que toutes les poésies fugitives nous offrent encore aujourd’hui ? Eh bien ! nous autres Français, qui attachons toujours moins de prix aux choses, qu’à la manière dont elles sont dites, nous nous en laissons charmer, ainsi que d’un accord mille fois entendu, si l’instrument qui le répète est mélodieux.
Voici pour la plus grande partie de l’école de Ronsard (14) ; la part du maître doit être plus vaste : toutes ses pensées à lui ne viennent pas de l’antiquité ; tout ne se borne pas dans ses écrits à la grâce et à la naïveté de l’expression : on taillerait aisément chez lui plusieurs poètes fort remarquables et fort distincts, et peut-être suffirait-il pour cela d’attribuer à chacun d’eux quelques années successives de sa vie. Le poète pindarique se présente d’abord : c’est au style de celui-là qu’ont pu s’adresser avec plus de justice les reproches d’obscurité, d’hellénisme, de latinisme et d’enflure qui se sont perpétués sans examen jusqu’à nous de notice en notice : l’étude des autres poètes du temps aurait cependant prouvé que ce style existait avant lui : cette fureur de faire des mots d’après les anciens a été attaquée par Rabelais, bien avant l’apparition de Ronsard et de ses amis ; au total il s’en trouve peu chez eux qui ne fussent en usage déjà. Leur principale affaire était l’introduction des formes classiques, et bien qu’ils aient aussi recommandé celle des mots, il ne paraît pas qu’ils s’en soient occupés beaucoup, et qu’ils aient même employé les premiers ces doubles mots qu’on a représenté comme si fréquents dans leur style.
Voici venir maintenant le poète amoureux et anacréontique : à lui s’adressent les observations faites une page plus haut, et c’est celui-là qui a fait le plus école : vers les derniers temps, il tourne à l’élégie, et là seulement peu de ses imitateurs ont pu l’atteindre, à cause de la supériorité avec laquelle il y manie l’alexandrin, employé fort peu avant lui, et qu’il a immensément perfectionné.
Ceci nous conduit à la dernière époque du talent de Ronsard, et ce me semble à la plus brillante, bien que la moins célébrée. Ses discours contiennent en germe l’épître et la satire régulière, et mieux que tout cela une perfection de style qui étonne plus qu’on ne peut dire. Mais aussi combien peu de poètes l’ont immédiatement suivi dans cette région supérieure ! Régnier seulement s’y présente long-temps après, et on ne se doute guère de tout ce qu’il doit à celui qu’il avouait hautement pour son maître.
Dans les discours surtout se déploie cet alexandrin fort et bien rempli, dont Corneille eut depuis le secret, et qui fit contraster son style avec celui de Racine d’une manière si remarquable : il est singulier qu’un étranger, M. Schlegel, ait fait le premier cette observation : « Je regarde comme incontestable, dit-il, que le grand Corneille appartienne encore à certains égards, pour la langue surtout, à cette ancienne école de Ronsard, ou du moins la rappelle souvent. » On se convaincra bien aisément de cette vérité en lisant les discours de Ronsard, et surtout celui des misères du temps.
Depuis peu d’années, quelques poètes, et Victor Hugo surtout, paraissent avoir étudié cette versification énergique et brillante de Ronsard, dégoûtés qu’ils étaient de l’autre : j’entends la versification racinienne, si belle à son commencement, et que depuis on a tant usée et aplatie à force de la limer et de la polir. Elle n’était point usée au contraire, celle de Ronsard et de Corneille, mais rouillée seulement, faute d’avoir servi.
Ronsard mort, après toute une vie de triomphes incontestés, ses disciples, tels que les généraux d’Alexandre, se partagèrent tout son empire, et achevèrent paisiblement d’asservir ce monde littéraire, dont certainement sans lui ils n’eussent pas fait la conquête. Mais, pour en conserver long-temps la possession, il eût fallu, ou qu’eux-mêmes ne fussent pas aussi secondaires qu’ils étaient, ou qu’un maître nouveau étendît sur tous ces petits souverains une main révérée et protectrice. Cela ne fut pas ; et dès lors on dut prévoir, aux divisions qui éclatèrent, aux prétentions qui surgirent, à la froideur et à l’hésitation du public envers les œuvres nouvelles, l’imminence d’une révolution analogue à celle de 1549, dont le grand souvenir de Ronsard, qui survivait encore craint des uns et vénéré du plus grand nombre, pouvait seul retarder l’explosion de quelques années.
Enfin Malherbe vint ! et la lutte commença. Certes ! il était alors beaucoup plus aisé que du temps de Ronsard et de Dubellay de fonder en France une littérature originale : la langue poétique était toute faite, grâce à eux ; et, bien que nous nous soyons élevé contre la poésie antique substituée par eux à une poésie du moyen âge, nous ne pensons pas que cela eût nui à un homme de génie, à un véritable réformateur venu immédiatement après eux ; cet homme de génie ne se présenta pas : de là tout le mal : le mouvement imprimé dans le sens classique, qui eût pu même être de quelque utilité comme secondaire, fut pernicieux (15), parce qu’il domina tout : la réforme prétendue de Malherbe ne consista absolument qu’à le régulariser, et c’est de cette opération qu’il a tiré toute sa gloire.
On sentait bien dès ce temps-là combien cette réforme annoncée si pompeusement était mesquine, et conçue d’après des vues étroites. Régnier surtout, Régnier, poète d’une toute autre force que Malherbe, et qui n’eut que le tort d’être trop modeste, et de se contenter d’exceller dans un genre à lui, sans se mettre à la tête d’aucune école, tance celle de Malherbe avec une sorte de mépris :
- Cependant leur savoir ne s’étend seulement
- Qu’à regratter un mot douteux au jugement ;
- Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue,
- Épier si des vers la rime est brève ou longue,
- Ou bien si la voyelle à l’autre s’unissant,
- Ne rend point à l’oreille un vers trop languissant,
- Et laissent sur le verd le noble de l’ouvrage.
(Voy. toute la satire intit. : le Critique outré.)
Tout cela est très-vrai. Malherbe réformait en grammairien, en éplucheur de mots, et non pas en poète ; et, malgré toutes ses invectives contre Ronsard, il ne songeait pas même qu’il y eût à sortir du chemin qu’avaient frayé les poètes de la Pléiade, ni par un retour à la vieille littérature nationale, ni par la création d’une littérature nouvelle, fondée sur les mœurs et les besoins du temps, ce qui, dans ces deux cas, eût probablement amené à un même résultat. Toute sa prétention à lui fut de purifier le fleuve qui coulait du limon que roulaient ses ondes, ce qui ne put se faire sans lui enlever aussi en partie l’or et les germes précieux qui s’y trouvaient mêlés : aussi voyez ce qu’a été la poésie après lui ; je dis : la poésie.
L’art, toujours l’art, froid, calculé, jamais de douce rêverie, jamais de véritable sentiment religieux, rien que la nature ait immédiatement inspiré : le correct, le beau exclusivement ; une noblesse uniforme de pensées et d’expression ; c’est Crésus qui a le don de changer en or tout ce qu’il touche. Décidément le branle est donné à la poésie classique : La Fontaine seul y résistera, aussi Boileau l’oubliera-t-il dans son art poétique.
_____
(1)Tous les critiques étrangers s’accordent sur ce point. Citons entre mille un passage d’une revue anglaise, rapporté tout récemment par le Mercure, et qui faisait partie d’un article où notre littérature était fort maltraitée : « Il serait injuste cependant de ne point reconnaître que ce fut aux Français que l’Europe dut sa première impulsion poétique, et que la littérature romane, qui distingue le génie de l’Europe moderne du génie classique de l’antiquité, naquit avec les trouveurs et les conteurs du nord de la France, les jongleurs et les ménestrels de Provence. »
(2) Mellin de Saint-Gelais.
(3) Par I.D.B.A. (Joachim Dubellay.) Paris, Arnoul Angelier, 1549. Le privilège date de 1548.
(4) Auteurs du Roman de la Rose.
(5) Sonne-moi ces sonnets : ceci est un trait du mauvais goût d’alors, auquel le jeune novateur n’a pu entièrement se soustraire. Nous trouvons plus haut : Distille avec un style. Ronsard lui-même a cédé quelquefois à ce plaisir de jouer sur les mots : Dorat qui redore la langue française ; Mellin aux paroles de miel, etc.
(6) Allusion aux ridicules surnoms que prenaient les poètes du temps : l’Humble espérant (Jehan le Blond) ; le Banni de Liesse (François Habert) ; l’Esclave fortuné (Michel d’Ambroise) ; le Traverseur des voies périlleuses (Jehan Bouchet). Il y avait encore le Solitaire (Jehan Gohorry) ; l’Esperonnier de discipline (Antoine de Saix), etc., etc.
(7) Il s’agit là de Pierre de Ronsard, annoncé comme le Messie par ce nouveau saint Jean. Dubellay a-t-il voulu équivoquer sur le prénom de Ronsard avec cette figure de pierre ? Ce serait peut-être aller trop loin que de le supposer.
(8) Il est à remarquer que l’Illustration ne parle nominativement d’aucun d’entre eux ; plusieurs cependant étaient déjà connus. Il me semble que Dubellay n’aurait pas manqué de citer ses amis, s’il eût porté seul la parole.
(9) Quelques-unes portent d.m. au sommet de la légende ; mais il n’y en a peut-être pas le quart où il ne soit question des mânes du défunt. Que d’observations de ce genre il y aurait encore à faire !
(10) Écoutons Paul Courier, à propos des inscriptions latines : « Camera compotorum leur paraissait beaucoup plus beau que la Chambre des comptes : cette manie dura, et même n’a point passé ; des inscriptions nous disent en mots de Cicéron qu’est ici le Marché-Neuf ou bien la Place-aux-Veaux. »
(11) Il est à espérer que la révolution de 93 aura donné lieu à la dernière explosion de l’imitation des anciens, et que nous en aurons fini cette fois avec les Léonidas, et les Brutus, et les Régulus, et les grandes odes pindariques, et les consuls, et les tribuns, et toute la défroque de la république romaine ajustée au dix-neuvième siècle ; c’est quelque chose déjà pour nous que d’avoir le coq gaulois en place de l’aigle classique.
(12) Cette ode était contenue dans le recueil intitulé : Les quatre premiers Livres d’odes de P. de Ronsard vendomois, ensemble et son Boccaige ; Paris, G. Cavellat, 1550.
Ronsard avait déjà publié séparément l’année précédente, l’Hymne de France, Paris, Vascosan, et l’Hymne de la paix, G. Cavellat, 1549. Ces trois pièces très rares ne sont point indiquées sur le catalogue de la Bibliothèque royale, ce qui a fait commettre à tous les bibliographes une erreur de date touchant la publication des premiers écrits de Ronsard.
(13) Bleues.
(14) Nous nous occuperons plus en détail des différens auteurs du seizième siècle dans le volume qui contiendra les poésies de ceux du dix-septième, afin de marquer mieux la filiation des écoles diverses entre elles.
(15) Il ne s’agit dans tout ceci que de principes généraux. Nous avançons que le système classique a été fatal aux auteurs des deux siècles derniers, sans porter du reste aucune atteinte à leur gloire et au mérite de leurs écrits.
_____
[ Nerval cite de Pierre de Ronsard : ]
— Dix-sept odes : « À J. Daurat », « Dieu vous gard, messagers fidelles », « Mignonne, allons voir si la rose », « Bel Aubespin fleurissant », « Sur tous parfums j’ayme la rose », « Dessus l’espine en may desclose », « De l’élection de son sépulchre », « Ah Dieu ! que malheureux nous sommes ! », « À La Haye », « À la forêt de Gastine », « À Guillaume des Autels », « Versons ces roses en ce vin », « Ma douce jouvence est passée », « La mercerie que je porte », « Mon neveu, sui la vertu », « Les Muses lièrent un jour », « Sur la mort de Marguerite de France, sœur du roy fFançois 1er », « Au roy Henry II »,
— Neuf discours : « À Charles IX », « À Catherine de Médicis », « Harangue du duc de Guise », « À Charles, cardinal de Lorraine », « À La Haye », À Henri III », « À Pierre L’Escot », « À catherine de Médicis, sur les misère de ce temps », « Réponse de Pierre de Ronsard aux injures et calomnies de je ne sçay quel prédicanteau et ministreau de Genève »
— Huit sonnets, une élégie, des stances : « ÀMarie Stuart », « À Catherine de Médecine », « Je veux lire en trois jours l’Iliade d’Homère », « À Marie, Quand vous serez bien vieille », « Je songeois assoupi de la nuict endormie », « Comme on voit sur la branche au mois de may la rose », « Je voy tousjours le traict de cette belle face », « Épitaphe de Marie », « L’alouette, Gaîté », « Stances, J’ai varié ma vie »
De Joachime Du Bellay :
— Quatre odes « De l’immortalité des poètes », « À Daurat, Le retour du printemps », « Qu’il faut écrire dans sa langue », « La chanson du vanneur de blé »
— Trois sonnets : « Las ! où est maintenant ce mespris de fortune », « Nouveau venu qui cherches Rome en Rome », « Ni la fureur de la flamme enragée »
— Un discours : « Le poète courtisan »
De J. A. de Baïf :
« Les roses au sieur Guibert », « À soi-mesme », « Amour oiseau », « Le calcul de la vie »
De Rémi Belleau :
Trois odes : « Ode pour la paix », « Amour piqué par une mouche à miel », « Avril »
De Du Bartas :
— Trois odes : « Description du jardin d’Éden », « Le Déluge », « Le sacrifice d’Abraham »
— Un sonnet, qui a inspiré son propre sonnet « À madame Sand » :
SONNET
- Ce roc voûté par art, par nature ou par l’âge,
- Ce roc de Taracon hébergea quelquefois
- Les géans qui rouloient les montagnes de Foix,
- Dont tant d’os excessifs rendent sûr témoignage.
- Saturne, grand faucheur, tems constamment volage,
- Qui changes à ton gré et les mœurs et les lois,
- Non sans cause à deux fronts on t’a peint autrefois :
- Car tout change sous toi chaque heure de visage.
- Jadis les fiers brigands, du pays plat bannis,
- Des bourgades chassés, dans les villes punis,
- Avaient tant seulement des grottes pour asyles.
- Ores les innocens, peureux, se vont cacher
- Ou dans un bois épais, ou sous un creux rocher,
- Et les plus grands voleurs commandent dans les villes.
De J. B ; Chassignet :
— Cinq odes : « Ode sacrée : Daigne me regarder des yeux de ta clémence », « Ode sacrée : Vois-tu bien ces richards superbement vestus », « Ode sacrée : De pourpre et d’escarlate », « Ode sacrée : Soit que du beau soleil la perruque empourprée », « Ode sacrée : Tes ennemis, Seigneur, ont fait contre tes Saints »
— Trois sonnets : « Vous avez beau croupir en l’humaine carrière », « Sais-tu que c’est de vivre ! Autant comme passer », « Un chemin tortueux ; ore le pied te casse »
De Ph. Desportes :
— Pièces diverses : « Complainte : La terre, naguère glacée », « Chanson : O bienheureux qui peut passer sa vie », « À sainte Agathe, vierge et martyre », « Chanson : Douce liberté désirée »
— Trois sonnets : « D’une fontaine », « Icare chût ici, le jeune audacieux », « Recherche qui voudra les apparents honneurs »
De J. Bertaut :
« Ode sacrée : Bienheureux est celui qui, parmi les délices », « Chanson : Les cieux inexorables »
De Régnier :
« Satire, La vie de cour », « La poésie toujours pauvre », « Le goût particulier décide de tout », « L’importun ou le fâcheux », « Le critique outré », « La folie est générale », « Le souper ridicule »,
_______